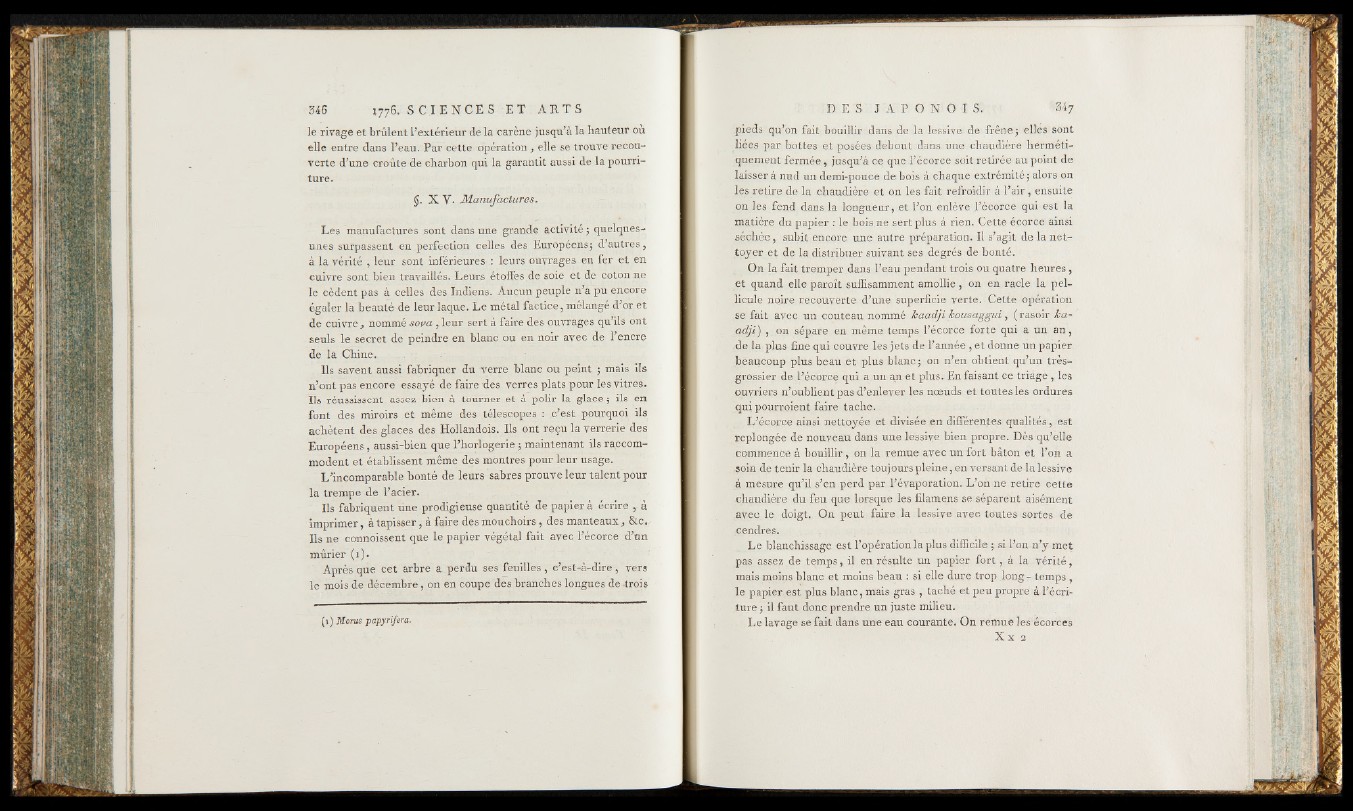
le rivage et brûlent l’extérieur de la carène jusqu’à la hauteur ou
elle entre dans l’eau. Par cette opération, elle se trouve'recouverte
d’une croûte de charbon qui la garantit aussi de la pourriture.
J. X V. Manufactures.
Les manufactures sont dans une grande activité ; quelques-
unes surpassent en perfection celles des Européens; d’autres,
à la vérité , leur sont inférieures : leurs ouvrages en fer et en
cuivre sont bien travaillés. Leurs étoffes.de soie et de coton ne
le cèdent pas à celles des Indiens. Aucun peuple n’a pu encore
égaler la beauté de leur laque. Le métal factice, mélangé d’or et
de cuivre , nommé sova .leur sert à faire dés ouvrages qu’ils ont
seuls le secret de peindre en blanc ou en noir avec de l’ encre
de la Chine. ... — - -
Es savent aussi fabriquer du verre blanc ou peint ; mais ils
n’ont pas encore essayé de faire des verres plats pour les vitres.
Ils réussissent assez bien à tourner et à polir la glace ; ils en
font des miroirs et même des télescopes : .c’est pourquoi ils
achètent des glaces des Hollandois. Ils ont reçu la verrerie des
Européens, aussi-bien que l’horlogerie ; maintenant ils raccommodent
et établissent même des montres pour leur usage.
L ’incomparable bonté de leurs sabres prouve leur talent pour
la trempe de l’ acier.
Ils fabriquent une prodigieuse quantité de papier à écrire , à
imprimer, à tapisser, à faire des mouchoirs , des manteaux, &c,.
Ils ne connoissent que le papier végétal fait avec Fécorce d’un
mûrier (1).
Après que cet arbre a perdu ses feuilles , c’est-à-dire, vers
le mois de décembre, on en coupe des branches longues de -trois 1
(1) Morns papyrifera.
347
pieds qu’on fait bouillir dans de la lessive de frêne; elles sont
liées par bottes et posées debout dans une chaudière hermétiquement
fermée, jusqu’à ce que l’écorce soit retirée au point de
laisser à nud un demi-pouce de bois à chaque extrémité; alors on
les retire de la chaudière et on les fait refroidir à l’ air , ensuite
on les fend dans la longueur, et l’on enlève l’écorce qui est la
matière du papier : le bois.ne sert plus à rien. Cette écorce ainsi
séchée, subit encore une autre préparation. Il s’agit de la nettoyer
et de la distribuer suivant ses degrés de bonté.
On la fait tremper dans l’eau pendant trois ou quatre heures,
et quand elle paroît suffisamment amollie , on en racle la pellicule
noire recouverte d’une superficie verte. Cette opération
se fait avec un couteau nommé Tcaadji kousaggui, (rasoir ka-
adji) , on sépare en même temps l’écorce forte qui a un an,
de la plus fine qui couvre les jets de l’année , et donne un papier
beaucoup plus beau et plus blanc; on n’en obtient qu’un très-
grossier de l’écorce qui a un an et plus. En faisant ce triage , les
ouvriers n’oublient pas d’enlever les noeuds et toutes les ordures
qui pourraient faire tache.
L’écorce ainsi nettoyée et divisée en différentes qualités, est
replongée de nouveau dans une lessive bien propre. Dès qu’elle
commence à bouillir, on la remue avec un fort bâton et l’on a
.soin de tenir la chaudière toujours pleine, en versant de la lessive
à mesure qu’il s’ en perd par l’évaporation. L’on ne retire cette
chaudière du feu que lorsque les filamens se séparent aisément
avec le doigt. On peut faire la lessive avec toutes sortes de
cendres.
Le blanchissage est l’opération la plus difficile ; si l’on n’y met
pas assez de temps, il en résulte un papier fo r t , à la vérité,
mais moins blanc et moins beau : si elle dure trop long - temps ,
le papier est plus blanc, mais gras , taché et peu propre à l’écriture
; il faut donc prendre un juste milieu.
Le lavage se fait dans une eau courante. On remue les écorces
X x 2