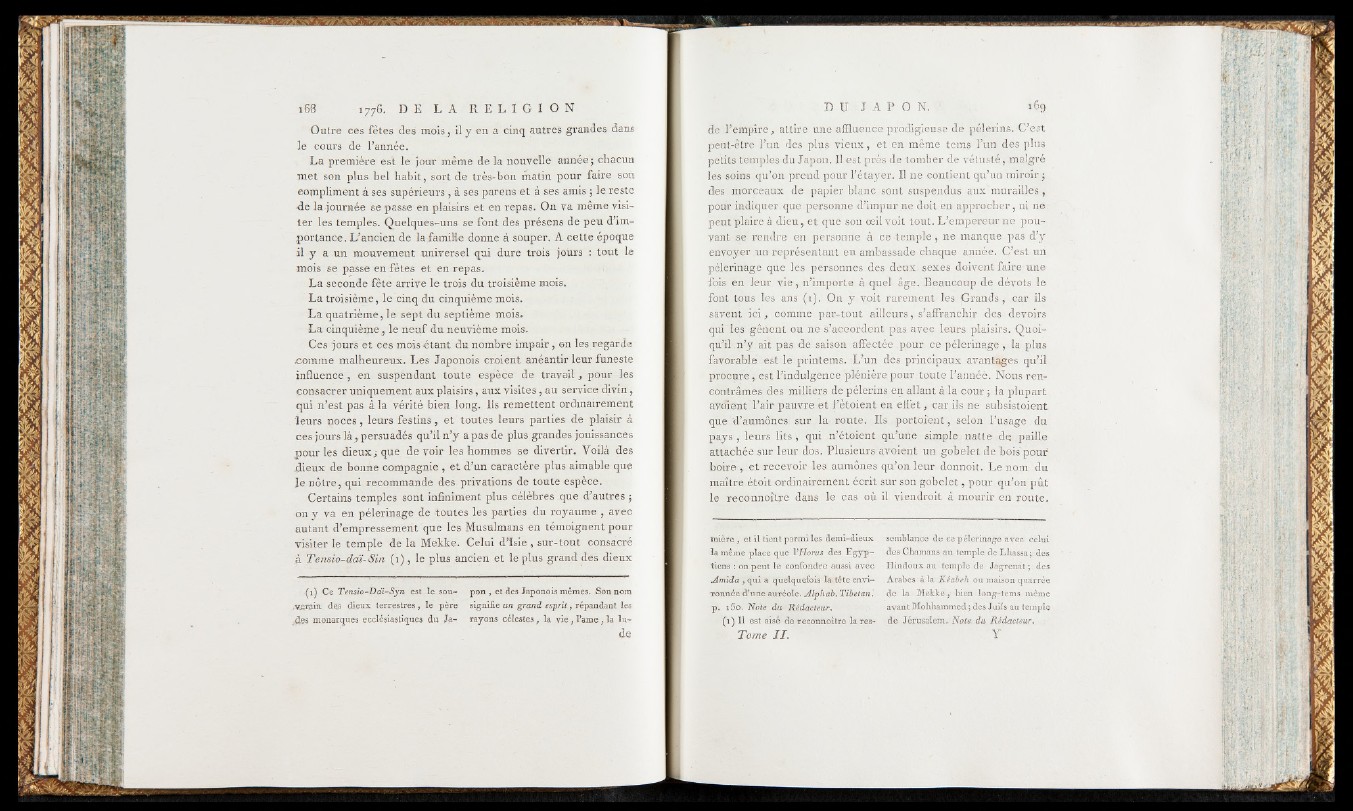
Outre ces fêtes des mois, il y en a cinq autres grandes dans
le cours de l’année.
La première est le jour même de la nouvelle année; chacun
met son plus bel habit, sort de très-bon matin pour faire son
compliment à ses supérieurs , à ses parens et à ses amis ; le reste
de la journée se passe en plaisirs et en repas. On va même visiter
les temples. Quelques-uns se font des présens de peu d’importance.
L ’ancien de lafamilie donne à souper. A cette époque
il y a un mouvement universel qui dure trois jours : tout le
-mois se passe en fêtes et en repas.
La seconde fête arrive le trois du troisième mois.
La troisième, le cinq du cinquième mois.
La quatrième, le sept du septième mois.
La cinquième, le neuf du neuvième mois.
Ces j ours et ces mois étant du nombre impair, ©n les regarde
somme malheureux. Les Japonois croient anéantir leur funeste
influence, en suspendant toute espèce de travail, pour les
consacrer uniquement aux plaisirs, aux visites, au service divin,
qui n’est pas à la vérité bien long. Ils remettent ordinairement
leurs noces, leurs festins, et toutes leurs parties de plaisir à
ces jours là, persuadés qu’il n’y a pas de plus grandes jouissances
pour les dieux; que devoir les hommes se divertir. Voilà des
dieux de bonne compagnie , et d’un caractère plus aimable que
Je nôtre, qui recommande des privations de toute espèce.
Certains temples sont infiniment plus célèbres que d’autres ;
on y va en pèlerinage de toutes les parties du royaume , avec
autant d’empressement que les Musulmans en témoignent pour
visiter le -temple de la Mekke. Celui d’Isie , sur-tout consacré
à Tensio-dai-Sin (1) , le plus ancien et le plus grand des dieux
.(1) Ce Tensio-Ddi-Syn est le sou- pon , et des Japonois mêmes. Son nom
/V&rgdn des dieux terrestres, le père signifie un grand esprit, répandant les
,4es monarques ecclésiastiques du Ja- rayons célestes, la v ie , Taine, la lu-r
ds
de l’empire, attire une affluence prodigieuse de pèlerins. C’ est
peüt-êtr|0’un des plus vieux, et en même tems l’un des plus
petits temples du Japon. Il est près de tomber de vétusté, malgré
les soins qu’on prend pour l’étàyer. Il ne contient qu’un miroir ;
des morceaux de papier blanc sont suspendus aux'murailles ,
pour indiquer-que personne d’impur ne doit en approcher, ni ne
peut plaire à dieu, et quë’ sou oeil voit tout. L’empereur ne pou-
vant-ls® rendre en personne à ce-temple, ne manque pas d’y
envoyer un représentant en ambassade chaque année. C’ est un
pèlerinage que les personnes des deux sexes doivent faire une
fois en leur v i e , n’importe à quel âge. Beaucoup de dévots le
font tous les ans (1). On y voit rarement les Grands, car ils
savent ic i, comme par-tout ailleurs, s’affranchir des devoirs
quilles gênent ou ne s’accordent pas avec leurs plaisirs. Quoiqu’il
.n’y ait pas de saison affectée .pour ce pèlerinage , la plus
favorable est le printems. L’un des principaux avantages qu’il
procure, est l’indulgence plénière pour toute l’année. Nous rencontrâmes
des milliers de pèlerins en allant à la cour 5 la .plupart
avôient 'l’air pauvre et l’étoient en effet, car ils ne subsistoient
que d’aumônes! sur la route; Ils . portoîent, selon l’usage du
pays , leurs lits, qui n’étoient qu’une simple naLle de paille
attachée.sur leur dos. Plusieurs avoient un gobelet de bois pouf
boire , et recevoir les", aumônes qu’on leur donnoit. Le nom du
maître étoit ordinairement écrit sur son gobelet, pour qu’on pût
le reconnoître dans le cas où il viendroit à. mourir en route,
mière , et il tient parmi les demi-dieux
la même place que VHorus des Egyptiens
: on peut le confondre aussi avec
Amida , qui a quelquefois la-tête environnée
d’une auréole. Alphab. Tibetan.
p. i 5o. Note du Rédacteur.
(1) Il est aisé de reconnoître la res-
Tome I I .
semblance de ce pèlerinage avec celui
des Chamans au temple de Lhassa ; des
Hindoux au temple de Jagrenat ; des
Arabes à la Kêabeh ou maison quarrée
de la Mekke., bien long-tems même
avant Mohhammed ; des Juiis au temple
de Jérusalem. Note, du Rédacteur,
y