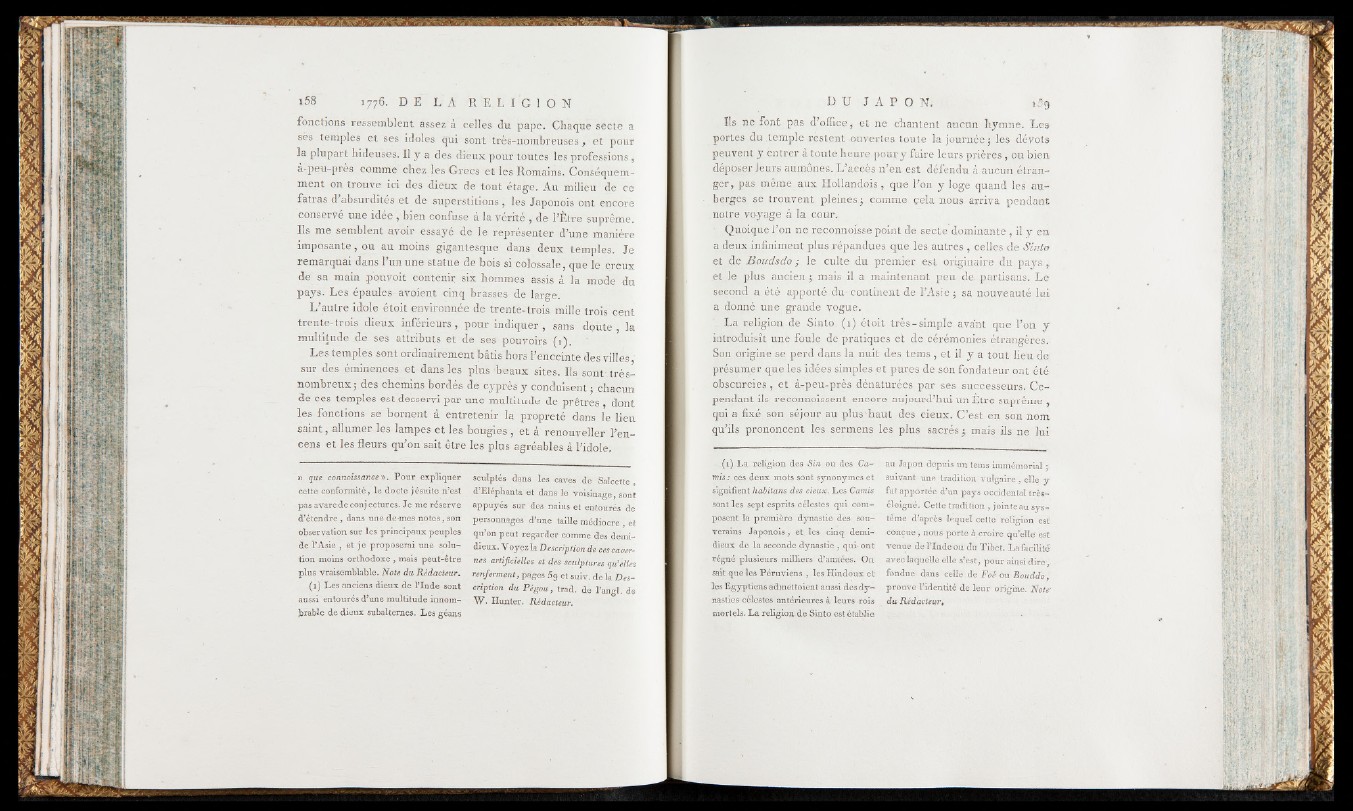
fonctions ressemblent assez à celles du pape. Chaque secte a
ses temples et ses idoles qui sont très-nombreuses, et pour
la plupart hideuses. Il y a des dieux pour toutes les professions ,
à-peu-près comme chez les Grecs et les Romains. Conséquemment
on trouve ici des dieux de tout étage. Au milieu de ce
fatras d’absurdités et de superstitions , les Japonois ont encore
conservé une idée , bien confuse à la vérité , de l’Être suprême.
Ils me semblent avoir essaye de le représenter d’une manière
imposante, ou au moins gigantesque dans deux temples. Je
remarquai dans l’un une statue de bois si colossale, que le „creux
de sa main pquvoit contenir six hommes assis à la mode du
pays. Les épaules- avoient cinq brasses de large.
L’autre idole étoit environnée de trente-trois mille trois cent
trente-trois dieux inférieurs , pour indiquer , sans doute la
multitude de ses attributs et de ses pouvoirs (1). '
Les temples sont ordinairement bâtis hors l’enceinte des villes,
sur des éminences et dans les plus beaux sites. Ils sont- très-
nombreux; des chemins bordés de cyprès y conduisent • chacun
de ces temples est desservi par une multitude de prêtres dont
les fonctions se bornent à entretenir la propreté dans le lieu
saint, allumer les lampes et lès bougies , et à renouveller l’encens
et les fleurs qu’on sait être les plus agréables à l’idole. 1
« que connaissance ». Pour expliquer
cette conformité, le docte jésuite n’est
pas avare de conj ectures. Je me réserve
d’étendre , dans une de-mes notes, son
observation sur les principaux peuples
de l’Asie , et je proposerai une solution
moins orthodoxe , mais peut-être
plus vraisemblable. Note du Rédacteur.
(1) Les anciens dieux de l’Inde sont
aussi entourés d’une multitude innombrable
de dieux subalternes. Les géans
sculptés dans les caves de Salcette ,
d Elephanta et dans le voisinage, sont
appuyés sur des nains et entourés de
personnages d’une taille médiocre p t
qu’on peut regarder comme des demi-
dieux. Voyez la Description de cescaver-
nes artificielles et des sculptures qu’elles
renferment, pages 5 g et suiv. de là Description
du Pégou, trad, de l’angl. de
W. Hunter. Rédacteur.
Us ne font pas d’office, et ne chantent aucun hymne. Les
portes du .temple restent ouvertes toute la journée; les dévots
peuvent y entrer a toute heure pour y faire leurs prières , ou bien,
déposer leurs aumônes. L’accès n’en est défendu à aucun étranger,
pas même aux Hollandois, que l’on y loge quand les an-
berges se trouvent pleines ; comme çela nous arriva pendant
notre voyage à la cour.
Quoique l’on ne reconnoisse point de secte dominante, il y en
a deux infiniment plus répandues que les autres , celles de Sinto
et de Boudsdo ; le culte du premier est originaire du.pays
et le plus ancien .; mais il a maintenant peu de partisans. Le
second a été apporté du continent de l’Asie; sa nouveauté lui
a donné une grande vogue.
La religion de Sinto (1} étoit très-.simple avant que l’on y
introduisît une foule de pratiques et de cérémonies étrangères,
Son origine se .perd dans la nuit- des tems , et il y a tout lieu de
présumer que les idées simples et pures de son fondateur ont été
obscurcies, et à-peu-près dénaturées par ses successeurs. Cependant
ils reconnoissent encore aujourd’hui un Être suprême ,,
qui a fixé son séjour au plus'haut des cieux. C’est en son nom
qu’ils prononcent les sermens les plus sacrés;, mais ils ne lui
(1) La religion des Sin ou des Ca-
mis : ces deux mots sont synonymes et
signifient habitons des cieux. Les Camis
sont les sept esprits Célestes qui composent
la première dynastie des souverains
Japonois ; et. les cinq demi-
dieux de la seconde dynastie, qui- ont
régné plusieurs milliers d’années. On
sait que les Péruviens , les Hindoux et
les Egyp tiens admettoient aussi des dynasties
célestes antérieures à leurs rois
mortels. La religion de Sinto est établie
au Japon depuis un tema immémorial :
suivant une tradition vulgaire, elle y
fut apportée d’un pays occidental très-
éloigné. Cette tradition , jointe au système
d’après lequel cette religion est
Conçue, nous porte à croire qu’elle' est
venue de l’Inde ou du Tibet. La facilité'
avec laquelle elle s’est, pour ainsi dire’,
fondue dans celle , de Foé ou Bouddoy
prouve l ’identité de leur origine. Note'
du Rédacteur*
n
imrMjN'SfmSiP ilj|p|. ËmWÈij f L ym
mW
'
1
m il- f f r a « H1
Smlèpi r m kmt1i
||||
m M Mw
T
m
àm §§
111
m
M
a J?: f.
lllw « I