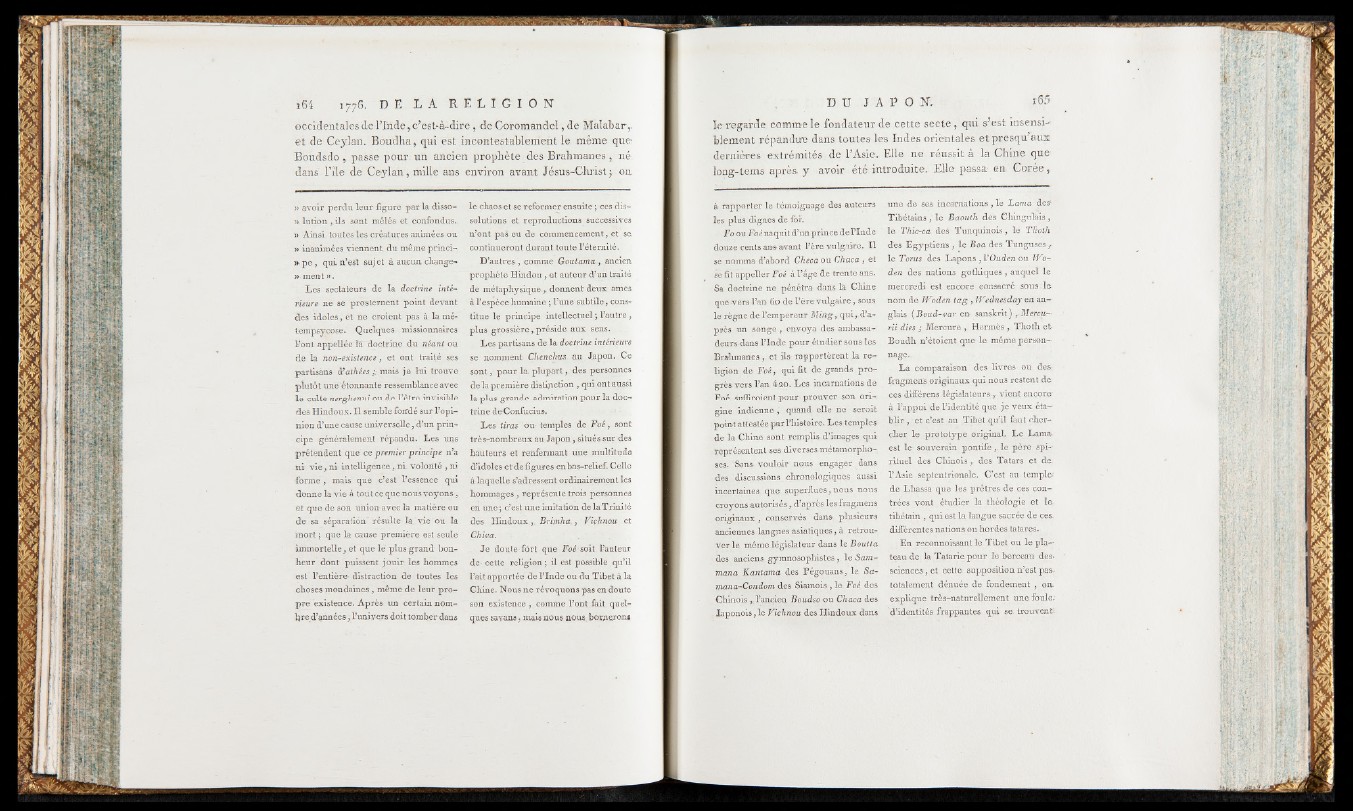
i 64 1776. D E L A R E L I G I O N
occidentales de l’Inde, c’ est-à-dire, de Coromandel, de Malabar,,
et de Ceylan. Bôudha, qui est incontestablement le même que
Boudsdo , passe pour un ancien prophète des Brahmanes , né:
dans File de Ceylan, mille ans environ avant Jésus-Christ 5 on.
» avoir perdu leur figure par la disso-
». lution,. ils sont mêlés et confondus..
» Ainsi , toutes les créatures animées ou
» inanimées viennent du même princip
e , qui n’est sujet à aucun change-
», ment ».
Les sectateurs de la doctrine intérieure
ne se prosternent point devant
des idoles, et ne croient pas à la métempsycose.
Quelques missionnaires
l’on t appellée la doctrine du néant ou
de la non-existence, et ont traité ses
partisans d?athées ,v mais je lui trouve
plutô t une étonnanté ressemblance avec
le culte nerghenni ou de l’être invisible
des Hindoux. Il semblefoirdé sur l ’opinion
d’une cause universelle, d-’un principe
généralement répandu. Les uns
prétendent que ce premier principe n’a
ni v ie , ni intelligence, ni, volonté , ni
forme, mais que c’èst l’essence qui
donne la vie à tout ce que nous voyons,
et que de son union avec là matière ou
de sa séparation résulte là vie ou la
mort ; que la cause première est seule
immortelle, et que lé plus grand bonheur
dont puissent jouir les hommes
est l’entière distraction de toutes les
choses mondaines, même de leur propre
existence. Après un certain nom-
hred’aon-ées, l’univers doit tomber dans
le chaos et se reformer-ensuite ; ces dissolutions
et reproductions successives
n’ont pas eu de commencement, et sa
continueront durant toute l’éternité.
D’autres , comme Goutama, ancien
prophète Hindou, et auteur d’un traité,
de métaphysique.,. donnent deux âmes
à l ’espècehumaine ; l ’une subtile-, constitue
le principe intellectuel ; l ’autre,
plus grossière,préside aux sens.
Les partisans de la doctrine intérieure
se nomment Chenc.hus. au lapon. Ce
sont, pour la plupart, des personnes
delà première distinction,. qui ont aussi
la-plus grande admiration pour la doctrine
de Confucius.
Les tiras ou- temples de jPoé, sont
très-nombreux au Japon, situés sur des
hàüteurs et renfermant une multitude
d’idoles et de figures en bas-relief. Celle
à laquelle s’adressent ordinairement les
hommages., représente trois personnes
en une j c’est une imitation de laTrinilé
dés Hindoux., Brimha., Viçhnou et
Chiva.
Je doute-fort que FWsoit l’auteur
de- cette religion ; il est possible. qu’il
l ’ait apportée de l’Inde ou du Tibet à la
Chine. Nous ne révoquons pas en doute
son existence, comme l’ont fait quelques
savans, mais nous nous, bornerons
If! regarde comme le fondateur de cette secte , qui s’ est insensiblement
répandue dans toutes les Indes orientales et presqu’aux
dernières extrémités de l’Asie.- Elle ne réussit a la Chine que
long-tems après, y avoir été introduite. Elle passa- en. Corée,
à rapporter le témoignage des auteurs
les plus dignes de for.
Fo ou Foé naqui t d’un prince de l ’Inde
douze cen ts ans avant l’ère vulgaire. Il
se nomma d’abord Checa ou Chaca , et
se fit appeller Foé à l’âge de trente ans.
Sa doctrine ne pénétra dans la Chine
que-vers l ’an 6d de l ’ère vulgaire, sous
le règne de l’empereur Ming, q ui,d ’a-
puès un songe, envoya des ambassadeurs
dans l ’I-nde pour étudier sous les
Brahmanes , et ils- rapportèrent la religion
de Foé, qui fit de grands progrès
vers l’an 420. Les incarnations de
Foé suffiroient pour prouver son origine
indienne , quand elle ne seroit
point attestée par l’histoire. Les temples
de la Chine sont remplis d’images qui
représentent ses diverses métamorphoses.
Sans- vouloir nous engager dans
des discussions chronologiques aussi
incertaines, que- superflues, nous nous
croyons autorisés,. d’après les fragmens
originaux, conservés dans- plusieurs
anciennes langues asiatiques, à retrouver
le même.législateur dans le B eut ta
des anciens gymnosophistes,. le. Sam-
mana Kantama des Pégouans, le Sa-
mana-Condom des Siamois , le. Foé des
Chinois ,. l’ancien Boudso ou Chaca des
Iaponois,le Vichnou des Hindoux dans
une de ses incarnations , le Lama dcsf
Tibétains , le Baouth des Chingulais ,
le Thic-ca des Tunquinois, le TBoth
des Egyptiens , le Boa des Tungusesy
le Torus des Lapons , VOuden ou Wo-~
den des nations gothiques , auquel le
mercredi est encore eonsacré sous le
nom de Woden tag , TVednesday en anglais
(Boud-var en sanskrit) r Mercu—
rit dies ; Mercure , Hermès , Thoth et
Boudh n’étoient que le même personnage.,
La comparaison des livres ou des-
fragmens originaux qui nous restent de
ces différens législateurs-r vient encore'
à l ’appui de l ’identité que je veux établir
, et c’est au Tibet qu’il faut chercher
le prototype original. Le Lama-
est le souverain pontife ,, le père spirituel
des C h in o isd e s Tatars et de
l ’Asie septentrionale. C’est au temple;
de Lhassa que les prêtres de ces contrées
vont étudier la théologie et le.
tibétain ,. qui est la langue sacrée de ces.
différentes nations ou hordes ta tares.
En reconnoissant le. Tibet ou le plateau
de la Tatarie pour le berceau des*
sciences , et cette supposition n’est pas-
totalement dénuée de fondement , on,
explique très-naturellement une foule;
d’identités frappantes qui se. trouvent1-