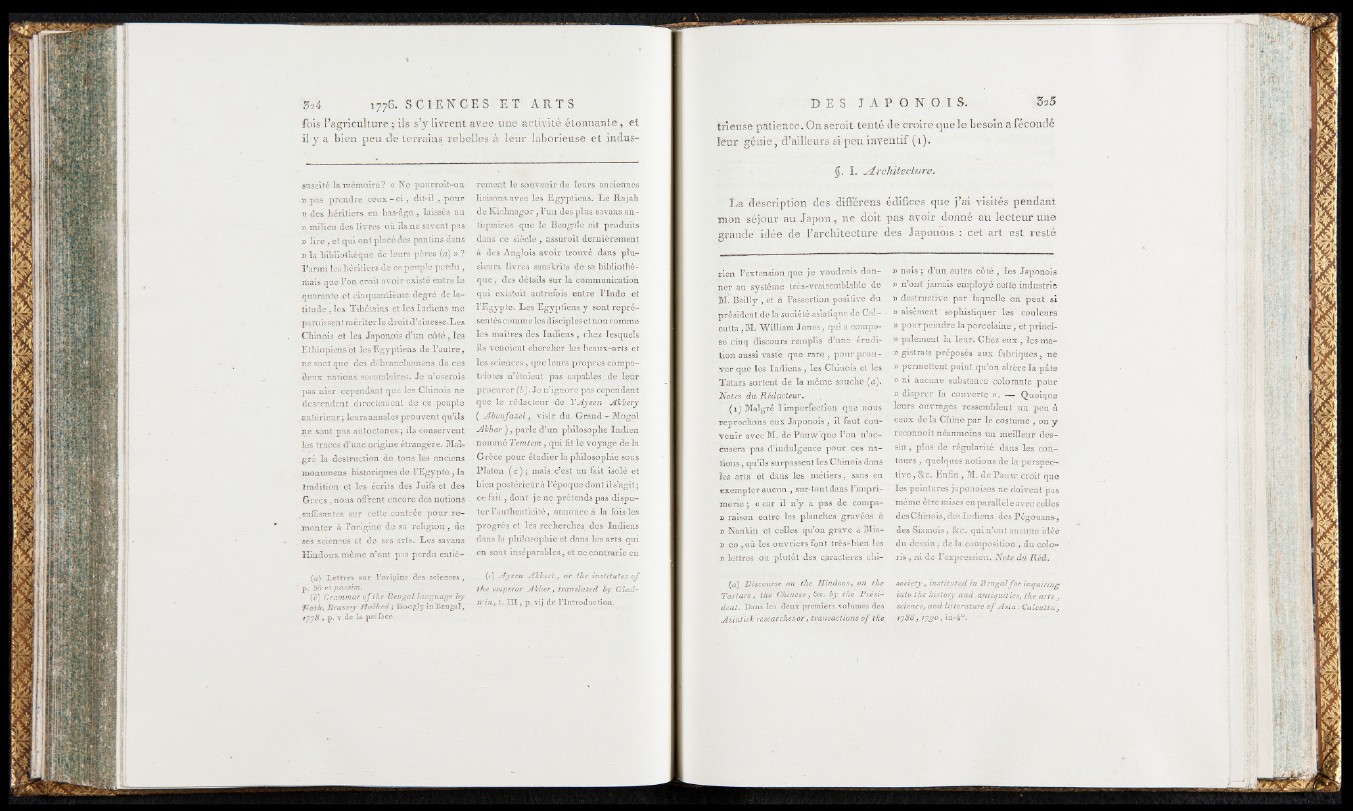
fois l’agriculture ; ils s’y livrent av.ee une activité étonnante, et
il y a bien peu de terrains rebelles à leur laborieuse et indussusc
ilé la mémoire? « Ne pourroit-on
» pas prendre ceux - c i , dit-il, pour
» des héritiers en bas-âge, laissés au
» milieu des livres où ils ne savent pas
» lire , et qui ont placé des pantins dans
j) la bibliothèque de leurs pères (a) » ?
Parmi les héritiers de ce peuple perdu,
niais que l ’on croit avoir existé entre le
quarante et cinquantième degré de latitude
, les Tibétains et les Indiens me
paroissent mériter le droit d’aînesse.Les
Chinois et les Japonois d’un coté, les
Ethiopiens et les Egyptiens de l ’autre,
ne sont que des débranchemens de ces
deux nations secondaires. Je n’oserois
pas nier cependant que les Chinois ne
descendent directement de ce peuple
antérieur) leursannales prouvent qu’ils
ne sont pas autpçtones j ils conservent
les traces,d’une origine étrangère. Maigre
la destruction de tous les anciens
monumens historiques de l ’E gyp te, la
tradition et les écrits des Juifs et des
Grecs , nous offrent encore des notions
.suffisantes sur cette contrée pour remonter
à l ’origine de sa religion, de
ses sciences et de ses arts. Les savàns
Hindoux même n’ont pas perdu entiè- •
• (a) Lettres sur l ’origine des sciences,
p. 56 et passim.
(b) Grammar o f the Bengal language by
N a th. Brassey Hctlhed ; Hoogly in Bengal,
i j j S , p. y de la préface.
rement le souvenir de leurs anciennes
liaisons avec les Egyptiens. Le Rajah
de Kichnàgor, l’un des plus savans antiquaires
que le Bengale ait produits
dans ce siècle , assuroit dernièrement
à des Anglois-avoir trouvé dans plusieurs
livres sanslcrits de sa bibliothèque,
des détails sur la communication
qui existait autrefois entre l’Inde et
l ’Egypte. Les Egyptiens y sont représentés
comme les disciples et non comme
les maîtres des Indiens, chez lesquels
ils venoient chercher les beaux-arts et
les sciences , que leurs propres compatriotes
n’étoient pas capables de leur
procurer (b). Je n’ignore pas cependant
que le rédacteur de VAyeen Akbery
( Ahoufazel, visir du Grand - Mogol
Akbar ) , parle d’un philosophe Indien
nommé Temtem, qui fit le voyage de la
Grèce pour étudier la philosophie sous
Platon ( c ) ; mais c’est un fait isolé et
bien postérieur à l’époque dont il s’agit ;
ce fa it, dont j e ne prétends pas disputer
l ’authenticité, annoncé à la fois les
progrès et les recherches des Indiens
dans la philosophie et dans les arts qui
en sont inséparables, et ne contrarie en
_ (c) Ayeen Akberi, or the institutes of
the emperor Akber, translated by Glad-■
w in , t. I I I , p.vij de l ’Introduction.
trieuse patience. O11 seroit tenté de croire que le besoin a fécondé
leur génie, d’ ailleurs si peu inventif (1).
I. Architecture.
La description des différens édifices que j’ai visités pendant
mon séjour au Japon,, ne doit pas avoir donné au lecteur une
grande idée de l’arcbitecture des Japonois : cet art est resté
rien l’extension que je voudrois donner
au système très-vraisemblable de
M. Bailly j et à l’assertion positive du
président de la société asiatique de Cal- •
Cutta, M. William Jones, qui a composé
cinq discours remplis d’une érudition
aussi vaste que rare , pour prouver
que les Indiens , les Chinois et les
Tatars sortent de la même souche (a).
Noies du Rédacteur.
( î j Malgré 1 imperfection que nous
reprochons aux Japonois, il faut convenir
avec M. dè Pauw'que l ’on n’accusera
pas d’indulgence pour ces nations
, qu’ils surpassent les Chinois dans
les arts et dans les métiers, sans en
exempter aucun , sur-tout dans l’imprimerie
; « car il n’y a pas de compa-
» raison entre les planches gravées à
» Nankin et celles qu’on grave à Mia-
» co , où les ouvriers font très-bien les
p lettres ou plutôt des caractères chi-
(a) Discourse on the Hindoos, on the
T ai tars , the Chinese, &c. by the Président.
Dans les deux premiers volumes des
Asiatick reSearchesor, transactions o f the
» nois ; d’un autre cô té , les Japonois
» n’ont jamais employé cette industrie
» destructive par laquelle on peut si
» aisément sophistiquer les couleurs
» pour peindre la porcelaine, et princi-
)> paiement la leur. Chez e u x , les mà-
» gistrats préposés aux fabriques, né
» permettent point qu’on altère la pâte
» ni aucune substance colorante polir
» diaprer la couverte ». — Quoique
leurs ouvrages ressemblent un peu à
ceux de la Cliine par l,e costume , on y
reconnoît néanmoins un meilleur dessin
, plus de régularité- dans les contours
, quelques notions de la perspective
, &c. Enfin, M. de Pàuw droit que
les peintures japonoises ne doivent pas
même être mises en parallèle avec celles
des Chinois, des Indiens, des Pégouans-,
des Siamois, 8tc. qui n’ont aucune idée
du dessin, de la composition , du coloris
, ni de l’expression. Note du Réd.
society, instituted in Bengal for inquiring
into the history and antiquities, the arts
science, and littérature o f A sia: Calcutta,
■ 17SS, -iy$o, in-4°.