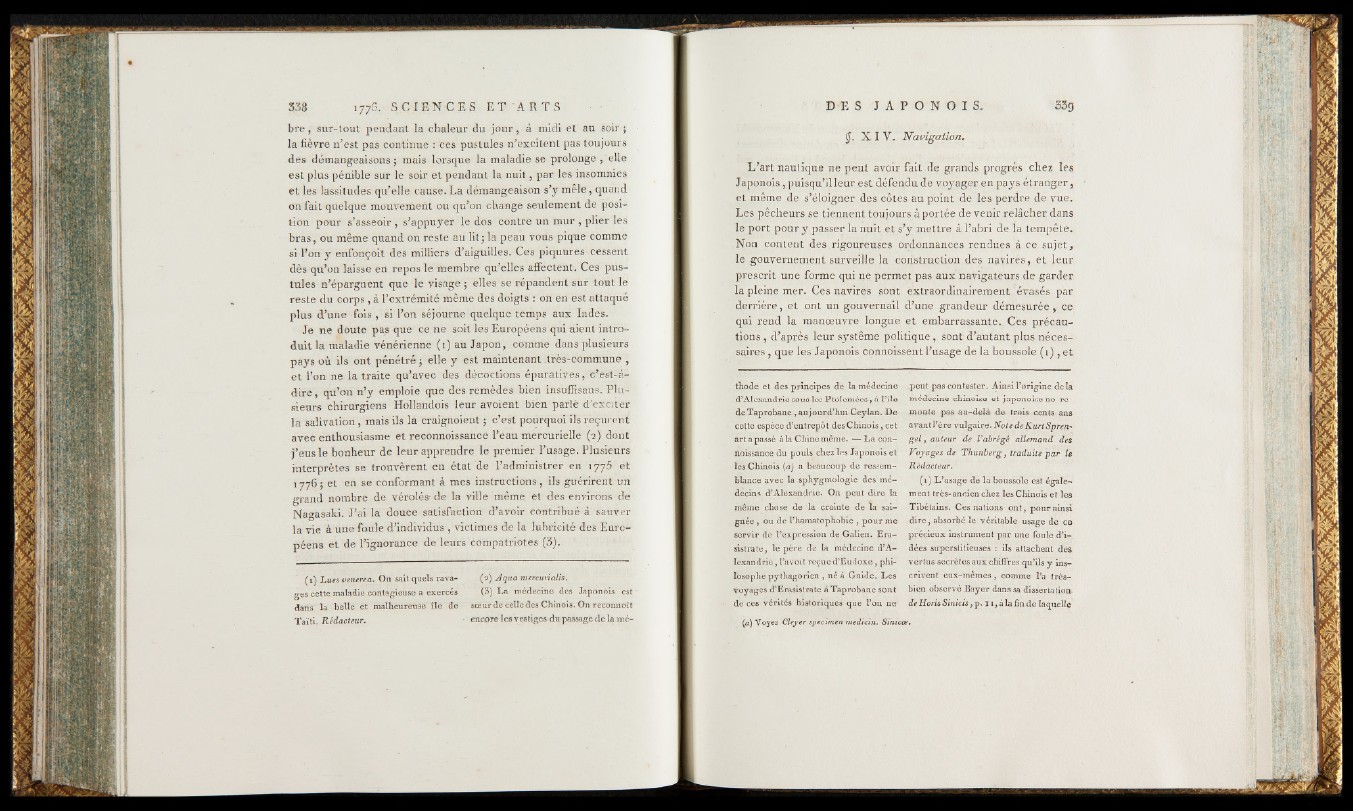
b re , sur-tout pendant la chaleur du jour, à midi et au soir ;
la fièvre n’est pas continue : ces pustules n’excitent pas toujours
des démangeaisons ; mais lorsque la maladie se prolonge elle
est plus pénible sur le soir et pendant la nuit, par les insomnies
et les lassitudes qu’elle cause. La démangeaison s’y mêle, quand
on fait quelque mouvement ou qu’on change seulement de position
pour s’asseoir, s’appuyer le dos contre un mur , plier les
bras, ou même quand on reste au lit; la peau vous pique comme
si l’on y enfonçoit des milliers d’aiguilles. Ces piquures cessent
dès qu’on laisse en repos le membre qu’elles affectent. Ces pustules
n’épargnent que le visage ; elles se répandent sur tout le
reste du corps , à l’extrémité même des doigts : on en est attaqué
plus d’une fois , si l’on séjourne quelque temps aux Indes.
Je ne doute pas que ce ne soit les Européens qui aient introduit
la maladie vénérienne (1) au Japon, comme dans plusieurs
pays où ils ont pénétré ; elle y est maintenant très-commune ,
et l’on ne la traite qu’avec des décoctions épuratives,- c’est-à-
dire , qu’on n’y emploie que des remèdes bien insuffisans. Plusieurs
chirurgiens Hollandois leur avoient bien parlé d’exciter
la salivation, mais ils là craignoient ; c’est pourquoi ils reçurent
avec enthousiasme et reconnoissance l’ eau mercurielle (2) dont
j’eus le bonheur de leur apprendre le premier l’ usage. Plusieurs
interprètes se trouvèrent en état de l’administrer en 1776 et
1776; et en se conformant à mes instructions , ils guérirent un
grand nombre de vérolés- de la ville même et des environs de
Nagasaki. J’ai la douce satisfaction d’avoir contribué à sauver
la vie à une foule d’individus , victimes de la lubricité des Européens
et de l’ignorance de leurs compatriotes (3). '
(1) Lues venerea. On sait quels rara- (a) Jqu a mercurialis.
«■ es cette maladie contagieuse a exercés (3) La médecine des Japouois est
dans la belle et malheureuse île de soeur de celle des Chinois. On reconnoît
Taïti. Rédacteur. • encore les vestiges du passage delà méÿ.
X I V . Navigation.
L ’art nautique ne peut avoir fait de grands progrès chez les
Japonois, puisqu’il leur est défendu de voyager en pays étranger,
et même de s’éloigner des côtes au point de les perdre de vue.
Les pêcheurs se tiennent toujours à portée de venir relâcher dans
le port pour y passer la nuit et s’y mettre à l’abri de la tempête.
Non content des rigoureuses oi;donnances rendues à ce. sujet *
le gouvernement surveille la construction des navires, et leur
prescrit une forme qui ne permet pas aux navigateurs de garder
la pleine mer. Ces navires sont extraordinairement évasés par
derrière, et ont un gouvernail d’une grandeur démesurée , ce
qui rend la manoeuvre longue et embarrassante. Ces précautions
, d’après leur système politique, sont d’autant plus nécessaires
, que les Japonois connoissent l’usage de la boussole (1) , et * 1
thode et des principes de la médecine
d’Alexandrie sous les Ptolemées, à l ’ile
deTaprobane , aujourd’hui Ceylan. De
cette espèce d’entrepôt des Chinois, cet
art a passé àla Chine même. — La con-
noissance du pouls chez les Japonois et
les Chinois (a) a beaucoup de ressemblance
avec la sphygmologie des médecins
d’Alexandrie. On peut dire la
même chose de la crainte de la saignée,
ou de l ’hamatophobie , pour me
servir de l’expression de Galien. Era-
sistrate, le père de la médecine d’Alexandrie
, l’avoit reçue d’Eudôxe, philosophe
pythagorien , né à Gnide. Les
voyages d’Erasistrale àTaprobane sont
de ces vérités historiques que l’on ne
.peut pas contester. Ainsi l’origine delà
médecine chinoise et japonoise ne remonte
pas au-delà de trois cents ans
avant l’ère vulgaire. Note de Kurt Spren-
gel , auteur de Vabrégé allemand des
Voyages de Thunberg, traduite par le
Rédacteur.
(1) L ’usage de la boussole est également
très-an ci en chez les Chinois et les
Tibétains. Ces nations ont, pour ainsi
dire, absorbé le véritable usage de ce
précieux instrument par une foule d’idées
superstitieuses : ils attachent des
vertus secrètes aux chiffres qu’ils y inscrivent
eux-mêmes, comme l’a très-
bien observé Bayer dans sa dissertation-
de Horis Sinicis, p. 1 1, à la fin de laquelle
(#) Voyez Cleyer specimen medicin. Sinicoe.