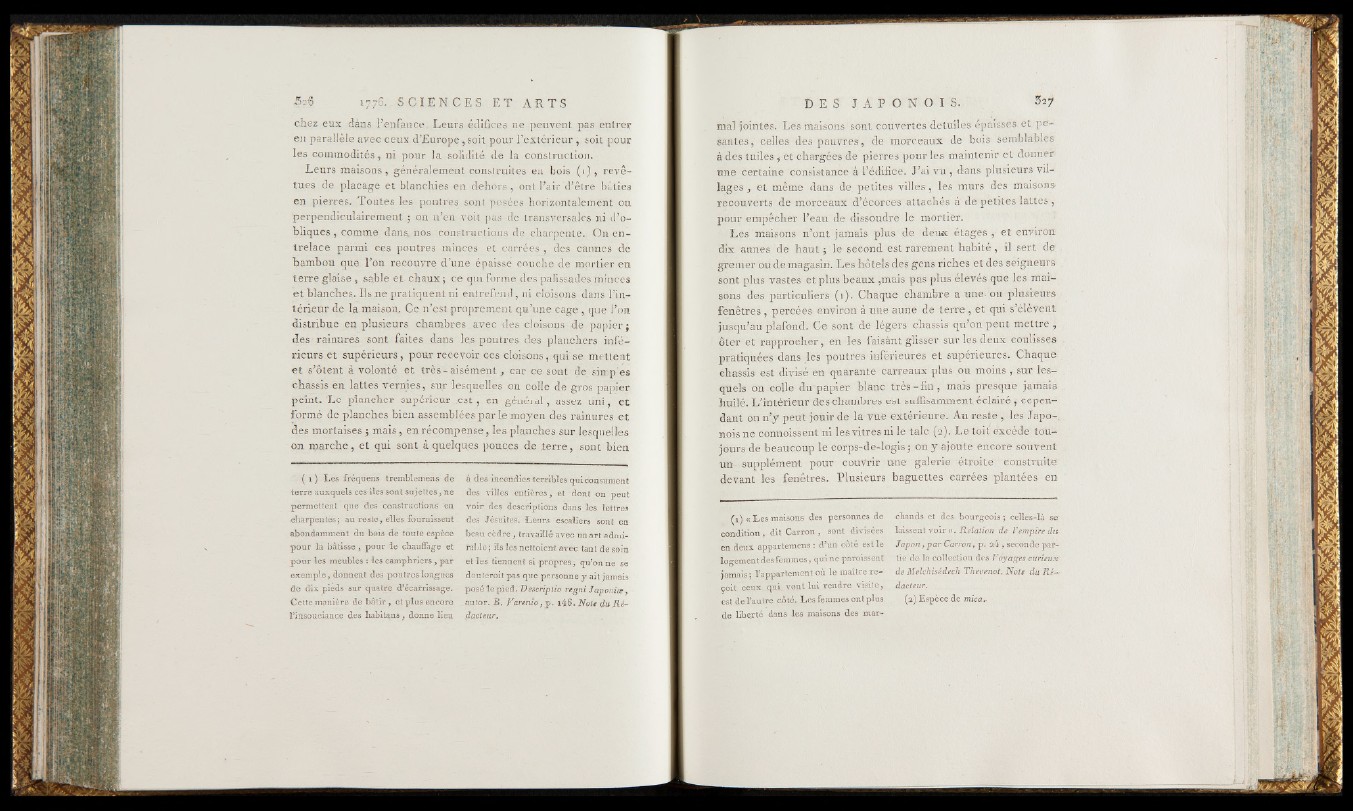
chez eux dans l’enfance. Leurs édifices ne peuvent pas entrer
en parallèle avec ceux d’Europe, soit pour l’extérieur, soit pour
les commodités, ni pour la solidité de la construction.
Leurs maisons, généralement construites eu bois (1) , revêtues
de placage et blanchies en dehors, ont l’air d’être bâties
en pierres. Toutes les poutres sont posées horizontalement ou
perpendiculairement ; on n’en voit pas de transversales ni d’obliques
, comme dans, nos constructions de charpente. On entrelace
parmi ces poutres minces et carrées , des cannes de
bambou que l’on recouvre d’une épaisse couche de mortier en
terre glaise, sable et chaux ; cè qui forme des palissades minces
et blanches. Ils ne pratiquent ni entrefend, ni cloisons dans l’intérieur
de la maison. Ce n’est proprement qu’une cage , que l’on
distribue en plusieurs chambres avec des cloisons de papier ;
des rainures sont faites , dans les poutres des planchers inférieurs
et supérieurs, pour recevoir ces cloisons, qui' se mettent
et s’ôtent à volonté et très - aisément , car ce sont de simp'es
châssis en lattes vernies, sur lesquelles on colle de gros papier
peint. Le plancher supérieur. .est , en général, assez uni. et
formé de planches bien assemblées par le moyen des rainures et
des mortaises ; mais , en récompense, les planches sur lesquelles
on marche, et qui sont à quelques pouc,es de terre, sont bien
( 1 ) Les fréquents tremb'lemens de
terre auxquels ces îles sont sujettes, ne
permettent que des constructions en
charpentes; au reste, elles fournissent
abondamment du bois de toute espèce
pour la bâtisse , pour le chauffage et
pour les meubles : les camphriers, par
exemple, donnent des poutres longues
de dix pieds sur quatre d’écarrissage.
Cette manière de bâtir , et plus encore
l ’insouciance des habitons, donne lieu
à des incendies terribles qui consument
des villes entières, et dont on peut
voir des descriptions dans les lettres
des Jésuites. Leurs escaliers sont en
beau cèdre, travaillé avec un art admirable;
ils les nettoient avec tant de soin
et lès tiennent si propres ; qu’on ne se
douteroit pas que personne y ait jamais
posé le pied. Descriplio regni Japoniæ,
autor. B. Farenio ,p . i£6. Noie du .Rédacteur.
mal jointes. Les maisons sont couvertes detùiles épaisses et pesantes,
celles des pauvres, de morceaux de bois semblables
à des tuiles ,• et chargées de pierres pour les maintenir et donner
une certaine consistance à l’édifice. J’ ai vu , dans plusieurs villages
_, et même dans de petites villes, les murs des maisons-
recouverts de morceaux d’écorces attachés à de petites lattes ,
pour empêcher l’eau de dissoudre le mortier.
Les maisons n’ont jamais plus de deux étages , et environ
dix aunes de haut ; le second est rarement habité, il sert de
grenier ou de magasin. Les hôtels des gens riches et des seigneurs
sont plus vastes et plus beaux ,mais pas plus élevés que les maisons
des particuliers (1). Chaque chambre a une-ou plusieurs
fenêtres, percées environ à une aune de terre , et qui s’élèvent
jusqu’au plafond. Ce sont de légers châssis qu’on peut mettre ,
ôter et rapprocher, en les faisant glisser sur les deux coulisses
pratiquées dans les poutres inférieures et supérieures. Chaque
châssis est divisé en quarante carreaux plus ou moins , sur lesquels
on-colle du papier blanc très-fin, mais presque jamais
huilé. L’intérieur des chambres est suffisamment éclairé , cependant
on n’y peut jouir de la vue extérieure. Au reste , les Japo-
nois ne commissent ni les vitres ni le talc (2). Le toit excède toujours
de beaucoup le corps-de-logis ; on y ajoute encore souvent
un -supplément pour couvrir une galerie étroite construite
devant les fenêtres. Plusieurs baguettes carrées plantées en 1
(1) « Les maisons des personnes de
condition, dit Carron , . sont divisées
en deux appartemens : d’un cote est le
logement des femmes, qui n e paroissent
jamais; l ’appartement ou le maître reçoit
ceux qui vont lui rendre visite,
est de l ’autre côté. Les femmes ont plus
de liberté dans les maisons des marchands
et des bourgeois ; celles-là se-
laissent voir » . Relation de Vempire du
Japon, par Carron, p. 24', seconde partie
de la collection dès Voyages curieux
de Melchisêdech Thevenot. Note du Rédacteur.
.
(2) Espèce de mica*