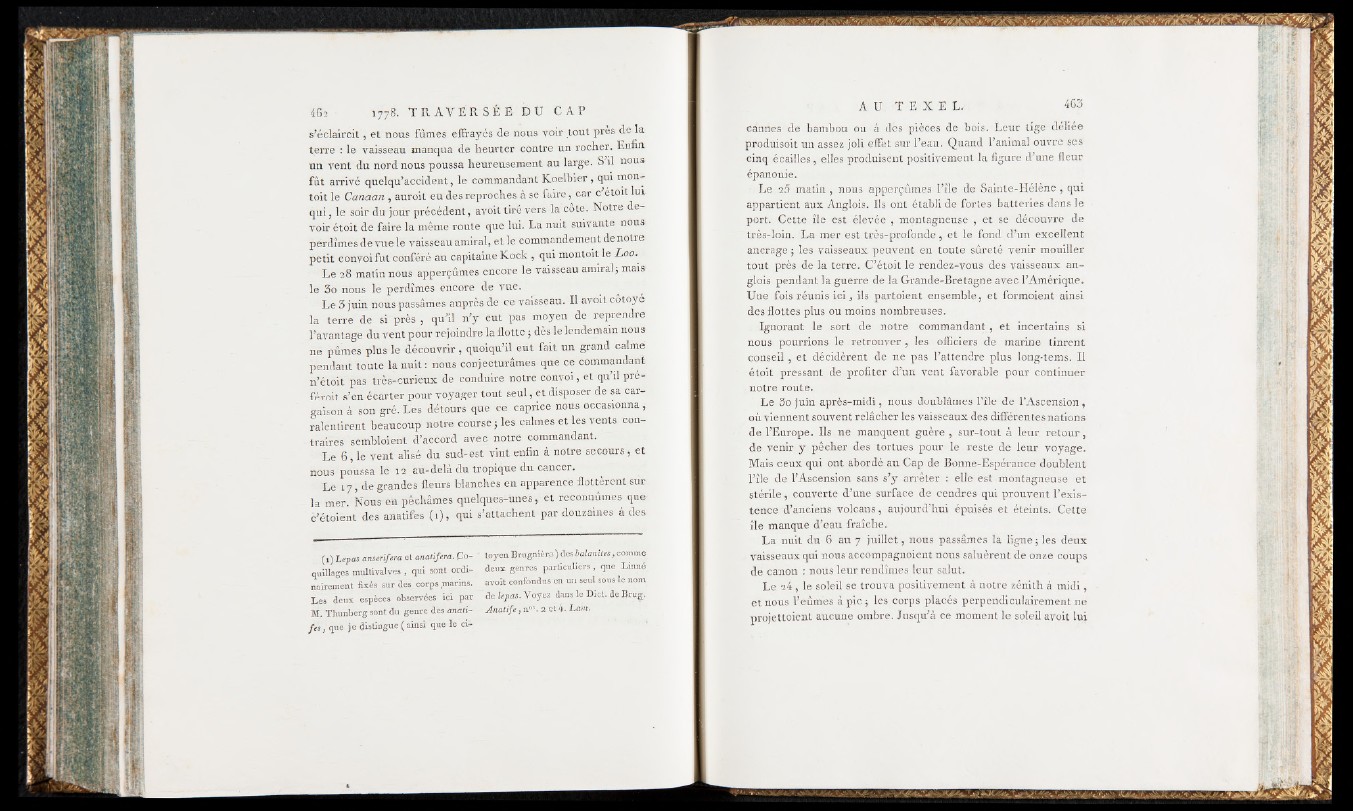
s’éclaircit, et nous fûmes effrayés de nous voir tout près de la
terre : le vaisseau manqua de heurter contre un rocher. Enfin
un vent du nord nous poussa heureusement au large. S il nous
fût arrivé quelqu’accident, le commandant Koelbier , qui mon-
toit le Canaan, auroit eu des reproches à se faire, car c’étoit lut
qui, le soir du jour précédent, avoit tiré vers la cote. Notre de
voir étoit de faire la même route que lui. La nuit suivante nous
perdîmes de vue le vaisseau amiral, et le commandement de notre
petit convoi fut conféré au capitaine Kock , qui montoit le Loo.
Le 28 matin nous apperçûmes encore le vaisseau amiral; mais-
le 3o nous le perdîmes encore de vue. ^
Le 3 juin nous passâmes auprès de ce vaisseau. Il avoit cotoyé
la terre de si près , qu’il n’y eut pas moyen de reprendre
l’avantage du vent pour rejoindre la flotte ; dès le lendemain nous
ne pûmes plus le découvrir, quoiqu’il eut fait un grand calmé
pendant toute la nuit : nous conjecturâmes que ce commandant
n’étoit pas très-curieux de conduire notre convoi, et qu il préférait
s’ en écarter pour voyager tout seul, et disposer de sa cargaison
à son gré. Les détours que ce caprice nous occasionna,
ralentirent beaucoup notre course ; les calmes et les vents contraires
sembloient d’accord avec notre commandant.
Le 6 , le vent alisé du sud-est vint enfin à notre secours , et
nous poussa lé 12 au-delà du tropique du Cancer.
Le 17, de grandes fleurs blanches en apparence flottèrent sur
la mer. Nous en pêchâmes quelques-unes, et reconnûmes que
c’étoient des anatifes (1), qui s’attachent par douzaines à des 1
(1) L e p a s a n s e r if e r a et a n a t i f e r a . Po-
quitta ges multivalyes , qui sont ordinairement
fixés sur des corps .marins.
Les deux espèces observées ici par
M.. Tliunberg sont du genre des a n a l i -
fes, que je distingue ( ainsi que le c i toyen
liragniér.s) i e s h a la n U e s , comme
deux genres particuliers, que Lmne_
avoit confondus en un seul sous lé nom
de le p a s . Voyez dans le Dict. de Jtrug-
A n a t i f e , nos. 2 et û. h a u t .
463
cannés de bambou ou à des pièces de bois. Leur tige deliee
produisoit un assez joli effet sur l’eau. Quand l’animal ouvre ses
cinq écailles, elles produisent positivement la figure d’une fleur
épanouie.
Le a5 matin , nous apperçûmes l’île de Sainte-Hélène , qui
appartient aux Anglois. Ils ont établi de fortes batteries dans le
port. Cette île est élevée , montagneuse , et se découvre de
très-loin. La mer est très-profonde, et le fond.d’un excellent
ancrage ; les vaisseaux- peuvent en toute sûreté venir mouiller
tout près de la terre. C’étoit le rendez-vous des vaisseaux anglois
pendant la guerre de la Grande-Bretagne avec l’Amérique.
Une fois réunis ici y ils partoient ensemble, et formoient ainsi
des flottes plus ou moins nombreuses.
Ignorant le sort de notre commandant, et incertains si
nous pourrions le retrouver , les officiers de marine tinrent
conseil , et décidèrent de ne pas l’attendre plus long-tems. Il
étoit pressant de profiter d’un vent favorable pour continuer
notre route.
Le 3o juin après-midi, nous doublâmes l’île de l’Ascension,
où viennent souvent relâcher les vaisseaux des différentes nations
de l’Europe. Ils ne manquent guère, sur-tout à leur retour,
de venir y pêcher des tortues pour le reste de leur voyage.
Mais ceux qui ont abordé au Cap de Bonne-Espérance doublent
l’île de l’Ascension sans s’y arrêter : elle est montagneuse et
stérile, couverte d’une surface de cendres qui prouvent l’existence
d’anciens volcans, aujourd’hui épuisés et éteints. Cette
île manque d’eau fraîche.
La nuit du 6 au 7 juillet, nous passâmes la ligne ; les deux
vaisseaux qui nous'accompagnoient nous saluèrent de onze coups
de canon : nous leur rendîmes leur salut.
Le 24 , le soleil se trouva positivement à notre zénith à midi,
et nous l’ eûmes à pic ; les corps placés perpendiculairement ne
projettoient aucune ombre. Jusqu’à ce moment le sçleil avoit lui