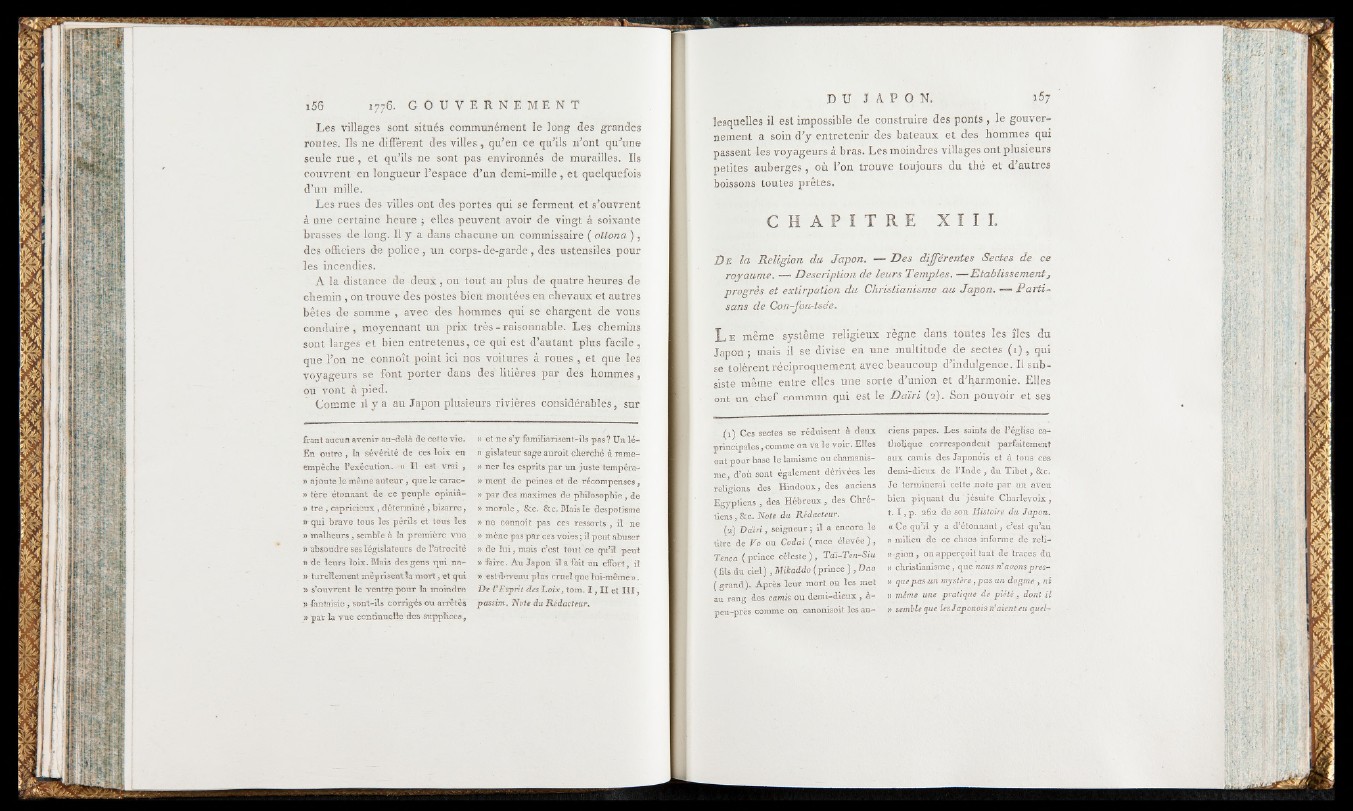
Les villages sont situés communément le long des grandes
routes. Ils ne diffèrent des villes , qu’en ce qu’ils n’ont qu’une
seule rue, et qu’ils ne sont pas environnés de murailles. Ils
couvrent en longueur l’espace d’un demi-mille , et quelquefois
d’un mille.
Les rues des villes ont des portes qui se ferment et s’ouvrent
à une certaine heure 5 elles peuvent avoir de vingt à soixante
brasses de long. Il y a dans chacune un commissaire ( ottona ) ,
des officiers de police, un corps-de-garde, des ustensiles pour
les incendies.
A la distance de deux, ou tout au plus de quatre heures de
chemin , on trouve des postes bien montées en chevaux et autres
bêtes de somme , avec des hommes qui se chargent de vous
conduire , moyennant un prix très - raisonnable. Les chemins
sont largësTet bien entretenus, ce qui est d’autant plus facile ,
que l’on ne. connoît point ici nos voitures à roues , et que les
voyageurs se font porter dans des' litières par des hommes ,
ou vont à pied.
Comme il y a au Japon plusieurs rivières considérables, sur
frant aucun avenir au-delà de cette vie.
En outre, la sévérité de ces loix en
empêche l’exécution. Il est vrai ,
» ajoute le même auteur, que le carac-
» 1ère étonnant de ce peuple opiniâ-
» tre , capricieux , déterminé , bizarre,
n qui brave tous les périls et tous les
» malheurs, semble à la première vue
» absoudre ses législateurs de Patrocilè
» de leurs loix. Mais des gens 'qui na-
» turellement méprisent la m ort, et qui
5> s’ouvrent le ventre pour la moindre
j) fantaisie, sont-ils corrigés ou arrê tés
» par la vue continuelle des supplices,
» et ne s’y familiarisent-ils pas ? Un lé-
» gislateur sage auroit cherché à rame-
» ner les esprits par un juste tempéra-
» meut de peines et de récompenses,
» par des maximes de philosophie, de
» morale, &c. &c. Mais le despotisme
» ne connoît pas ces ressorts , il ne
» mène pas par ces voies ; il peut abuser
» de lui,mais c’est tout ce qu’il peut
» faire. Au Japon il a fait un effort, il
» estdevenu plus cruel que lui-même ».
De l’ Esprit des Loix, tom. I , II et I I I ,
passim. Note du Rédacteur.
D U J A P O N , i 57
lesquelles il est impossible de construire des ponts , le gouvernement
a soin d’y entretenir des bateaux et des hommes qui
passent les voyageurs à bras. Les moindres villages ont plusieurs
petites auberges, où l’on trouve toujours du thé et d’autres
boissons toutes prêtes.
C H A P I T R E XI I I .
D e la Religion du Japon. — Des différentes Sectes de ce
royaume. — Description de leurs Temples. — Etablissementj
progrès et extirpation du Christianisme au Japon. — Partisans
de Con-fou-tsée.
L e même système religieux règne dans toutes les îles du
Japon ; mais il se divise en une multitude de sectes (1) , qui
se tolèrent réciproquement avec beaucoup d'indulgence. Il subsiste
même entre elles une sorte d'union et d'harmonie. Elles
ont un chef commun qui est le Daïri (2). Son pouvoir et ses
(1) Ces sectes se réduisent à deux
principales, comme on va le voir. Elles
ont po ur base le lamisme ou chamanisme,
d’où sont également dérivées les
religions des Hindoux, des anciens
Egyptiens , des Hébreux, des Chrétiens,
&c. Note du Rédacteur.
(2) Ddiri, seigneur 5 il a encore le
titre de Vo ou Codai (race élevée) ,
Tenca (prince céleste), Tdi-Ten-Siu
(fils du ciel.) , Mikaddo (prince ) , Duo
( grand). Après leur mort on les met
au rang des camis ou demi-dieux , à -
peu-près comme on canonisoit les anciens
papes. Les saints de l’église catholique
correspondent parfaitement
aux camis des Japono-is et à tous- ces
demi-dieux de l ’Inde , du Tibet, &c.
Je terminerai celte note par un aveu
bien piquant du jésuite Charïevoix,
1 .1 , p. 262 de son Histoire du Japon*
« Ce qu’il y a d’étonnant, c’est qu’au
n milieu de ce chaos informe de reli-
» -gion, on apperçoit tant de traces du
n christianisme, que nous n’avons presto
que pus un mystère, pas un dogme , ni
» même une pratique de piété, dont il
» semble que les Jap onois n’aient eu quel