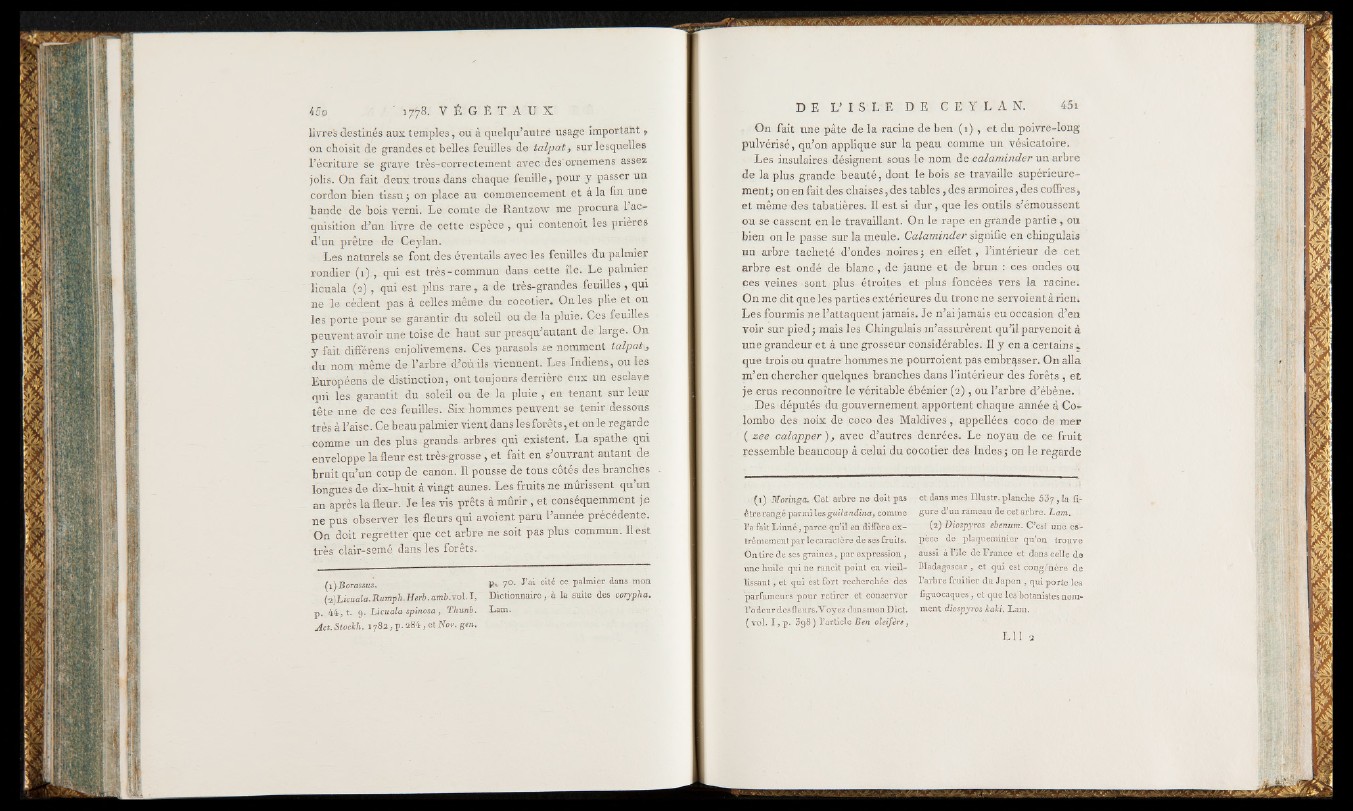
livres destinés aux temples, ou à quelqu’autre usage important >
on choisit de grandes et belles feuilles de talpat, sur lesquelles
l ’écriture se grave très-correctement avec des'ornemens assez
jolis. On fait deux trous dans chaque feuille, pour y passer un
cordon bien tissu ; on place au commencement et à la fin une
bande de bois verni. Le comte de Rantzow me procura 1 acquisition
d’un livre de cette espèce, qui contenoit les prières
d’un prêtre de Ceylan.
Les naturels se font des éventails avec les feuilles du palmier
rondier ( 1 ) qui est très-commun dans cette île. Le palmier
licuala (2), qui est plus rare, a de très-grandes feuilles, qui
ne le cèdent pas à celles même du cocotier. On les plie et on
les porte pour se garantir du soleil ou de la pluie. Ces feuilles
peuvent avoir une toise de haut sur presqu’autant de large. On
y fait différons enjolivemens. Ces parasols se nomment talpat j
du nom même de l’arbre d’ouais viennent. Les Indiens, ou les
Européens de distinction, ont toujours derrière eux un esclave
qui les garantit du soleil ou de la pluie , en tenant sur leur
tête une de ces feuilles. Six hommes peuvent se tenir dessous
très à l’aise. Ce beau palmier vient dans les forêts, et on le regarde
comme un des plus grands arbres qui existent. La spathe qui
enveloppe la fleur est très-grosse, et fait en s’ouvrant autant de
bruit qu’un coup de canon. Il pousse de tous côtés des branches
longues de dix-huit à vingt aunes. Les fruits ne mûrissent qu’un
an après la fleur. Je les vis prêts à mûrir , et conséquemment je
ne pus observer les fleurs qui avoient paru l’année précédente.
On doit regretter que cet arbre ne soit pas plus commun. Il est
très clair-semé dans les forêts. 1 2
■ g. 70. J’ai cité ce palmier dans mon
Dictionnaire, à la suite des corypha.
Lam.
(1) jBorassus.
(2) Licuala. Rumph. Herb. amb.vol. I,
p. 44, t. 9. Licuala spinosa, Thunb.
Act. Stoclh. 1782, p. 284, et Nov. gen.
On fait une pâte de la racine de ben (1) , et du poivre-long
pulvérisé, qu’on applique sur la peau comme un vésicatoire.
Les insulaires désignent sous le nom de calaminder un arbre
de la plus grande beauté, dont le bois se travaille supérieurement;
on en fait des chaises, des tables, des armoires, des coffres,
et même des tabatières. Il est si dur, que les outils s’émoussent
ou se cassent en le travaillant. On le rape en grande partie , ou
bien on le passe sur la meule. Calaminder signifie en chingulaîs
un arbre tacheté d’ondes noires; en e ffet, l’intérieur de cet
arbre est ondé de blanc, de jaune et de brun : ces ondes ou
ces veines sont plus étroites et plus foncées vers la racine;
On me dit que les parties extérieures du tronc ne servoient à rient
Les fourmis ne l’attaquent jamais. Je n’ai jamais eu occasion d’en
voir sur pied; mais les Chingulais m’assurèrent qu’il parvenoit à
une grandeur et à une grosseur considérables. II y en a certains „
que trois ou quatre1 hommes ne pourroient pas embrqsser. On alla
m’en chercher quelques branches dans l’intérieur des forêts , et
je crus reconnoitre le véritable ébénier (2), ou l’arbre d’ébène.
Des députés du gouvernement apportent chaque année à Colombo
des noix de coco des Maldives, appellées coco de mer
( zee calapper), avec d’autres denrées. Le noyau de ce fruit
ressemble beaucoup à celui du cocotier des Indes ; on le regarde
■ (1) Moringa. Cet arbre ne doit pas
être rangé parmi les guilandina, comme
l’a fait Linné, parce qu’il en diffère extrêmement
par le caractère de ses fruits.
On tiré de ses graines, par expression ,
une tuile qui ne rancit point en. vieillissant
, et qui est fort recherchée des
parfumeurs pour retirer et conserver
l ’odeur desfleurs. Y oyez dans mon Dict.
(vol. I , p. 3g8 ) l ’article Ben oléifère,
et dans mes Illustr. planche 53 7, la figure
d’un rameau de cet arbre. Lam.
(2) Diospyros ebenum. C ’est une espèce
de plaqueminier qu’on trouve
aussi à Pile de France et dans celle de
Madagascar, et qui est congénère de
l ’arbre fruitier du Japon , qui porte les
figuocaques, et que les botanistes nomment
diospyros kaki. Lam.
l u 2