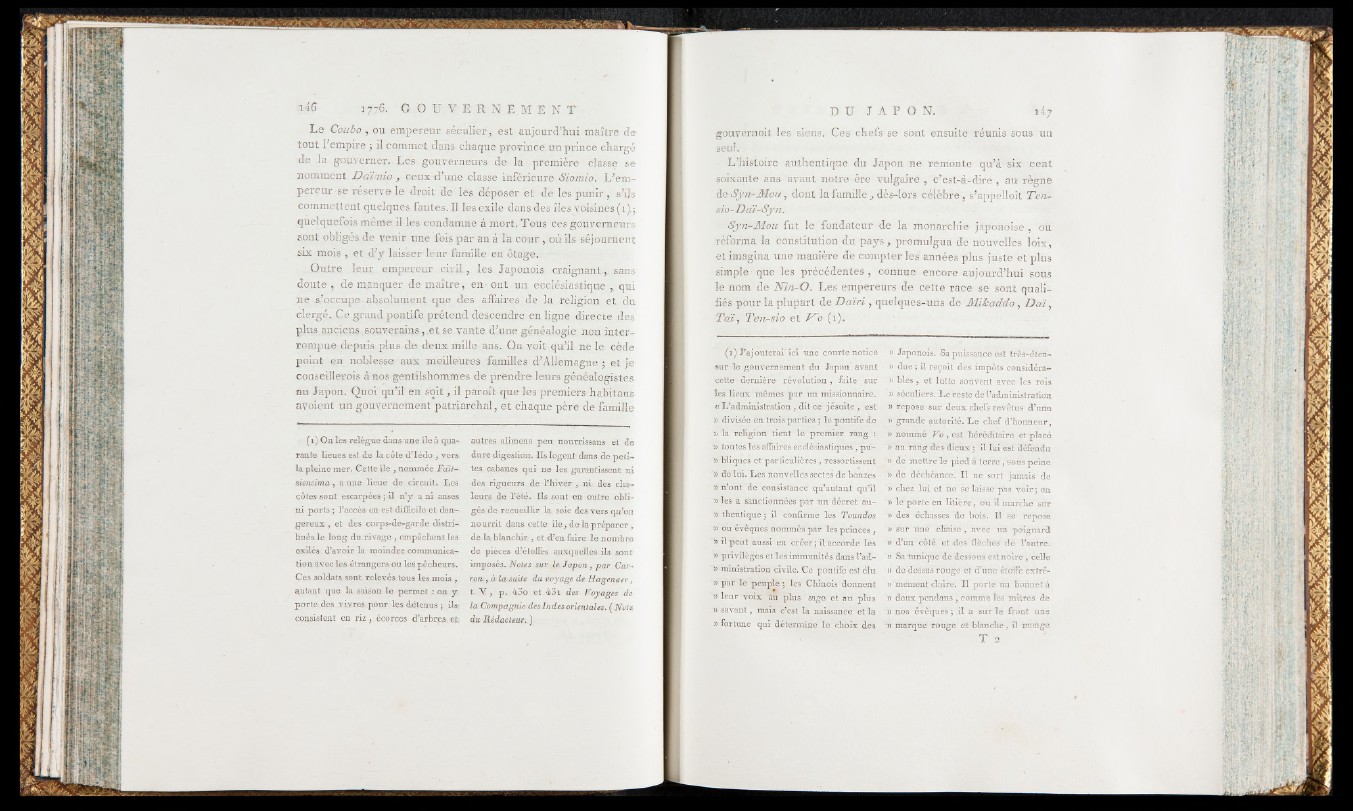
Le Coubo , ou empereur séculier, est aujourd’hui maître de
tout l’empire ; il commet dans chaque province, un prince chargé
de la gouverne^. Les gouverneurs de l a 1 première classe se
nommënt Daimio , ceux d’une classe inférieure Siomio. L’empereur
se réserve le droit de les déposer et de-les punir s’ils
commettent quelques fautes. Il les exile dans des îles voisines (1),;
quelquefois meme il les condamne à mort. Tous ces gouverneurs
sont obligés de venir une fois par an à l'a cour ,..oùils séjournent
six mois , et d’y laisser leur famille en otage.
Outre leur empereur c ivil, les Japonois craignant., sans-
doute , de manquer de maître, en- ont un ecclésiastique , qui
ne s’occupe absolument que des affaires de la religion et du
clergé.. Ce grand pontife prétend descendre en ligne directe des
plus anciens souverains , .et se vante d’une généalogie non interrompue
depuis plus de. deux mille ans. Q11 voit qu’il ne le cède
point en noblesse aux meilleures familles d’Allemagne; et je
conseillerois à nos gentilshommes de prendre leurs généalogistes
au Japon. Quoi qu’il en soit, il paroît que les premiers habit ans
avoient un gouvernement patriarchal, et chaque père de famille
(1) On les relègue dans une lie à quarante
lieues est de la côte d’Iédo.,.ver®
la pleine mer. Cette île , nommèe Fàit-
siensima , aune lieue de. circuit.. Les
Gotes sont escarpées ; -il n’y a ni anses
ni ports j l’accès en est difficile et dangereux
, et des corps-de-garde distribués.
le long du rivage , empêchent les
exilés d’avoir là moindre communication
avec les étrangers ou les pêcheurs.
Ces soldats, sont relevés, tous les mois ,
autant que la saison le permet : on y
porte des vivres pour les- détenus ; ils;
consistent en riz , écorces d’arbr.es. et,
autres alimens peu nourrissans et de
dure digestion. Ils logent dans de petites
cabanes qui ne lès garantissent ni
des rigueurs de l’hiver , ni. des chaleurs
de l ’été. Ils sont en outre obligés
de recueillir la soie des vers qu’on
nourrit dans cette île , de la préparer ,
de là blanchir, et d’en faire lè nombre
de pièces d? étoffes auxquelles ils sont
imposés. Notes sur le Japon, par Car-
ron à-la.suite du voyage de Hagenaer,
t. Y , p. 43o et 431 des Voyages de
la Compagnie. des Indes orientales. ( Nota
du Rédacteur. )
147
gouvernoit les siens. Ces chefs se sont ensuite réunis sous un
seul.
L’histoire authentique du Japon ne remonte qu’à six cent
soixante ans avant notre ère vulgaire , c’est-à-dire , au règne
de Syn-Mou, dont la famille , dès-lors célèbre, s’appelloit Ten-
sio-Daï-Syn.
Syn-Mou fut le fondateur de la monarchie japonoise, ou
réforma la constitution du pays, promulgua de nouvelles loix,
et imagina une manière de compter les années plus juste et plus
simple ■ que les précédentes , connue encore aujourd’hui sous
le nom de JSTin-O. Les empereurs de cette race se sont qualifiés
pour la plupart de Daïri , quelques-uns de Mihaddo, TJ a i,
T a ï, Ten-sio et V o (1). .-
(1) J’ajouterai'’ ici une courte notice
-sur le gouvernement du Japon avant
cette dernière révolution, faite sur
les lieux mêmes par un missionnaire.
« L ’administration , dit ce jésuite , est
» divisée en trois parties ; le pontife de
>; la religion tient le premier rang :
» toutes les affaires ecclésiastiques, pu-
3) bliques et particulières, ressortissent
’» de lui. Les nouvelles sectes de bonzes
>i n’ont de consistance qu’autant qu’il
y> les a sanctionnées par un décret au-
» thentique ; il confirme les Toundos
» ou évêques nommés par ‘les, princes,
* il peut aussi en créer ; il accorde les
» privilèges et les immunités dans l ’ad-
’» ministradon civile. Ce pontife est élu
» par le peuple ; les Chinois donnent
» leur voix àu plus sage et au plus
» savant, mais c’est la naissance et la
» fortune qui détermine le choix des
» Japonois. Sa puissance est très-éten-
» due ; il reçoit des impôts considéra*-
)i blés, et lutte souvent avec les rois
»> séculiers. Le reste de l ’administration
| repose sur deux chefs revêtus d’une
> grande autorité. Le che?f d’honneur,
> nommé Vo , est héréditaire et placé
> au rang des dieux ; il lui est défendu
> de mettre le pied à terre, sous peine
> de déchéancè. Il ne sort jamais de
> chez lui et ne se laisse pas voir ; on
) le porte en litière, ou il marche sur
> des échasses de bois. I l se repose
> sur une chaise, avec un poignard
> d’un côté et des flèches dé l ’autre.
> Sa tunique de dessous est noire, celle
> de dessus rouge et d’une étoffe extrê-
> mement claire. Il porte un bonnet à
> deux pendans , comme les mitres do
> nos évêques j il a sur le front une
> marque rouge et blanche, il mange
ïm m
ffîfât'i E l X *
i m I i l 1 \ ë
MHy Vfc ÿ*-;
P
»BaEgSjÀJMi