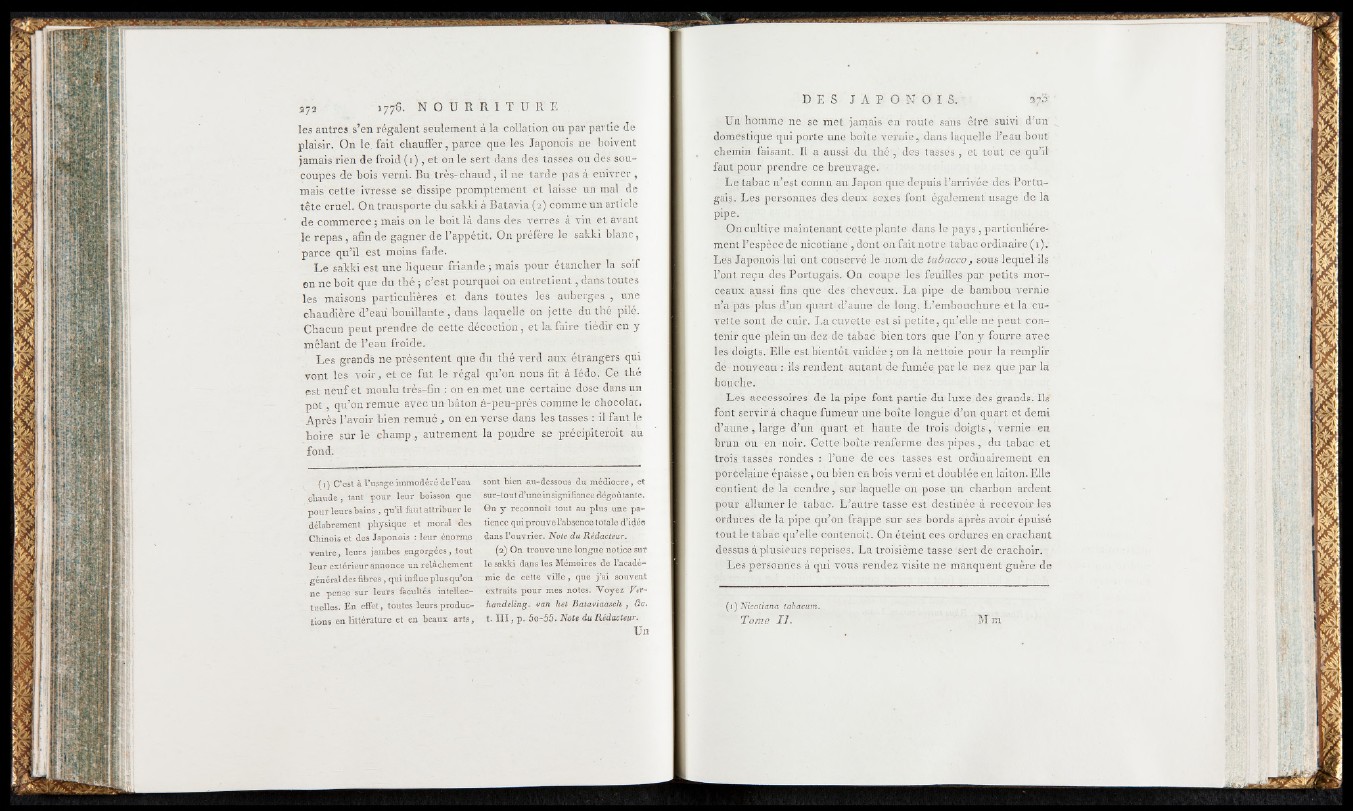
les autres s’en régalent seulement à la collation ou par partie de
plaisir. On le. fait cliauffer, parce que les Japonois ne boivent
jamais rien de froid (1), et on le sert dans des tasses ou des soucoupes
de bois verni. Bu très-chaud, il ne tarde pas à enivrer ,
mais cette ivresse se dissipe promptement et laisse un mal de
tête cruel. On transporte du sakki à Batavia (2) comme un article
de commerce ; mais on le boit là dans des verres à vin et avant
le repas , afin de gagner de l’appétit. On préféré le sakki blanc,
parce qu’il est moins fade.
Le sakki est une liqueur friande 5 mais pour étancher la soif
en ne boit que du thé ; c’est pourquoi on entretient, dans toutes
les maisons particulières ' et dans toutes les auberges , une
chaudière d’ eati bouillante , dans laquelle on jette du thé pilé.
Chacun peut prendre de cette décoction , et la faire tiédir en y
mêlant de l’eau froide.
Les grands ne présentent que du thé verd aux étrangers qui
vont les voir, et ce fut le régal qu’on nous fit à Iédo, Ce the
est neuf et moulu très=-fin : ori en met une certaine dose dans un
p o t, qu’on remue avec un bâton à-peu-près comme le chocolat.
Après l ’avoir bien remué , on en verse dans les tasses : il faut le
boire sur le champ ., autrement la poudre se précipiteroit au
fond.
(1) C’ est à l ’usage immodéré de l’eau
chaude , tant pour leur boisson que
pour leurs bains , qu’il faut attribuer le:
délabrement physique -et moral des
Chinois et des Japonois : leur énorme
ventre, leurs jambes engorgées, tout
leur extérieur annonce un relâchement
général des fibres , qui influe plus qu’on
ne pense sur leurs facultés intellectuelles.
En effet, toutes leurs productions
en littérature et en beaux arts,
sont bien au-dessous du médiocre, et
sur-tout d’une in signifiance dégoûtante.
On y reconnoît tout au plus use patience
qui prouve l’absence totale d’idée
dans l’ouvrier. Note du Rédacteur.
(2) On trouve une longue notice sur
le sakki dans les Mémoires de l ’académie
de cette v ille , que j ’ai souvent
extraits pour mes notes. Voyez Ner-
. handeling, van het Bataviaasch , Qc.
t. I I I , p. 5o-55. Note du Rédacteur.
Un homme ne se met jamais en route sans être suivi d’un
domestique qui porte une boîte vernie, dans laquelle l’ eau bout
chemin faisant. Il a aussi du thé , des tasses , et tout ce qu’il
faut pour prendre ce breuvage.
Le tabac n’est connu au Japon que depuis l’arrivée des Portugais.
Les personnes des deux sexes font également usage de la
pipe-' , '
On cultive maintenant cette plante dans le pays, particuliérement
l’ espèce de nicotiane , dont on fait notre tabac ordinaire (1).
Les Japonois lui ont conservé le nom de tabacco , sous lequel ils
l’ont reçu des Portugais. On coupe les feuilles par petits morceaux
aussi fins que des cheveux. La pipe de bambou vernie
n’a pas-plus d’un quart d’aune de long. L’embouchure et la cu-
vetle sont de cuir. La cuvette est si petite, qu’elle ne peut contenir
que plein un dez de tabac bien tors que l’on y fourre avec
les doigts. Elle est bientôt vuidée 5 on là nettoie pour la remplir
de nouveau : ils rendent autant de fumée par le nez que par la
bouche.
Les accessoires de la pipe font partie du luxe des grands. Ils
font servir à chaque fumeur une boîte longue d’un quart et demi
d’aune , large d’un quart et haute de trois doigts, vernie en
brun ou en noir. Cette boîte renferme des pipes , du tabac et
trois, tasses rondes : l’une de ces tasses est ordinairement en
porcelaine épaisse , ou bien en bois verni et doublée en laiton. Elle
contient de la cendre, sur laquelle on pose un charbon ardent
pour allumer le tabac. L’autre tasse est destinée à recevoir les
ordures de la pipe qu’on frappe sur ses bords après avoir épuisé
tout le tabac qu’elle contenoit. On éteint ces ordures en cracbant
dessus à plusieurs reprises. La troisième tasse 'sert de crachoir.
Les personnes à qui vous rendez visite ne manquent guère de 1
(1) Nicotiana iahacum.
Tome I I . Mm