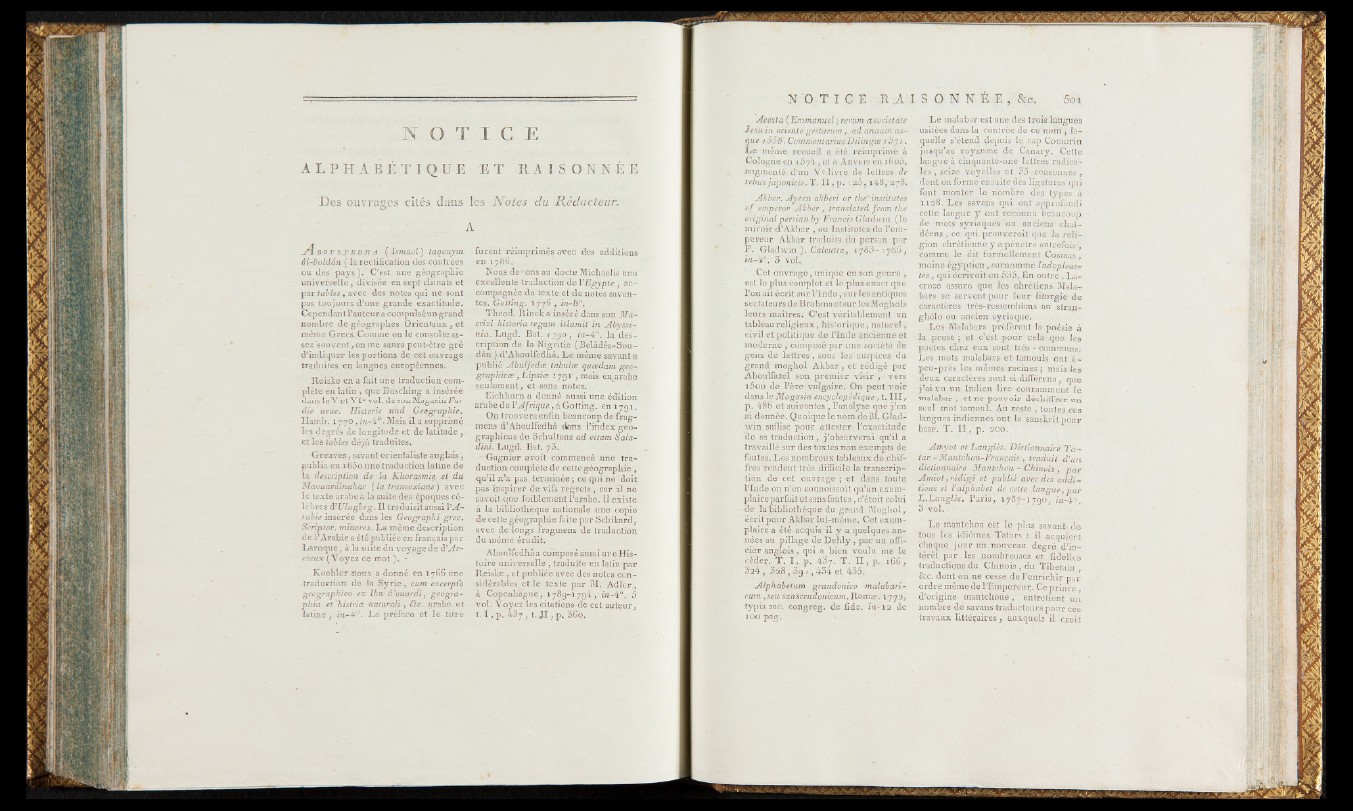
N O T I C E
A L P H A B É T I Q U E E T R A I S O N N É E
Des ouvrages cités dans les Notes cia Rédacteur.
A
A bo u l f e d ii a ( Ismael) taqouym
ql-b'oldân ( la rectification des contrées
ou des p a y s ) . C’est une géographie
universelle, divisée en sept climats et
par tables, avec des notes qui ne .sont
pas toujours d’une grande exactitude.
Cependant l’auteur a compulsé un grand
nombre de géographes Orientaux , et
même Grecs. Comme on le consulte assez’sou
vent, on me saura peut-être gré
d’indiquer les-portions de cet ouvrage
traduites en langues européennes.
Reiske en a fait une traduction complète
en latin , que Busching a insérée
dans le Y et V I e vol. de son Magasin Fur
die neue. Historié und Géographie.
Hamb. 1770, in-4°. Mais il a supprimé
les degrés de longitude et de latitude, •
et les tables déj à traduites.
Greaves, savant orientaliste anglais,
publia en i 65o une traduction latine de
la description de la Khorasmiç, et du
Maouarâlnahar ( la transoxiane) avec
le texte arabe à la suite des époques célèbres
d’Ulugbeg. Il traduisit aussi VA-
rabie insérée dans les Geographi grec.
Scriptor. minores. La même description
de l’Arabie a été publiée en français par
Laroque, à .la suite du voyage de à’Ar-
vieux (Voyez ce mot ). •
Koehler nous a donné en 1766 une
traduction de la S y r ie , cum excerpib
geographico ex Ibn â'ouardi, geogra-
phia et histria nalurali, âc-. arabe et
latine , in-4 °. La préface et le titre
furent réimprimés avec des additions
en 1786.
Nous devons au docte Michaelis une
excellente traduction de Y Egypte , accompagnée
du texte et de notes savantes.
Gotling. 1776 , in-8°. .
Thcod. Rinck a inséré dans son Ma-
crizi hislor ia regum islamit in A b y s s i-
nia* Lugd. Bat. 1 y go , in-A?., la description
de la Nigritie (Belâdês-Sou-
dân ) d’Aboulfedhâ. Le même savant a
publié Abulfedoe tabulas qucedam geo-
graphicoe, Lipsioe 1791 , mais enarabe
seulement, et sans notes.
Eichhorn a donné aussi une édition
arabe de l’Afrique, à Gotting. en 1791.
On trouvera enfin beaucoup de frag-
mëns d’Aboulfedhâ dans l’index geo-
graphicus de Schultens ad vitam S a la -
dini. Lugd. Bat. 70.
" Gagnier avoit commencé une traduction
complète de cette géographie ,
qu’il n’a pas, terminée ; ce qui ne doit
pas inspirer de vifs regrets, car il ne
savoil que foiblement l’arabe. 11 existe
à la bibliothèque nationale une copie
de cette géographie faite par Schikard,
avec de longs fragmens de traduction
du même érudit.
Aboulfedhâa composé aussi une Histoire
universelle , traduite en latin par
Reiske, et publiée avec des notes considérables
et le texte par M. Adler,,
à Copenhague, 1789-17,94, in-4°. 5
vol. Voyez les citations de cet auteur,
1 .1, p. 437 , t. J I , p. 36o.
Acosta ( Emmanuel ! rerum asocietate
Jesu in oriente gestarumad annum us-
que i 558. Commentarius Dilingoe -/ 5y t .
L e même recueil a été réimprimé à
Cologne en 1674, et. à Anvers en i 6o5,
augmenté d’un V e livre de lettres de
rebus japonicis. T. I I , p. 126, i 48, 278.
Akber. Ayeen akberi or thes ins lit ut es
o f emperor Akber, translated from the
original persian by Francis Gladwin (le
miroir d’Akbar , ou Institutes de l’empereur
Akbar traduits du persan par
F. Gladvvin ). Calcutta, 1783-1786,
in-4°. 5 vol.
Cet ouvrage, unique en son genre ,
est le plus complet et le plus exact que
l’on ait écrit sur l’Inde, sur les antiques
sectateurs de Brahma et sur les Moghols
leurs maîtres. C’est véritablement un
tableau religieux, historique, naturel,
civil et politique de l’Inde ancienne et
moderne , composé par une. société de
gens de lettres , sous les auspices- du
grand moghol Akbar, et rédigé par
Aboulfazel son premier visir , vers
i 5oo de l’ère vulgaire. On peut voir
dans le Magasin encyclopédique, t. I I I ,
p. 486 et suivantes, l ’analyse que j ’en
ai donnée. Quoique le nom de M. Glad-
ivin suffise pour attester l’exactitude
de sa traduction, j ’observerai qu’il a
travaillé sur des textes non exempts de
fautes. Les nombreux tableaux de chiffres
rendent très-difficile la transcription
de cet ouvrage ; et dans toute
l’Inde on n’ën connoissoit qu’un exemplaire
parfait et sans fautes, c’étoit celui
de la bibliothèque du grand Moghol,
écrit pour Akbar lui-même. Cet exemplaire
a été acquis il y a quelques années
au pillage de D eh ly , par un officier
angleis, qui a bien voulu me le
cédeç. T. I , p. 437. T. I I , p. 16 6, 324, 328, 3g a , 434 et 435.
Alphabetum grandonico malabari-
cum, seu sanscrudonicum. Romæ. 1772,
typis sac. congreg. de fide. in- 12 de
200 pag.
L e malabar est une des trois langues
usitées dans la contrée de ce nom , laquelle
s’étend depuis le cap Comorin
jusqu’au royaume de Canary. Cette
langue à cinquante-une lettres radicales
, seize voyelles et 35 consonnes,
dont on forme ensuite des ligatures qui
font monter le nombre des types à
1128. Lés sa vans qui ont approfondi
cette langue y ont reconnu beaucoup
de mots syriaques ou anciens chai-
déens, ce qui prouveroit que la religion
chrétienne y a pénétré autrefois ,
comme le dit formellement Cosmas,
moine égyptien, surnommé Indopleus*
tes, qui écrivoit en 535. En outre, La-
croze assure que les chrétiens Malabars
se servent pour leur liturgie de
caractères très-ressemblans au stran-
ghélo ou ancien syriaque.
Les Malabars préfèrent la poésie à
la prose j, et c’est pour cela que les
poètes chez eux sont très - communs.
Les mots malabars et tamouls ont à-
peu-près les mêmes racines ; mais les
deux caractères sont si différens , que
j ’ai vu un Indien lire couramment le
malabar , et ne pouvoir déchiffrer un
seul mot tamoul. Au reste , toutes ces
langues indiennes ont le sanskrit pour
basé. T . I I , p. 200.
Amyot et Langlès. Dictionnaire Ta-
tar - Mantchou-Français -, traduit d'un
dictionnaire Mantchou - Chinois, par
Amiot, rédigé et publié avec des additions
et l’alphabet de celte langue, par
L.Langlès. Paris, 1787-1790, in-à°. 3 vol.
L e mantchou est le plus savant • de
tous lès idiomes Tatars : il acquiert
chaque jour un nouveau degré d’intérêt
par les nombreuses et fidelles
traductions du Chinois, du Tibétain
&c. dont on ne cesse de l ’enrichir par
ordre même de l’Empereur. Ce prince
d’origine mantchou e , entretient un
nombre d'ë savans traducteurs pour ces
travaux littéçaires, auxquels il croit