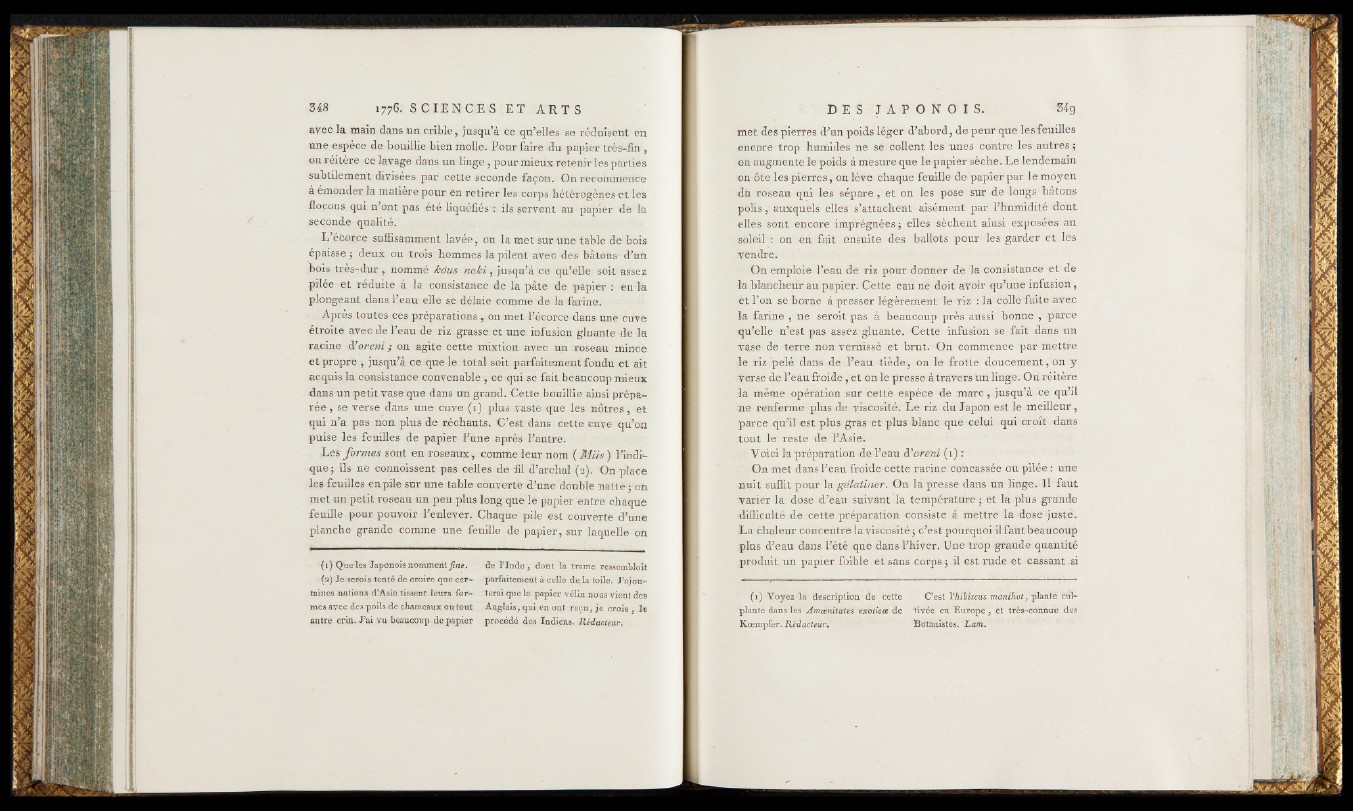
avec la main dans un crible, jusqu’à ce qu’elles se réduisent en
Une espèce de bouillie bien molle. Pour faire du papier très-fin ,
on réitéré ce lavage dans un linge, pour mieux retenir les parties
subtilement divisées par cette seconde façon. On recommence
a emonder la matière pour en retirer les corps hétérogènes et les
flocons qui n’ont pas ete liquéfiés : ils servent au papier de la
seconde qualité.
L ’éfcorce suffisamment lavée, on la met sur une table de bois
épaisse ; deux ou trolshommes la pilent avec des bâtonsi d’un
bois tres-dur , nommé Jcôus nohi, jusqu’à ce qu’elle soit assez
pilée et réduite à la consistance de la pâte de papier : en la
plongeant dans l’ eau elle se délaie comme de la farine.
Après toutes ces préparations , on met l’ écorce dans une cuve
étroite avec de l’eau de riz grasse et une infusion gluante de la
racine à’oreni y on agite cette mixtion avec un roseau mince
et propre , jusqu’à ce que le total soit parfaitement fondu et ait
acquis la consistance convenable , Ge qui se fait beaucoup mieux
dans un petit vase que dans un grand. Cette bouillie ainsi prépa-
r é e , se verse dans une cuve (i) plus vaste que les nôtres, et
qui n’a pas non plus de r.échauts. C’est dans cette cuve qu’on
puise les feuilles de papier l’une après l’autre.
Les formes sont en roseaux, comme leur nom ( Miis ) l’indique;
ils ne connoissent pas celles de fil d’archal (s). On place
les feuilles en pile sur une table couverte d’une double natte ; on
met un petit roseau un peu plus long que le papier entre chaque
feuille pour pouvoir l’enlever. Chaque pile est couverte d’une
planche grande comme une feuille de papier, sur laquelle on
( i) Que’les Japonois nomment fine.
(îa) Jeserois tenté de Croire que certaines
nations d’Asie tissent leurs formes
avec des poils de chameaux où tout
autre crin. J’ai vu beaucoup de papier
de l’Ind e, dont la trame ressémbloit
parfaitement à celle de la toile. J’ajouterai
que le papier vélin nous vient des
Anglais, qui en ont reçu, je crois , le
procédé des Indiens. Rédacteur.
DE S J A P O N O I S .
met des pierres d’un poids léger d’abord, de peur que les feuilles
encore trop humides ne se collent les unes contre les autres;
on augmente le poids à mesure que le papier sèche. Le lendemain
on ôte les pierres, on lève chaque feuille de papier par le moyen
du roseau qui les sépare , et on les pose sur de longs hâtons
polis, auxquels elles s’attachent aisément par l’humidite dont
elles sont encore imprégnées ; elles sèchent ainsi exposées au
-soleil : on en fait ensuite des ballots pour les garder et les
.vendre.
On emploie l’eau de riz pour donner de la consistance et de
la blancheur.au papier. Cette eau ne doit avoir qu’une infusion,
et l’on se borne à presser légèrement le riz : 1a- colle faite avec
la farine , ne seroit pas à beaucoup près aussi bonne , parce
qu’elle n’èst pas assez gluante. Cette infusion se fait dans un
vase de terre non vernissé et brut. On commence par mettre
le riz pelé dans de l’eau tiède, on le frotte doucement, on y
verse de l’eau froide, et on le presse à travers un linge. On réitère
la même opération sur cette espèce de marc, jusqu’à ce qu’il
ne renferme pins de viscosité. Le riz du Japon est le meilleur ,
parce qu’il est plus gras et plus blanc que celui qui croît dans
tout le reste de l’Asie.
Voici la préparation de l’eau i ’oreni (1) :
On met dans l’eau froide cette racine concassée ou pilée : une
nuit suffit pour la gélatiner. On la presse dans un linge. Il faut
varier la dose d’eau suivant la température ; et la plus grande
difficulté de cette préparation consiste à mettre la dose juste.
La chaleur concentre la viscosité; c’est pourquoi il faut beaucoup
plus d’eau dans l’été que dans l’hiver. Une trop grande quantité
produit un papier foible et sans corps; il est rude et cassant si
(x) Voyez la description de cette
plante dans les Amoenitat'eà exotic æ de
Kcempfer. Rédacteur»
C’est l’hibiscus mantkot, plante cultivée
en Europe, et tîès-connue des
Botanistes. Lam.