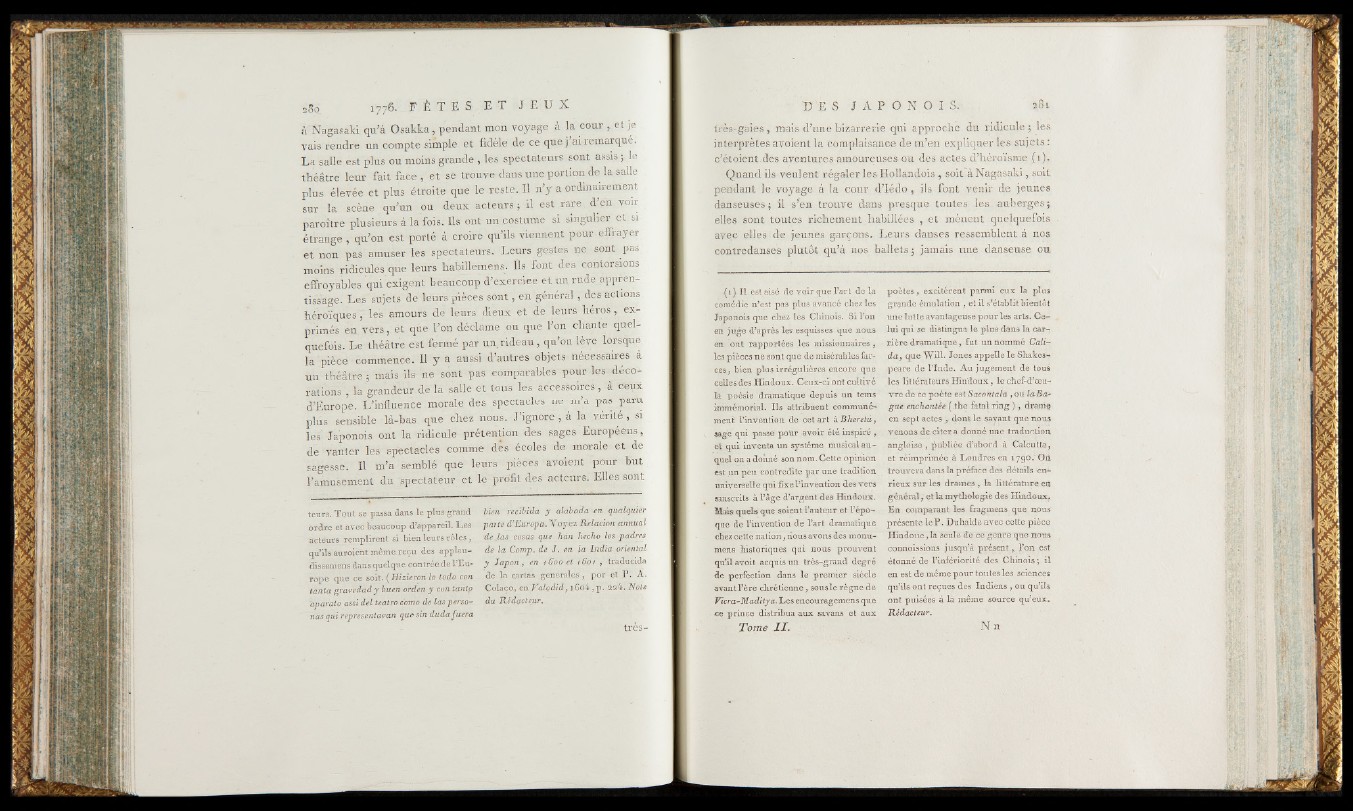
â Nagasaki, qu’à Osakka, pendant mon voyage à la cour et je
vais rendre un compte simple et fidèle de ce que j ai remarqué.
La salle est plus ou moins grande , les spectateurs sont assis ; le
théâtre leur fait face , et se trouve dans une portion de la salle
plus élevée et plus étroite que le reste. Il n’y a ordinairement
sur la scène qu’un ou deux acteurs 5 il est rare d’en voir
paroître plusieurs à la fois. Ils ont un costume si singulier et si
étrange, qu’on est porté à croire qu’ils viennent pour effrayer
et non pas amuser les spectateurs. Leurs gestes ne sont pas
moins ridicules que leurs habillemens. Ils font des contorsions
effroyables qui exigent beaucoup d’exercice et un rude apprentissage.
Les sujets de leurs pièces sont, en général , dés actions
héroïques j les amours dé leurs dieux et de leurs héros , exprimés
en vers, et que l’on déclame ou que l’on chante quelquefois.
Le théâtre est fermé par un.rideau, qu’on lève lorsque
la pièce commence. Il y a aussi d’autres objets nécessaires à
un théâtre 5 mais ils ne sont pas comparables pour les déco^
rations , la grandeur de la salle et tous lés accessoires , a ceux
d’Europe. L ’influence morale des spectacles ne -m’a pas paru
plus sensible là-bas -que chez nous. J’ignore , à la vérité , si
les Japonois ont la ridicule prétention des sages Européens,
de vanter les, spectacles comme des écoles de morale et de
sagesse: Il m’ a semblé que leurs pièces «voient pour but
l ’amusement du spectateur et le profit des acteurs. Elles sont
teurs. Tout se passa dans le plus grand
ordre et avec beaucoup d’appareil. Les
actëurs remplirent si bien leurs rôles,
qu’ils auroïent même.reçu des applau-
dissemens dans quelque contrée de l’Europe
que ce soit. ( Hizieron lo todo con
tanta gravedad y buen orden y con tantp
aparato assi del teatro como de las perso-
nas qui represeritavan quesin dudafuera
bien recihida y alabada en qualquier
parte d’Europa. Voyez Relacion annual
de ja s cosas que hem liecho los padres
de la Comp, de J. en la India oriental
y Japon,, en 1600 et i6o i , traducida
de la cartas generales, por et P. A.
Colaco, en Valodid, i 6d4 , p. 224. Note
du Redacteur.
trèstrès
gaies , mais d’une bizarrerie qui approche du ridicule 5 les
interprètes avoient la complaisance de m’en expliquer les sujets :
c’étoient.des aventures amoureuses ou des actes d’héroïsme (1).
Quand ils-veulent régaler les Hollandois , soit à Nagasaki, soit
pendant le voyage à la cour d’Iédo, ils font venir de jeunes
danseuses; il s’en trouve dans presque toutes les,, auberges ;
elles sont toutes richement habillées , et mènent quelquefois
avec elles de jeunes garçons. Leurs danses ressemblent à nos
contredanses .plutôt qu’à nos ballets; jamais une danseuse ou
/1 ) I l est aisé de voir que .l’art de la
comédie n’est pas plus avancé chez les
Japonois que chez les Chinois. Si l’on
en juge d’après les esquisses que nous
en ont rapportées les missionnaires,
les pièces ne sont que de misérables farces.,
bien plus irrégulières encore que
celles des Hindoux. Ceux-ci ont cultivé
la poésie dramatique depuis un tems
immémorial. Ils attribuent commune'
ment l’invention de cet art à Bheretu,
sage qui passe pour avoir été inspiré ,.
et qui inventa un système musical auquel
on a donné son nom. Cette opinion
est un peu contredite par une tradition
universelle qui fixe l ’invention des vers
sanscrits à l’âge d’argent des Hindoux.
Mais quels que soient l’auteur e t l’époque
de l’invention de l’art dramatique
chez cette nation, nous avons des monu-
mens historiques qui nous prouvent
qu’i l avoit acquis un très-grand degré
de perfection dans le premier siècle
avant l ’ère chrétienne, sous le règne de
Vicra-Maditya. Les encouragemens que
ce prince distribua aux savans et aux
Tome I I .
poètes, excitèrent parmi eux la plus
grande émulation , et il s”élablit bientôt
une lutte avantageuse pour les arts. Celui
qui se dis tingua le plus dans la carrière
dramatique , fut un nommé Cali-
da y que W ill. Jones appelle le Shakespeare
de l’Inde. Au jugement de tous
les littérateurs Hindoux, le chef-d’oeuvre
de ce poète est Sacontala , ou laBa-
gue enchantée (.the fatal ring) , dramg
en sept actes , dont le savant que nous
venons de citer a donné une traduction
anglaise, piîbliée d’abord à Calcutta,
et réimprimée à Londres en 1790.' Oii
trouvera dans la préface des détails curieux
sur les drames , la littérature en
général, et la mythologie des Hindoux.
En comparant les fragmens que nous
présente le P. Duhalde avec celte pièce
Hindoue, la seule de ce genre que nous
connoissions jusqu’à présent.,. l’on est
étonné de l ’infériorité des Chinois ; il
en est de même pour toutes les sciences
qu’ils ont reçues des Indiens, ou qu’ils
ont puisées à la même source qu’eux.
Rédacteur.
N n