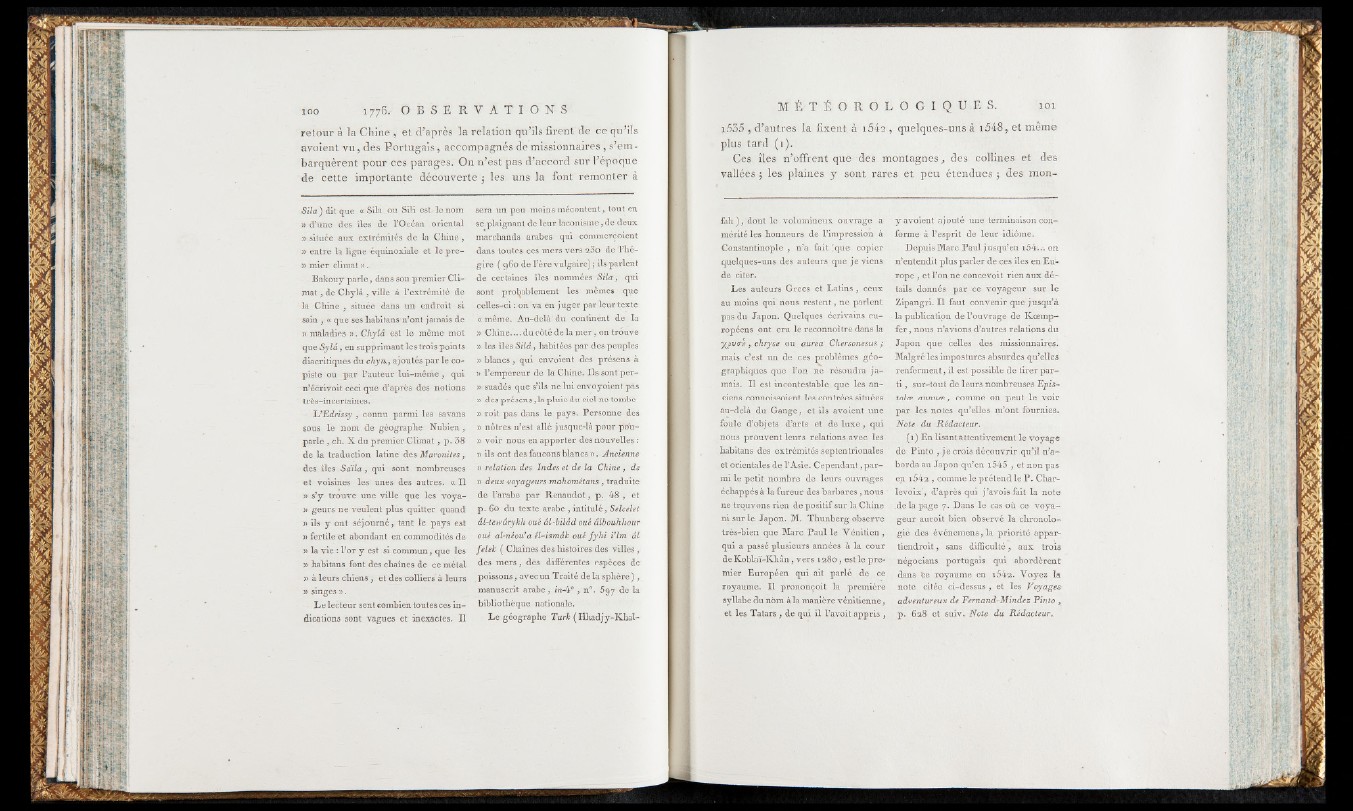
retour à la Chine, et d’après la relation qu’ils firent de ce qu’ils
avoient vu, des Portugais, accompagnés démissionnaires , s’embarquèrent
pour ces parages. On n’est pas d’accord sur l’époque
de cette importante découverte ; les uns la font remonter à
Sita ) dit que « Sila ou Siti est-le nom
» d’une des îles de l’Océan oriental
» située aux extrémités de la Chine,
)> entre la ligne équinoxiale et le pre-
» mier climat »..
Bakouy parle, dans son premier Climat
, de Chylâ , ville à l ’extrémité de
la Chine , située dans un endroit si
sain ,. « que ses habitans n’ont jamais de
» maladies ». Chylâ est le même mot
que Sylâ, en supprimant les trois points
diacritiques du chyn, ajoutés par le copiste
ou par l’auteur lui-même, qui
n’écrivoit ceci que d’après des notions
très-incertaines.
JJEdrissy , connu parmi les savans
sous le nom de géographe Nubien
parle, ph. X du premier C limat, p. 38
de la traduction latine des Maronites,
des îles Sdila., qui sont nombreuses
et voisines les unes des autres, et II
»• s’y trouve une ville que les voyageurs
ne veulent plus quitter quand
» ils y ont séjourné, tant le pays est
» fertile et abondant en commodités de
» la vie : l ’or y est si commun, que les
» habitans font des chaînes de ce métal
» à leurs chiens , et des colliers à leurs
» singes ».
L e lecteur sent combien toutes ces indications
sont vagues et inexactes. H
sera un peu moins mécontent, tout en
se plaignant de leur laconisme, de deux
marchands arabes qui commerçoient
dans toutes ces mers vers 23o de l ’hégire
( 960 de l’ère vulgaire) j ils parlent
de certaines îles nommées Sila, qui
sont probablement- les mêmes qpe
celles-ci : on va en juger par leur texte
«même. Au-delà du continent de la
» Chine.... du côté de la mer, on trouve
» les îles Sila, habitées par des peuples
» blancs, qui envoient des présens à
» l’empereur de la Chine. Ils sont per-
» suadés que s’ils ne lui envoyoient pas
» des présens ,1a pluie du ciel ne tombe-
» roit pas dans le pays. Personne des
» nôtres n’est allé jusque-là pour pou-
» voir nous en apporter des nouvelles :
» ils ont des faucons blancs ». Ancienne
» relation des Indes et de la Chine, de
» deux voyageurs mahomètans, traduite
de l ’arabe par Renaudot, p. 48 , et
p. 60 du texte arabe , intitulé, Selcelet
âl~tewâryhh oué âl-bilâd ouê âlhouhhour
oué al-nêou3a êl-ismâk oué fyhi i’im âl
felek ( Chaînes des histoires des v illes,
des mers, dès différentes espèces de
poissons, avec un Traité de la sphère) ,
manuscrit arabe, in-4° , n°. 597 de la
bibliothèque nationale.
Le géographe Turk (Hhadjy-Khali
535 , d’autres la fixent à i 542 , quelques-uns à 1548, et meme
plus tard (1).
Ces îles n’offrent que des montagnes, des Gdllines et des
vallées ; les plaines y sont rares et peu étendues ; des monfah
) , dont le volumineux ouvrage a
mérité les honneurs de l’impression à
Constantinople , n’a fait '.que copier
quelques-uns des auteurs que je viens
de citer.
Les auteurs Grecs et Latins , ceux
au moins qui nous réstent, ne parlent
pas du Japon. Quelques écrivains européens
ont cru le reconnoitre dans la
‘fcpvcrn, chryse ou aurea Chersonesus ;
mais c’est un de ces problèmes géographiques
que l’on ne résoudra jamais.
Il est incontestable que les anciens
connôissoient les contrées situées
au-delà du Gange, et ils avoient une
foule d’objets d’arts et de lu x e , qui
nous prouvent leurs relations avec les
habitans des extrémités septentrionales
et orientales de l’Asie. Cependant, parmi
le petit nombre de leurs ouvrages
échappés à la fureur des barbares, nous
ne trouvons rien de positif sur la Chine
ni sur le Japon. M. Thunberg observe
très-bien que Marc Paul le Yénitien ,
qui a passé plusieurs années à la cour
de Koblaï-Khân, vers 1280, est le premier
Européen qui ait parlé de ce
royaume. I l prononçoit la première
syllabe du nom à la manière vénitienne,
et les Tatars, de qui il l’avoit appris ,
y avoient ajouté une terminaison conforme
à l ’esprit de leur idiome.
Depuis Marc Paul jusqu’en i 54;.-. on
n’entendit plus parler de ces îles en Europe
, et l’on ne concevoit rien aux détails
donnés par ce voyageur sur le
Zipangri. Il faut convenir que jusqu’à
la publication de l’ouvrage de Koemp-
fe r , nous n’avions d’autres relations du
Japon que celles des missionnaires.
Malgré les impostures absurdes qu’elles
renferment, il est possible de tirer parti
, sur-tout de leurs nombreuses Epis-
toloe annuæ, comme on peut le voir
par les notes qu’elles m’ont fournies.
Note du Rédacteur.
(1) En lisant attentivement le voyage
de Pinto , j e crois découvrir qu’il n’aborda
au Japon qu’en i 545 , et non pas
en i 542 , comme le prétend le P. Char-
levôix’, d’après qui j ’avois fait la note
.de la page 7. Dans le cas où ce voyageur
auroit bien observé la chronologie
des événemens, la priorité appar-
tiendroit, sans difficulté, aux trois
négocians portugais qui abordèrent
dans te royaume en i 542. Voyez la
noté citée ci-dessus , et les Voyages
adventureux de Fernand-Mindez Pinto ,
p. 628 et suiv. Note du Rédacteur