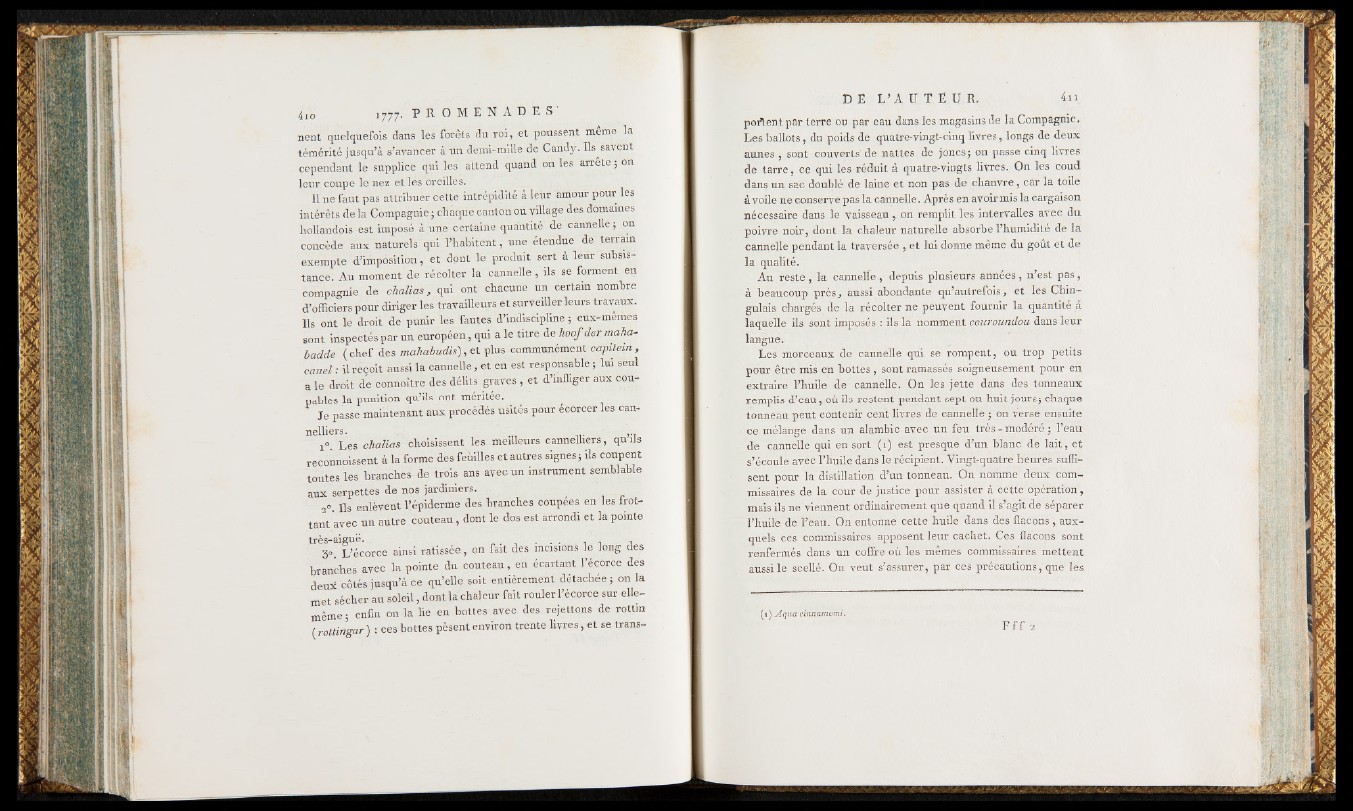
4 îo 1777’ P R O M E N A D E S
nent quelquefois dans les forêts du roi, et poussent meme la
témérité jusqu’à s’avancer à un demi-mille de Candy. Hs^savent
cependant le supplice qui les attend quand on les arrête ; on
leur coupe le nez et lés oreilles.
Il ne faut pas attribuer cette intrépidité à leur amour pour les
intérêts de la Compagnie ; chaque canton ou village des domaines
hollandois est imposé à une certaine quantité de cannelle; on
concède aux naturels qui l’habitent, une étendue de terrain
exempte d’imposition, et dont le produit sert à leur subsistance.
Au moment de récolter la cannelle , ils se forment en
compagnie de chalias, qui ont chacune; un certain nombre
d’officiers pour diriger les travailleurs et surveiller leurs travaux.
Ils ont le droit de punir les fautes d’indiscipline ; eux-mêmes
sont inspectés par un européen, qui a le titre de hoofder maha-
badde (chef des mahabudis) , et plus communément capitein ,
canel : il reçoit aussi la cannelle , et en est responsable ; lui seul
a le droit de connoître des délits graves , et d’mffiger aux coupables
la punition qu’ils ont méritée.
Je passe maintenant aux procédés usités pour écorcer les cannelliers.
i° Les chalias choisissent les meilleurs cannelliers, qu ils
reconnoissent à la forme des feùilles et autres signes; ils coupent
toutes les branches de trois ans avec un instrument semblable
aux serpettes de nos jardiniers.
2°. Es enlèvent l ’épiderme des branches coupées en les frottant
avec u n autre couteau, dont le dos est arrondi et la pointe
très-aiguë. . . . . , H
g» L’écorce ainsi ratissée, on fait des incisions le long des
branches avec la pointe du couteau, en écartant l ’écorce des
deux côtés jusqu’à ce qu’ elle soit entièrement détachée ; on la
met sécher au soleil, dont là chaleur fait rouler l’écorce sur elle-
même; enfin on la lie en bottes avec des rejettons de rottin
( rottingar ) : ces bottes pèsent environ trente livres, et se trans-
D E L’ A U T E U R .
portent par terre ou par eau dans les magasins de la Compagnie.
Les ballots, du poids de quatre-vingt-cinq livres, longs de deux
aunes , sont couverts' de nattes de joncs; on passe cinq livres
de tarre, ce qui les réduit à quatre-vingts livres. On les coud
dans un sac doublé de laine et non pas de chanvre, car la toile
à voile ne conserve pas la cannelle. Après en avoir mis la cargaison
nécessaire dans le vaisseau, on remplit les intervalles avec du
poivre noir, dont la chaleur naturelle absorbe l’humidité de la
cannelle pendant la traversée , et lui donne même du goût et de
la qualité.
Au reste, la cannelle, depuis plusieurs années, n’est pas,
à beaucoup près, aussi abondante qù’autrefois, et les Chin-
gulais chargés de la récolter ne peuvent fournir la quantité à
laquelle ils sont imposés : ils la nomment couroundou dans leur
langue.
Les morceaux de cannelle qui se rompent, ou trop petits
pour être mis en bottes, sont ramassés soigneusement pour en
extraire l’huile de cannelle, On les jette dans des tonneaux
remplis d’eau, où ils restent pendant sept ou huit jours; chaque
tonneau peut contenir cent livres de cannelle ; on verse ensuite
ce mélange dans un alambic avec un feu très-modéré; l’eau
de cannelle qui en sort (î) est presque d’un blanc de lait, et
s’écoule avec l’huile dans le récipient. Vingt-quatre heures suffisent
pour la distillation d’un tonneau. On nomme deux commissaires
de la cour de justice pour assister à cette opération,
mais ils ne viennent ordinairement que quand il s’agit de séparer
l ’huile de l’ eau. On entonne cette huile dans des flacons , auxquels
ces commissaires apposent leur cachet. Ces flacons sont
renfermés dans un coffre où les mêmes commissaires mettent
aussi le scellé. On veut s’assurer, par ces précautions, que lès (i)
(i) Aqua cinnamomi.
F f f 2