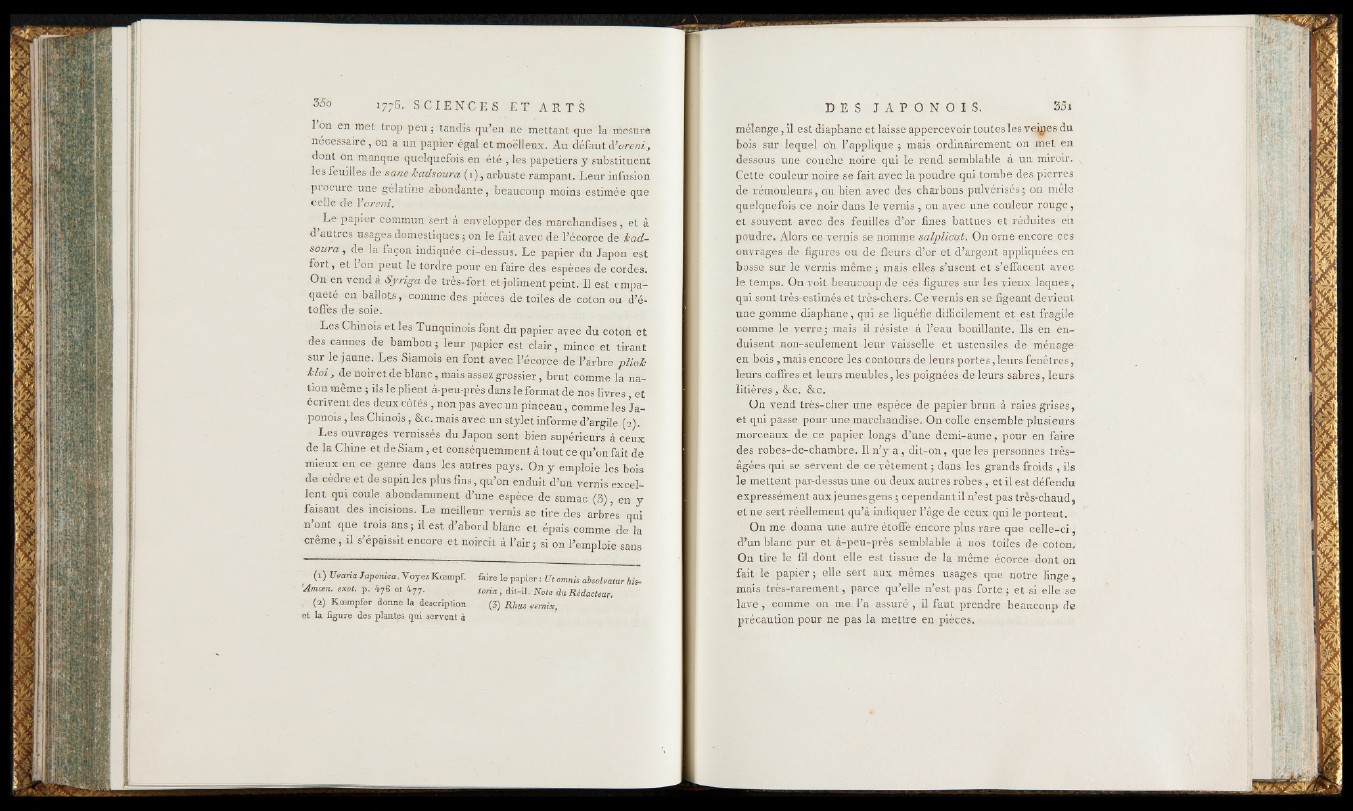
Ion en met trop peu; tandis qu’en ne mettant que'la mesure
nécessaire , on a un papier égal et moelleux. Au défaut d’oreni,
dont on manque quelquefois en été , les. papetiers y substituent
les feuilles de sanelcadsoura (i)-, arbuste rampant. Leur infusion
procure une gélatine abondante, beaucoup moins estimée que
celle de l’oreni.
Le papier commun sert à envelopper des marchandises, et à
d’autres usages domestiques ; on le'fait avec de l’écorce de had-
soura, de la façon indiquée ci-dessus. Le papier du Japon est
fort, et l’on peut le tordre pour en faire des espèces de cordes.
On en vend à Sjriga de très-fort et joliment peint. Il est empaqueté
en ballots, comme des piècès de toiles de coton ou d’étoffes
de-soie.
;Les Chinois et les Tunquinois font du papier avec du coton et
des cannes de bambou; leur papier est clair, mince et tirant
sur le jaune. Les Siamois en font avec l’écorce de l’arbre pliok
k lo i, de noir et de blanc, mais assez grossier, brut comme la nation
même ; ils le plient à-peu-près dans le format de nos livres , et
écrivent des deux côtés , non pas avec un pinceau, comme les Ja-
ponois, les Chinois, &c. mais avec un stylet informe d’argile,(2).
Les ouvrages vernissés du Japon sont bien supérieurs à ceux
de la Chine et de Siam, et conséquemment à tout ce qu’on fait de
mieux en ce genre dans les autres pays. On y emploie les bois
de cèdre et de sapin les plus fins-, qu’on enduit d’un vernis excellent
qui coule abondamment d’une espèce de sumac (3), en y
faisant des incisions. Le meilleur vernis' se- tire des arbres qui
n’ont que trois ans; il est d’abord blanc et épais comme de la
crème, il s’épaissit encore et noircit à l’ air ; si on l’emploie sans * •
(1) Vvaria Japonica. Voyez Koempf. frire le papier : Ut omnis absolvatur his-
Amoen. exot. p. 476 et 477. toria , dil-il. Note du Rédacteur.
• (2) Koempfer donne la description (3) Rhus yemix.
et la figure des plantes qui servent à
mélange, il est diaphane et laisse appercevoir toutes les vqijjes du
bois sur lequel on l’applique; mais ordinairement on met en
dessous une couche noire qui le rend semblable à un miroir.
Cette couleur noire se fait avec la poudre qui tombe des.pierres
de rémouleurs, ou bien avec des charbons pulvérisés; on mele
quelquefois ce noir dans le vernis , ou avec une couleur rouge,
et souvent avec des feuilles d’or fines battues et réduites en
poudre. Alors ce vernis se nomme salplicat. On orne encore ces
ouvrages de figures ou de fleurs d’or et d’argent appliquées en
bosse sur le vernis même ; mais elles s’usent et s’effacent avec
le temps. On voit beaucoup de cés figures sur les vieux laques,
qui sont très-estimés et très-chers. Ce vernis en se figeant devient
une gomme diaphane, qui se liquéfie difficilement et est fragile
comme le verre; mais. il résiste à l’eau bouillante. Ils en enduisent
non-seulement leur vaisselle et ustensiles de ménage
en bois , mais encore,les contours de leurs portes,leurs fenêtres,
leurs coffres et leurs meubles, les poignées de leurs sabres, leurs
litières, &c. &c.
On vend très-cher une espèce de papier brun à raies grises,
et qui passe pour une marchandise. On colle ensemble plusieurs
morceaux de ce papier longs d’une demi-aune, pour en faire
des robes-de-chambre. Il n’y a , dit-on, que les personnes très-
âgées qui se servent de ce vêtement ; dans les grands froids , ils
le mettent par-dessus une ou deux autres robes , et il est défendu
expressément aux jeunes gens ; cependant il n’est pas très-chaud,
et ne sert réellement qu’à indiquer l’âge de ceux qui le portent.
On me donna une autre étoffe encore plus rare que celle-ci,
d’un blanc pur et à-peu-près semblable à nos toiles de coton.
On tire le fil dont elle est tissue de la même ë'corce-dont on
fait le papier ; elle sert aux mêmes usages que notre linge,
mais très-rarement, parce qu’elle n’est pas forte; et si elle se
lave , comme on me l’ a assuré , il faut prendre beaucoup de
précaution pour ne pas la mettre en pièces.