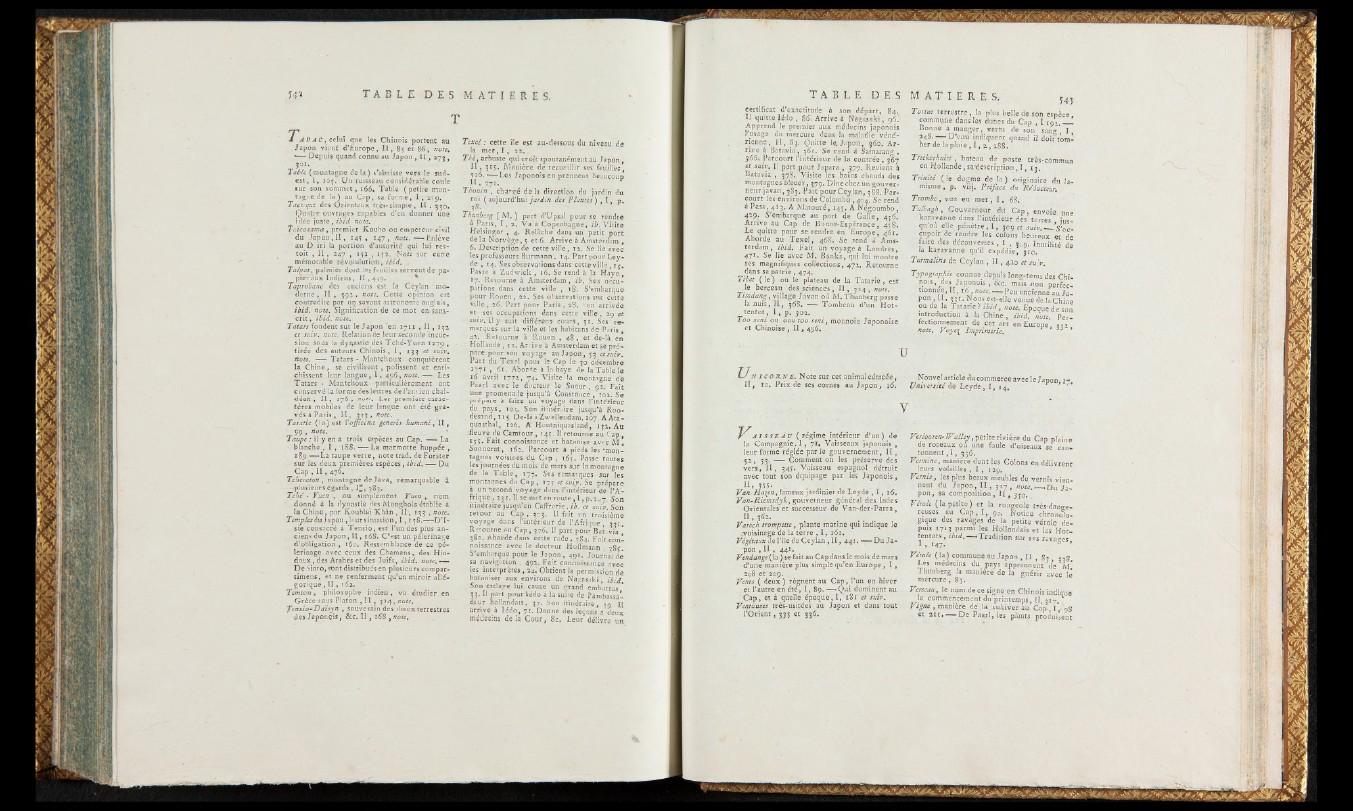
T a b a c , celui que les Chinois portent au
Japon vient d’Europe, II, 85 et 86, n o te .
■— Depuis quand connu au Japon ,11,275,
3Q Ï -.
T a b le (montagne de la) s’abaisse vers le sud-
est, I, ià5. Un ruisseau considérable coule
sur son sommet, 166. Table (petite montagne
de la ) au Cap, sa forme, I , 2*9.
T a c tiq u e des Orientaux très-simple, II . 350.
Quatre ouvrages capables d’en donner une
idée juste, ib id . n o te .
T cL co sam a , premier Kouho ou empereur civil
du Japon, II, 145 , 147, n o t e .—— Enlève
au D ïri la portion d’autorité qui lui res-
toit , II , 247 , 15'j , 152. Noie sur cette
mémorable révolulution, I b id . ,
T a L v a t, palmier dont-lesfeuill.es servent de papier
aux Indiens, 11,449. %
T a p ro b a n e des anciens est la Ceylan ' moderne
, II , 392, nope. Cette opinion est
contredite par un savant astronome anglais,
i b id . n o te . Signification de ce mot en sanscrit,
ib id . note .
.T a tar s fondent sur le Japon 'en 1711 , II , 132
e t s u iy . n o te . Relation de leur seconde incursion
sous la .dynastie des Tché-Yuen 1279 ,
tirée des auteurs Chinois, 1 , 131 e t su iv .
n o te . —- Tatars - Mantchoux conquièrent
la Chine, se civilisent , polissent et enrichissent
leur langue, I , 496, n o te . — Les
Tatars - Mantchoux particulièrement ont
conservé la forme des lettres de l’amien chal-
déen , II, 176 , n o t e . L e s premiers caractères
mobiles de leur langue ont été graves
à Paris , II, 533 , n o te .
T a ta r ie (la) est V o j jic in a g en er is h um a n i, II,
99 , n o t e . " .
T a u p e : il y en a trois espèces au Cap. — La
• blanche , I , 188. — La marmotte huppée ,
189.—— La taupe verte, note trad. de Forster
sur les deux premières espèces, ib id . •— Du
Cap , I l , 476.
T f h e r a t o n , montagne de Java, remarquable à
-plusieurs égards , 1“, 3-83,
T ç h c Y u e n , ou simplement Y u e n ,_nom
donné à la dynastie des Monghols établie à
. la Chine, par Koublaï-XMn , II, 133 , n o te .
Tem p le s du Japon, leur situation, 1 ,158.— D’I-
sie consacré à Tensio, est-l’un des plus anciens
du Japon, II, 168. C’est un pèlerinage
d’.obligation , 16e. Ressemblance de ce pèlerinage
avec ceux des Chamans, des Hin-
doux, des Arabes et des Juifs, i b id . n o t e .—
De Sinto, sont distribués en plusieurs compar-
timens, et ne renferment .qu’un miroir allégorique
, II, 162.
T em tem , philosophe indien', va étudier en
Grèce sous Platon , I I , 334, note .
J 'e n s io -D tü s y n , souverain des dieux terrestres
des Japoncis, &c. II, 168,720«.
T e x e l ; cette île est au-dessous du niveau de
la mer,l, 22.',
T h é , arbuste qui croît spontanément au Japon,
11 , 313. Manière de recueillir ses' feuilles,
316. — Les Japonois en prennent beaucoup
11,271.
T h o u in , changé de la direction du jardin du
T°i ( aujourd’hui ja r d in d e s P la n te s ) I p.
Thu nberg ( M. ) part d’Upsal pour se rendre
à Paris, I, 2. Va à Copenhague, ib . Visite
Helsingor , 4. Relâche dans un petit port
delà Norvège, 3 et 6. Arrive à Amsterdam ,
6. Description de cette ville, 12. Se lie avec
les professeurs Burmann, 14. Part pour Lèy-
de , 14. Ses observations dans cette ville , 1 y.
Passe à Zudwick , 16. Se rend à la Haye,
17- Ret.ourne à Amsterdam, i b . Ses occupations
dans cette ville , 18. S’embarque
pour Rouen, 22. S.es observations sur cette
ville, 26. Part pour Paris , 28. Son arrivée
et ses occupations dans cette ville, 29 et
s u iy . Il y suit difrérens cours, 31. Ses remarques
sur la ville et les habitans de Paris ,
42. Retourne à Rouen , 48, et de-là en
Hollande, s 2. Arrive à Amsterdam et sè prépare
pour son voyage au Japon, 33 et s u iv .
Part du Texel pour le Cap le 30 décembre
1771 , 6 1 . Aborde à la baye d.e la Table le
1 6 avril 1772, 74. Visite la montagne' de
Paarl avec le docteur le Sueur, 92. Fait
une promenade jusqu’à Constance , 102..Se
prépare à faire un voyage dans l’intérieur
du pays , ioy. Son itinéraire'jusqu’à Roo-
desand ,115. De-là à Zwellendam, 107. A Ata-
quasthal, 126. A Houtniquasland, 132. Au
fleuve de Camtour , 145. Il retourne au Cap ,
135. Fait connoissàncé et botanise avec M,
Sonnerat, 162. Parcourt à pieds les'montagnes
voisines du Cap , 1.65. Passe toutes
les journées dü mois de mars sur la montagne
de la Table, 177. Ses remarques sur les
montagnes du Cap , 173 et su iy . Se prépare
à un'second voyage dans l’intérieur de l’Afrique
, 235. Il se met en route , l , p. 247. Son
itinéraire jusqu’en Caffrerie, ib . et su iv . Son
retour au Cap , 303. 11 fait un troisième
voyage dans l’intérieur de l’Afrique , 331.
Retourne aù Cap, 376. Il part pour Bat« via
380. Aborde dans cette rade ,„384. Fait con-
noissarice avec le docteur Hoffmann , 38«.
S’embarque pour le Japon, 491. Journal-dé
sa navigation . 492. Fait çonnoissançe avec
les interprètes , 24; Obtient la permission de
bofaniser aux environs de Nagasaki, ib id
Son esclaye lui cause un grand embarras *
33. Il part pour lédo à la suite de l’ambassadeur
hollandais, 37. Son itinéraire, 39. II
arrive à lédo, 71. Donne des leçons à deux
médecins delà Cour, 82. Leur délivre un
certificat d’exactitude à son départ, 84.
Il quitte lédo , 86. Arrive à Nagasaki, 96.'
Apprend le premier aux médecins japonois
l’usagé du mercure dans la maladie vénérienne,
II, §3. Quitte le. Japon, 360. Ar-
rive à Bàtavia, 36t. Se rend à Safnarang .
366; Parcourt l’intérieur de la contrée , 367
e t s u iv . 11 part pour Japara , 377. Revient à
Batavia , 378. Visite les bains chauds des
montagnes bleues, 379. Dîne chez un gouverneur
javan, 383. Part pour Ceylan, 388. Parcourt
les environs de Colombô ,404. Se rend
à Pass, 413. A Matouré, Ï45.. A Négoumbo,
429. S’embarque au port de Galle, 4y6.
Arrive au Cap de Bonne-Espérance., 438.
Le quitte pour se rendre en Europe, 461.
Aborde au Texel, 468. Se rend à Amsterdam
, ib id . Fait un voyage à Londres,
471. Se lie avec M. Banks, qui lui montre
ses magnifiques collections, 472. Retourne
dans sa patrie , 474.
T ib e t (le) ou le plateau de la Tatarie, est'
le berceau des sciences , I l, 324 , n o te .
T im d a n g , village Javan où M. Thunberg passe
la nuit, II, 368. —— Tombeau d’un Hottentot
, 1, p. 302.
T o o s e n t ou o o u to o s e n i , monnoie Japonoise
et Chinoise , I I , 496.
T o r tu e terrestre, la plus belle de son espèce,
■ commune dans les dunes du Cap , I 191.__
Bonne à manger, vertu de son sang, I,
248. — D’eau indiquent .quand il doit tomber
de la pluie , 1,2 ,2S8.
T r e c k s c h u i t t , bateau de poste très-commun
en Hollande,satlescription, I, 13.
T r in i t é (le dogme de la ) originaire du la-
misme, p. viij. P r é fa c é du Rédacteur.
T r om b e , vue en mer, 1 , 68.
T u lb a g h , Gouverneur dit Cap, envoie une
karayanne dans l’intérieur dés terres jusqu’où
elle pénètre, 1 , 309 et s u iv ._S oc-'
cupoit de rendre lés colons’ heureux et dé
faire.des découvertes , 1 , 3^9. Inutilité de
la karavanne qu’il expédie, jro.
T u rm a lin s de Ceylan , II, 420 et s u iv .
T y p og ra p h ie connue depuis long-tems des Chinois,
des Japonois, 8cc. mais non perfectionnée,
II, 16 n o te . — . Peu ancienne au Japon
II, 331. Nous est-elle venue dé la Chine
ou de la Tatarie ? i b i d , n o te . Epoque de son
introduction à la Chine, i b id . n o te . Perfectionnement
de cet art en Europe Î5 2
n o te . V o y e { Im p r im e rie . , . ’
U N i c O R N E. Note sur cet animal cétacée,
ira 10. Prix de ses cornes au Japon, 16 . Nouvel article du commerce avec le Japon 1
U n iv e r s it é de Leyde, I, 14.
V , 1 s se Âu (régime intérieur d’un) de
la Compagnie, I, 71, Vaisseaux japonois ,
leur forme réglée par le gouvernement, II,
.52, 53. — Comment on les préserve des
vers, II, 343. Vaisseau espagnol détruit
avec tout son équipage par. les. Japonois,
H, 355- •. , . . . ’ ;
V a n -H a ty n , fameux jardinier de Leyde , 1 , 16.
V a n -R iem s d y k , gouverneur général des Indes
Orientales et successeur de Van-der-Parra,
II, 362.
V a r e ch trompette , plante marine qui indique le
„voisinage de la terre , I, 161.
V ég é ta u x de l’île de Ceylan, II, 441. *— Du Japon
y H , 441. -
Ven d a n g e (la) se fait au Cap dans le mois de mars
d’une manière plus simple qu’en Europe , I ,
208 et 209. ,
V e n t s ( deux ) régnent au Cap, l’un en hiver
et l’autre en été, I, 89.—— Qui dominent au
Cap, et à quelle époque , 1, 181 et su iv .
V en to u se s très-usitées au Japon et dans tout
l’Orient ,333 et 336.
V e r lo o r e n -W a l le y , petite rivière du Cap pleine
de roseaux où une foule d’oiseaux se can*
tonnent, 1 , 336.
V e rm in e , manière dont les Colons en délivrent
leurs volailles , I , 129.
V e r n i s , lesplus beaux meubles dé vernis viennent
du Japon, II, 327', .n o t e , __,£)u Japon,
sa composition, I l , gyo.
V é ro le (la petite) et la rougeole très-dangereuses
au Cap , 1, 90. Notice chronologique
des ravages de la petite vérole depuis
1713 parmi les Hollandais et les Hottentots,
i b i d .—-*Tradition sur ses ravages
I ,147. . 5 '
V é r o le ( la) commune au Japon , II , g, j
Les médecins du^ pays apprennent de M.
Thunberg la manière de la guérir avec le
mercure, 83.
V ir s e a u , le nom de ce signe en Chinois indique
le commencement du printemps, II, 317.^
V ig n e , manière dé .la ..cultiver- au- Cap , Ip S
et 2H. — De Paarl, les plants produisent