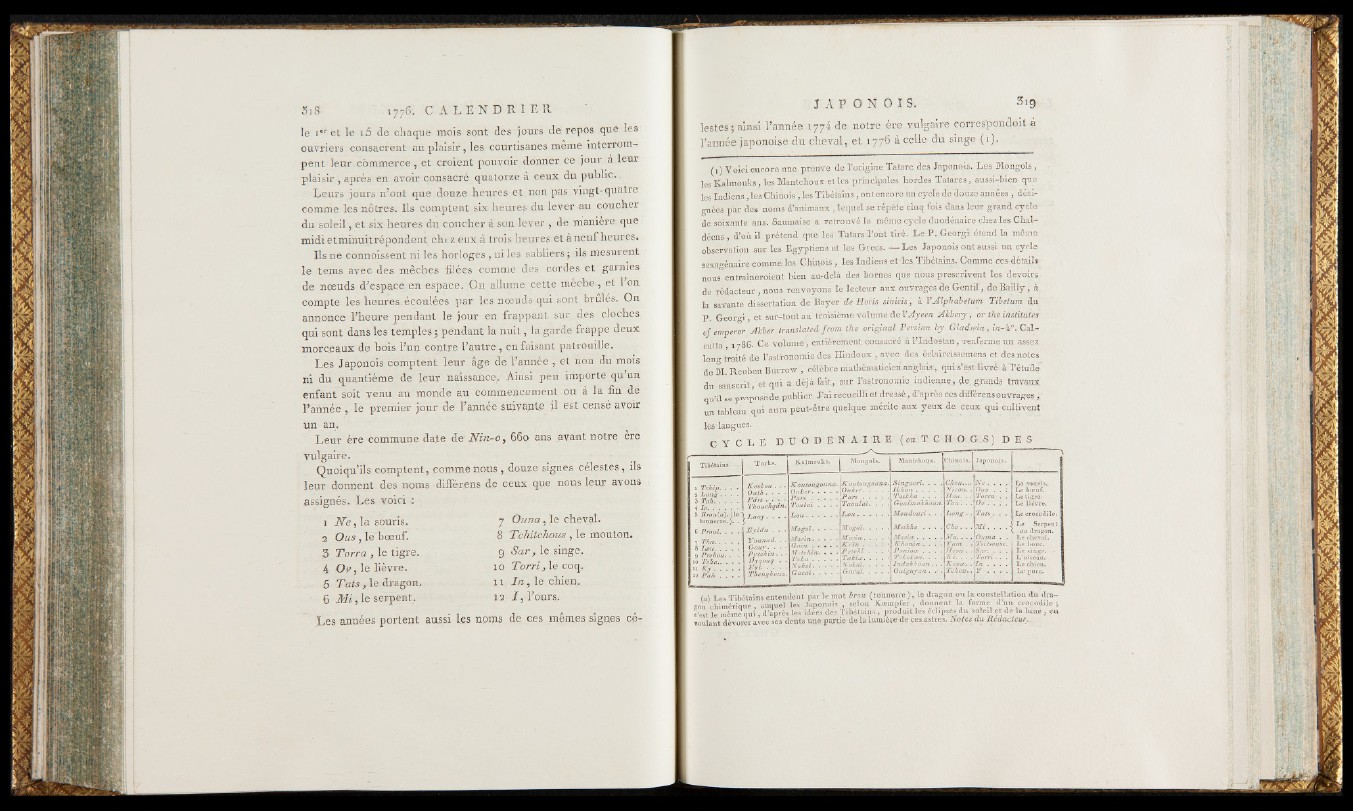
le 1" et le i5 de chaque mois sont des jours de repos que les
ouvriers consacrent au plaisir, les courtisanes mèmè interrompent
leur commerce, et croient pouvoir donner ce jour à leur
plaisir , après en avoir consacré quatorze à ceux du public..
Leurs jours n’ont que douze heures et non pas vingt-quatre
comme les nôtres. Ils comptent six heures,du lever au coucher
du soleil, et six heures du coucher à son lever , de maniéré que
midi etminuitrépondent chtz eux à trois heures et àneuf heures.
Ils ne connoissent ni les horloges , ni les sabliers ; ils mesurent
le tems avec des mèches filées comme des cordes et garnies
de noeuds d’espace en espace. On allume cette mèche, et 1 on
compte les heures.écoulées par les noeuds qui sont brûlés. On
annonce l’heure pendant le jour en frappant sur dés cloches
qui sont dans les temples ; pendant la nuit, la garde frappe deux
morceaux de bois l’un contre l’autre , en faisant patrouille.
Les Jappnois comptent leur âge de l’année , et non du mois
ni du quantième de leur naissance,. Ainsi peu importe qu’un
enfant soit venu au monde au commencement ou à la fin dé
l ’année , le premier jour de l’année suivante il est censé avoir
un an.
Leur ère commune date de Nin-o, 660 ans avant notre ere
Vulgaire.
Quoiqu’ils comptent, comme nous , douze signes célestes, ils
leur donnent des noms différens de ceux que nous leur ayons
assignés. Les voici
1 N e , la souris.
2 Ous, le boeuf.
3 Torra , le tigre.
4 Ov, le lièvre.
5 Tais , le dragon.
6 M i , le serpent.
7 Ouna, Je cheval.
8 Tchitchous, le mouton.
9 Sar, le singe,
10 Tor ri , le coq,
11 In , le chien,
12 I , l’ours,
Les années portent aussi les npms de ces mêmes signes cé-
J A P O N O I S ' .
lestes; ainsi l’année 1774 de notre ère vulgaire correspotidoit à
l’année japonoise du cheval, et 1776 à celle du singe (i).
(x) Voici encore une preuve de l’origine Tatare des Japonois. Les Mongols,
les Kalmouks, les Manlchoux eL les principales hordes Tatarcs, aussi-bien que
les Indiens, les Chiiois ,les Tibétains, ont encore un cycle Je'douze années, désignées
par des noms d’animaux , lequel se répète cinq fois dans leur grand cycle
de soixante ans. Saumaise a retrouvé le même cycle duodénaire chez les Chal-
déens, d’où il prétend que les Tatars l’ont tiré. Le P. Georgi étend la même
observation sur les Egyptiens et les Grecs. — Les Japonois ont aussi un cycle
sexagénaire comme les Chinois , les Indiens et les Tibétains. Comme ces détails
nous entraineroient bien au-delà des bornes que nous prescrivent les devoirs
de rédacteur, nous, renvoyons lé lecteur aux ouvrages de Gentil, de B ailly , à
la savante dissertation de Bayer de Horis sihicis, à Y Alphabefum Tibelum du
P. Georgi, et sur-tout au troisième volume d eYAyeen Akbery, or thë institutes
of emperor Akber translater! from the original Fcrsian by Gladtrin, in-4°. Calcutta
, 1786. Ce volume > entièrement consacré à l’Indostan , renferme un assez
Ions traité de l’astronomie des Hindoux , avec des éclaircissémens et des notes
deM Reuben Burrow , célèbre mathématicien anglais’, qui s’est livré’ à 'l’élude
du sanscrit et qui a déjà fait, sur l’aslionomic indienne, de. grands travaux
qu’il se propose de publier J’ai recueilli et dressé, d’après ces différens ouvrages ,
un tableau qui aura peut-être quelque mérite aux yeux de ceux qui cultivent
les langues.
C Y C L E D U O D E N A I R E . {ou T C H O G S) D E S
r~
Tibétains - T u rk s. K alm ouks. Mongols. Mantchoux. Chinois. Japonois.
“*A
i Tchip. . . •
34 Tah................ Io. H H . 5 J5ro«(a), (le '
tonnerre. ). ■
6 Proul. . . .
7 Tha................
8 Lou. . . . .
9 Prehou. . . 10 Tc7ia.. . . .
mia Ê m ................ Pah . . . .
K est; ou. .
O u lh . . • •
Pdrs . . ; • Thouchqdn.
L ou y . . . •
E y ld n . . •
Younad. . •
P y tcli i n . . ■
Dyqouq . •
E y t................ Thenghouz.
Koutougouna.
O u te r................
Pars . . . . .
Touldi . . . .
Mogoî................
Moyinr. . . . •
Goïn . . . . .
Metchin. . • -
T a ta . . . • .
Gacaï. \ . . .
JT oulougoelna.
O u te r................
Pars . . .
Taouldi. . . .
L o u . .
Mogdi. . . . .
Mo rin . . . . •
K c'in . . . . •
Pebclii . . . •
T a t iu . . . . •
No tai. . . . .
Gacaï. . . . .
I p u m ? '. ! . '!
Goul'm athoun.
Moudouri ... .
Meithe
M o r in .............
K h o n in
Pon iou . . .
Tchotou. . .
Indc ithoun. .
OuLguyan. .-•
Chou....
Nieou.
Che , .
Ma. . . .
Yarn .
Heod .
K i . . . .
Keou-.
Tàhou..
Ne . . . .
Ous . . i
Torra . .
Q v . .
Tabs . . . ..
M i . . . .
Tsitsouse.
Sar. . . . .
ï n rn : : :
LLea bsooeuurfi.s.
Le liêVre.
Le crocodile.
Le Serpent
ou dragon.
Le bouc. '
L e singe. -
L ’oiseau.
-L e p d r“ ’
a) Les Tibétains entendent par le mot brou (tonnerre ) , le dragon ou la constellation du dra-
n chimérique auuqquueell lleess JJaappoonnois , selon Koempfer , donnent la forme d’un crocodile;
c’est le'mème q ui, Tapribslês ' ’après les idées c-_-dés Tibétains -----, , ,pro\a Tuitlés éclipsés * .
du soleil e t de la lune, en Col. 1C X 1 I i i . . . ___ . * _ 2 _ 1 „ , x,nn eslvae U-sï-ê-aa ri:u Poz//i/»fdt#r
Toulant dévorer avec ses dents une partie 4e la lumière de ces astres. Notes du Rédacteur.,