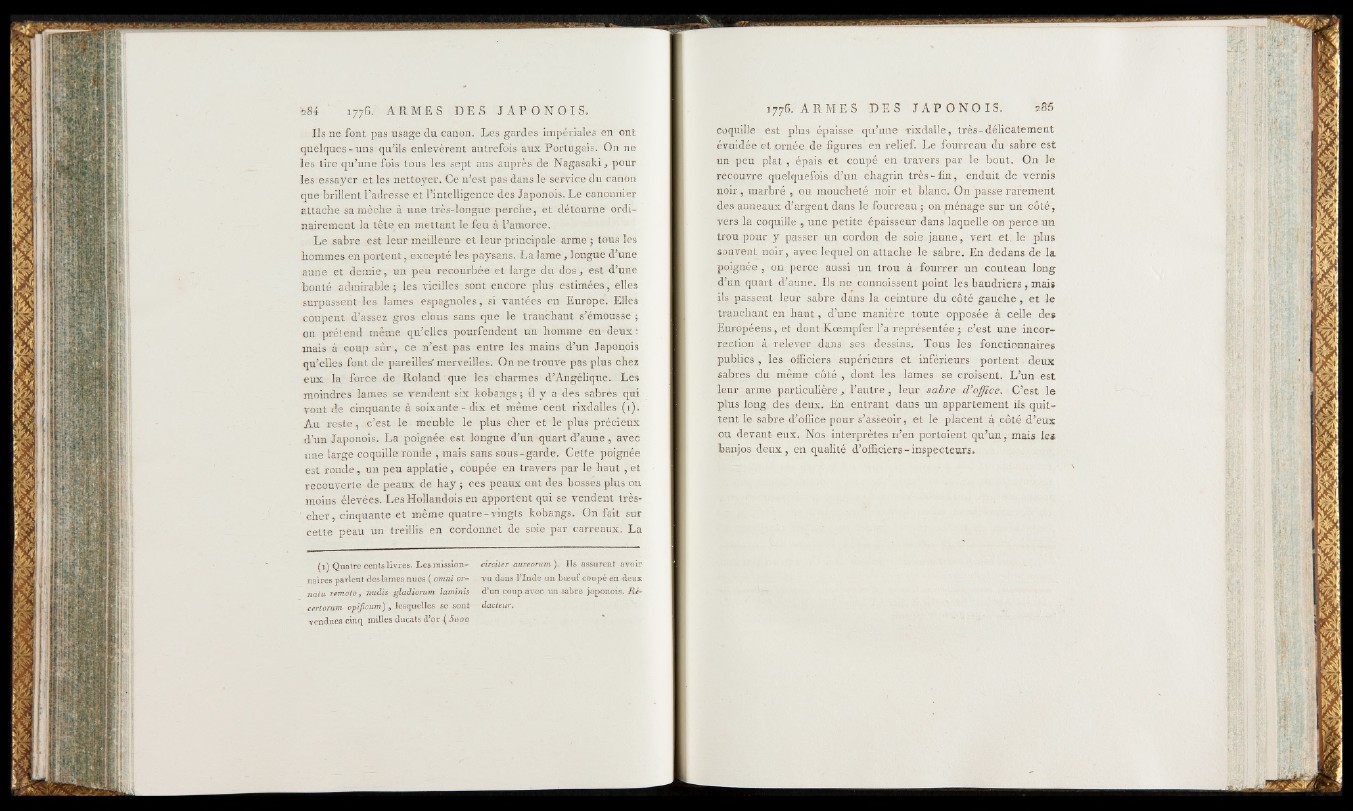
Ils ne font pas usage du canon. Les gardes impériales en ont
quelques-uns qu’ils enlevèrent autrefois aux Portugais. On ne
les tire qu’une fois tous les sept ans auprès de Nagasaki, pour
les essayer et les nettoyer. Ce n’est pas dans le service du canon
que brillent l ’adresse et l’intelligence des Japonois. Le canonnier
attache sa mèche à une très-longue perche, et détourne ordinairement
la tête en mettant le feu à l’amorce.
Le sabre est leur meilleure et leur principale arme ; tous les
hommes en portent, excepté les paysans. La lame , longue d’une
aune, et demie, un peu recourbée et large du dos, est d’une
bonté admirable ; les vieilles sont encore plus estimées, elles
surpassent des lames espagnoles, si vantées en Europe. Elles
coupent d’assez gros clous sans que le tranchant s’émousse;
on prétend même qu’ elles pourfendent un homme en-deux:
mais à coup sûr, ce n’est pas entre les mains d’un Japonois
qu’elles font de pareilles' merveilles. On ne trouve pas plus chez
eux la force de Roland que les charmes d’Angélique. Les
moindres lames se vendent six kobangs 5 il y a des sabrés qui
vont de cinquante à soixante - dix et même cent rixdalles (1).
Au reste, c’est le-meuble le plus cher et le plus précieux
d’un Japonois. La poignée est longue d’un quart d’aune, avec
une large coquille ronde , mais sans sous-garde. Cette poignée
est ronde, un peu applatie, coupée en travers par le haut, et
recouverte de peaux de hay ; ces peaux ont des bosses plus ou
moins élevées. Les Hollandois en apportent qui se vendent très-
cher, cinquante et même quatre-vingts kobangs. On fait sur
celte peau un treillis en cordonnet de soie par carreaux. La
(1) Quatre cents livres. Les> missionnaires
parlent des lames nues ( omni or-
nalu remoto, nudis gladiorum laminis
cerlorum opijiciim) j lesquelles se sont
vendues cinq milles ducats d’or •( 5ooo
circiter aureorum ), Ils assurent avoir
vu dans Pin de un boeuf coupé en deux
d’un coup avec un sabre japonois. Rédacteur.
coquille est plus épaisse qu’une -rixdalle, très-délicatement
évuidée et ornée de figures en relief. Le fourreau du sabre est
un peu plat , épais et coupé en travers par le bout. On le
recouvre quelquefois d’un chagrin très - fin, enduit de vernis
noir, marbré , ou moucheté noir et blanc. On passe rarement
des anneaux d’argent dans le fourreau ; on ménage sur un côté,
vers la coquille , une petite épaisseur dans laquelle on perce un
trou pour y passer un cordon de soie jaune, vert et. le plus
souvent noir, avec lequel on attache le sabre. En dedans de la
poignée , on perce aussi un trou à fourrer un couteau long
d’un quart d’aune. Ils ne connoissent point les baudriers, mais
ils passent leur sabre dans la ceinture du côté gauche , et le
tranchant en hau t, d’une manière tonte opposée à celle des
Européens, et dont Koempfer l’a représentée ; c’est une incorrection
à relever dans ses dessins.. Tous les fonctionnaires
publics, les officiers supérieurs et inférieurs portent deux
sabres du même côté , dont les lames se croisent. L’un est
leur arme particulière, l’autre, leur sabre d’office. C’est le
plus long des deux. En entrant dans un appartement ils quittent
le sabre d’office pour s’asseoir, et le placent à côté d’eux
ou devant eux. Nos interprètes n’en portoient qu’un, mais le*
banjos deux, en qualité d’officiers - inspecteurs.