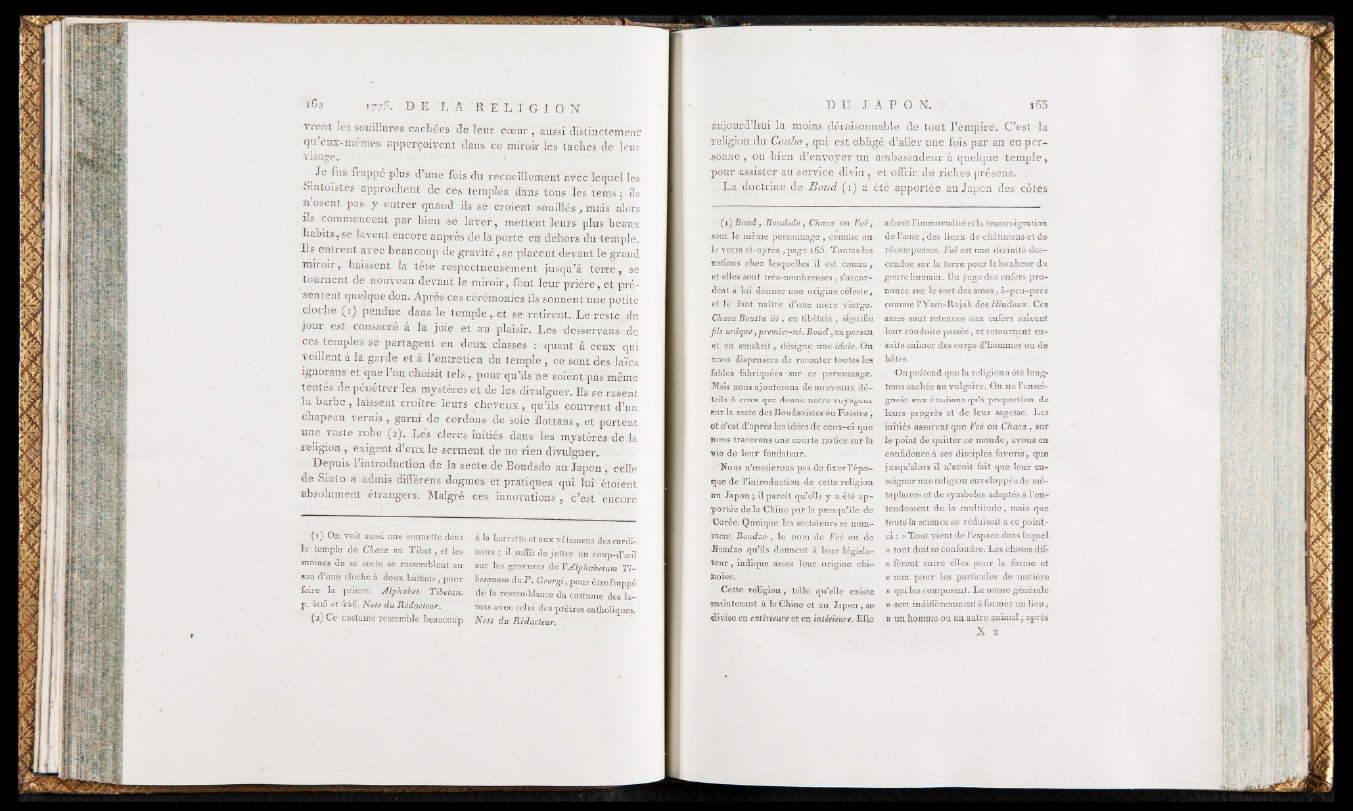
vrent les souillures cachées de leur coeur aussi distinctement
qu’eux-mêmes apperçoivent dans ce miroir les taches de leur
visage.
Je fus frappé plus d’une fois du recueillement avec lequel les
Sintoistes approchent de ces temples dans tous les tems 5 ils
n- osent pas y entrer quand ils se croient souillés, mais alors
ils commencent par bien se laver, mettent leurs plus beaux
habits, se lavent encore auprès de la porte en dehors du'temple.
Ils entrent avec beaucoup de gravité,.se placent devant le grand
miroirbaissent la tete respectueusement jusqu’à terre, se
tournent de nouveau devant le miroir,, font leur prière, et présentent
quelque don; Après ces cérémonies ils sonnent une petite
cloche (1) pendue dans le temple,.et se retirent. Le reste du
jour est consacré à la joie et au plaisir. Les desseryans de
ces temples se partagent en deux classes : quant à ceux qui
veillent à la garde et à l’entretien du temple , ce sont des laïcs
ignorans et que l’on choisit tels ,. pour qu’ils ne soient pas même
tentés de pénétrer les mystères et de les divulguer. Ils se rasent
la barbe , laissent croître leurs cheveux , qu’ils couvrent d’un
chapeau vernis , garni de cordons de soie flottans , et portent
une vaste robe (2). Lès clercs initiés dans les mystères de la
religion , exigent d’eux le serment de ne rien divulguer.
Depuis 1 introduction de la secte de Boudsdo au Japon , celle
de Sinto a admis difîerens dogmes et pratiques qui lui étoient
absolument étrangers.. Malgré ces innovations , c’est encore 1 2
(1) On vo it aussi une sonnette dans
le temple de Chaea au T ib e t , et les
moines de sa secte, se rassemblent au
son d’une cloche à deux battans, pour
faire la prière. Alphabet. Tibetan.
p . 4 o 5 et 4 4 6 . Note du Rédacteur.
(2) C e costume ressemble beaucoup
à là barrette et aux vêtemens des cardinaux
j il suffit de je tter un coup-d’oeil
sur lès gravures de VAlphabetum Ti-
betanum du P . Georgi , pour ê tre frappé
de là ressemblance du costume, des lamas
avec celui des prêtres catholiques.
Note du Rédacteur.
aujourd’hui la moins déraisonnable de tout l’ empire. C’est la
religion du Coubo , qui est obligé d’aller une fois par an en personne
, ou bien d’ envoÿer un ambassadeur à quelque temple.,
pour assister au service divin , et offrir de riches présens.; j
La doctrine de Boud (1) a été apportée au Japon des côtes
(1 ) Boud, Boudsdo, Chaca ou Foé,
sont le meme personnage , comme on
le verra ci-après , p age i 6 5 . Toutes.les
nations chez lesquelles i l est con n u ,
et elles sont très-nombreuses , s’accordent
à lui donner une origine céleste,
et le font naître d’une mère vierge.
Chaca Boutta iit , en tibétain , signifie
fils unique, premier-né. Boud, en persan
et en sanskrit, désigne une idole. On
nous dispensera de raconter .toutes les
fables fabriquées sur ce personnage.
Mais nous aj outerons dè nouveaux détails
à ceux que donne notre voyageu r
sur la secte des Boudsoïstes ou F o ïs te s ,
et c’est d’après les idées de ceux-c i que
nous tracerons une courte notice sur la
v ie de leu r fondateur.
'Nous n’essaierons pas de fixer l’époque
de l ’inlroduet-ion de cette religion
au Japon ; il p aroît qu’eîîe y a été apportée
de la Chine par la presqu’île de
Corée. Quoique les sectateurs se nomment
Boudzo , le nom de Foé ou de
Boudzo qu’ils donnent à leu r législa-
t e u r , indique assez leu r origine chinoise.
Cette re lig io n , telle qu’elle existe
maintenant a la C hine et au Japon , se
divise en extérieure et en intérieure. Elle
admet l ’immortalité e t la transmigration
de Pâme , des lieu x de châtimens et de
récompenses. Foé est une divinité descendue
sur la terre pour le bonheur du
genre humain. Un ju g e des enfers prononce
sur le sort des âmes, à-peu-près
comme l ’Y am -R a jah des Hindoux. Ces
âmes sont retenues au x enfers suivant
leu r conduite passée, et retournent ensuite
animer des corps d’hommes ou de
bêtes. '
On prétend que la religion a été long,-
tems cachée au vulgaire . On ne l ’ensei-
gnoit aux étudians qu’à proportion de
leurs progrès et de leu r sagesse. Le s
initiés assurent que Foé ou Chaca , sur
le point de quitter ce monde , avoua en
confidence à ses disciples fa v or is , que
jusqu’alors i l n’avoit fait que leu r enseigner
une religion enveloppée, de métaphores
et de symboles adaptés à l ’entendement
de la mu ltitud e, mais que
toute la science se réduisoit à ce point-
ci.: « T ou t v ient de l’ espace dans leque l
» tout doit se confondre. Le s choses di£-
» fèrent entre elles pour là forme et
m non pour les particules de matière
» qui les composent. L a masse générale
» sert indifféremment à former un lio n ,
» un homme ou un autre animal j après
X 2