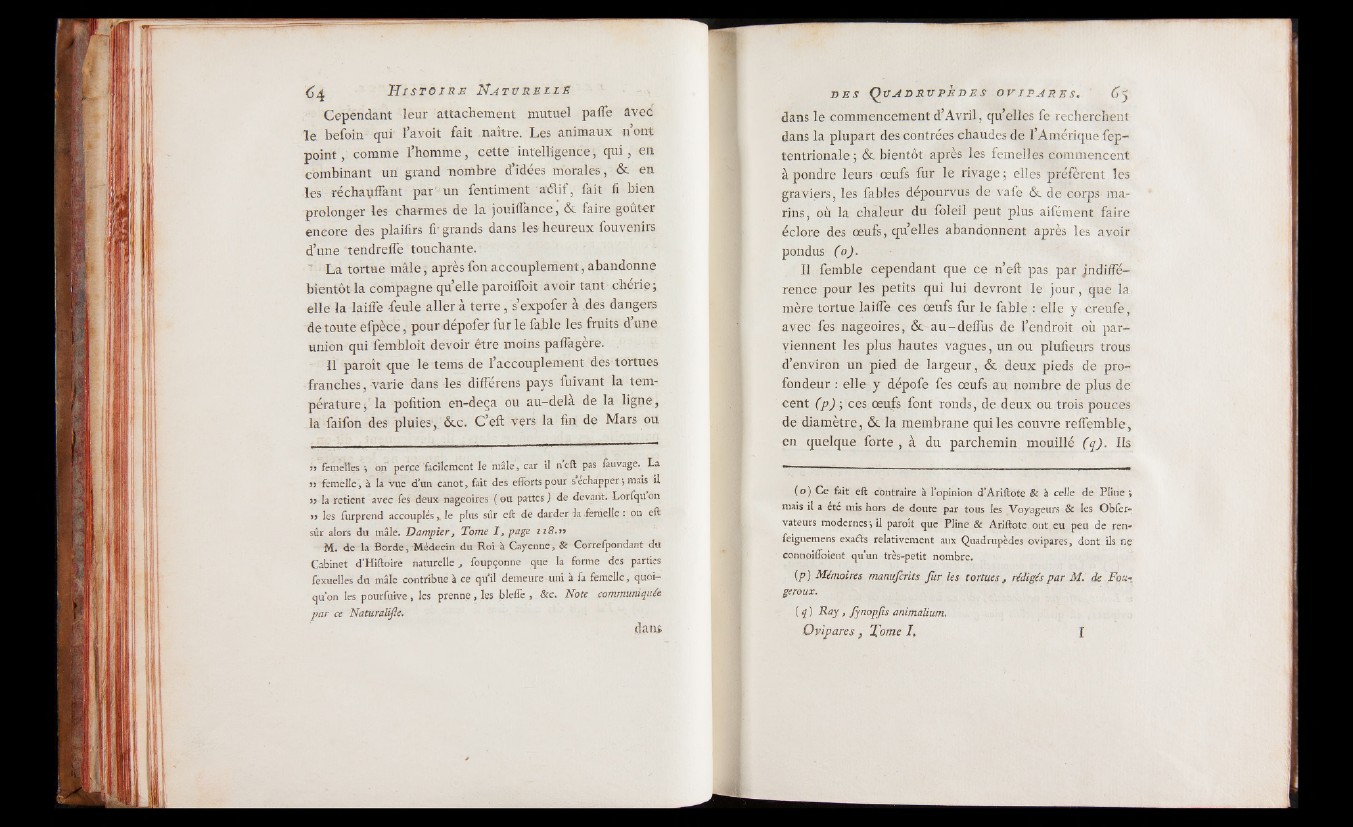
Cependant leur attachement mutuel paffe âvec
le befoîn qui' l’ayôit fait naître. Les animaux nont
point, comme l’homme, cette intelligence, q u i, en
combinant un grand nombre d’idées morales, & en
les réchayffant par un fentiment aétif, fait fi bien
prolonger les charmes de la jouiffance, & faire goûter
encore des plaifirs fi- grands dans les heureux fouvenirs
d’une 'tendreffe touchante.
I La tortue mâle, après fon accouplement, abandonne
bientôt la compagne quelle paroiffoit avoir tant chérie ;
elle la laiffe feule aller à terre, s’expofer à des dangers
de toute efpèce, pour dépofer fur le fable les fruits d’une
union qui fembloit devoir être moins paffagère.
11 paroît que le tems de l’accouplement des tortues
franches,-varie dans les différens pays fuivant la température
j la pofition en-deça ou au-delà de la ligne,
la faifon des pluies1,. &c. C’eft Vers la fin de Mars ou
jj Femelles -, on perpe facilement le mâle, car il n eft pas fauvage. t a
jj femelle, à là vue d’un canot, fait des efforts pour s échapper; mais i l
jj la retient avec fes deux nageoires ( ou pattes ) de devant. Lorfqtl on
jj les furprend accouplésle plus sûr eft de darder la femelle : on eft
sûr alors du mâle. Dampier, Tome I , page z z S . jj
M. de la Borde, Médecin du Roi à Cayenne, & Correfpondant du
Cabinet d’Hiftoire naturelle, foupçonne que la forme des parties
fexuelles du mâle contribue à ce qu’il demeure uni à fa femelle, quoiqu’on
les pourfuive, les prenne, les bleffe , &c. Note communiquée
par ce Naturalise.
dans
d e s Q u a d r u p è d e s o v i p a r e s . 6 5
dans le commencement d’Avril, qu’elles fe recherchent
dans la plupart des contrées chaudes de l’Amérique fep-
tentrionale ; & bientôt après les femelles commencent
à pondre leurs ■ oeufs fur le rivage ; elles préfèrent les
graviers, les fables dépourvus de vafe & de corps marins,
où la chaleur du foleil peut plus aifément faire
éclore des oeufs, qu’elles abandonnent après les avoir
pondus (o).
Il femble cependant que ce n’ eft pas par indifférence
pour les petits qui lui devront le jour, que là
mère tortue laiffe ces oeufs fur le fable : elle y creufe,
avec fes nageoires, & au-deffùs de l’endroit où parviennent
les plus hautes vagues, un ou plufieurs trous
d’environ un pied de largeur, & deux pieds de profondeur
: elle y dépofe fes oeufs au nombre de plus de
cent (p) ; ces oeufs font ronds, de deux ou trois pouces
de diamètre, &. la membrane qui les couvre reffemble,
en quelque forte, à du parchemin mouillé (q). Ils
( o ) Ce fait eft contraire à l’opinion d’Ariftote & à celle de Pline ;
mais il a été mis hors de doute par tous les Voyageurs & les Obfer-
vateurs modernes; il paroît que Pline & Ariftote ont eu peu de ren-
feignemens exacts relativement aux Quadrupèdes ovipares, dont ils ne
connoiffoient qu’un très-petit nombre.
{p ) Mémoires manuscrits Jiir les tortues , rédigés par M. de Fou~
geroux.
( q ) Ray, Jÿnopfis animalium,
Ovipares, Tome I. I