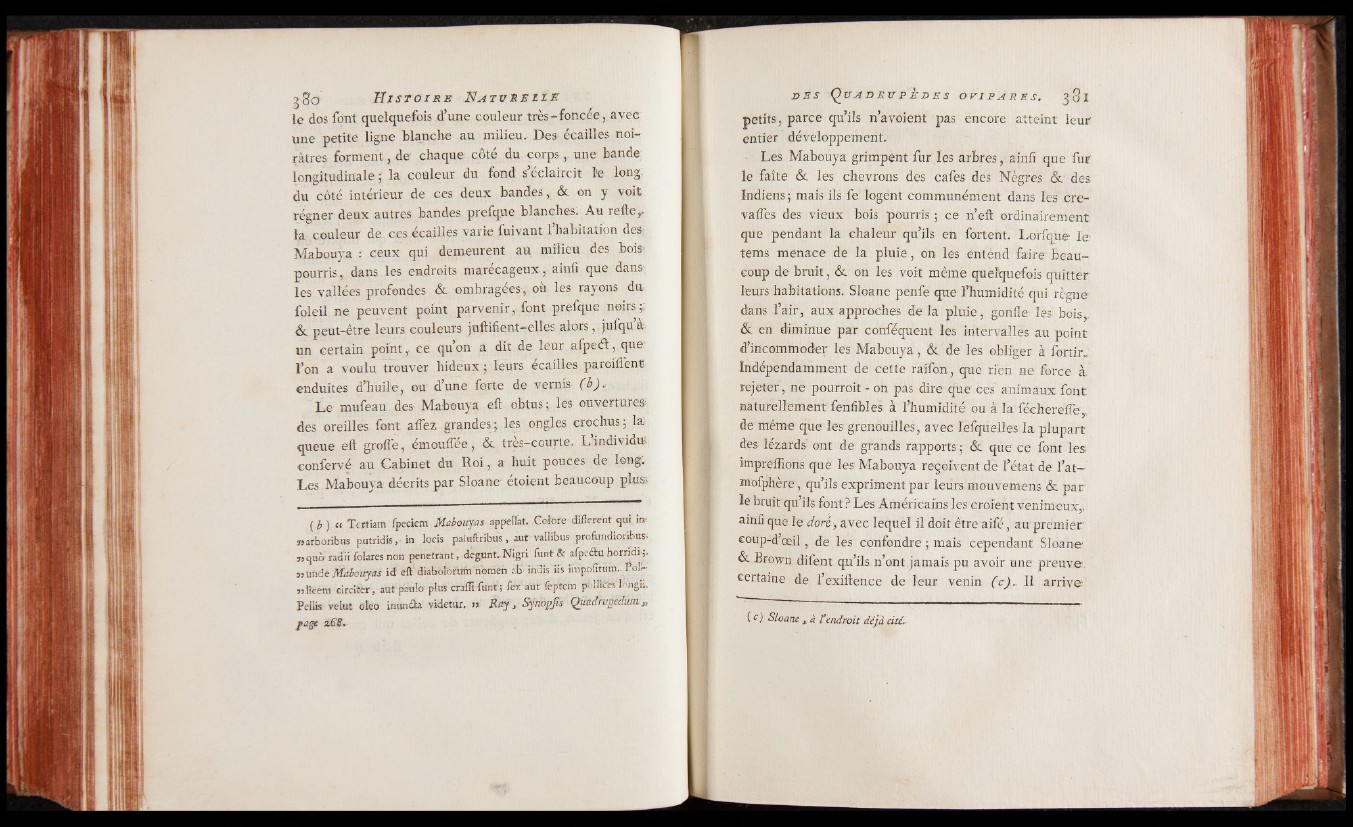
2 8 0 H i s t o i r e N a t u s e t i e
le dos font quelquefois d’une couleur très-foncée, avec
une petite ligne blanche au milieu. Des écailles noirâtres
forment, de' chaque côté du corps,. une bande
longitudinale ; la couleur du fond s’éclaircit le long:
du côté intérieur de ces deux bandes , & on y voit
régner deux autres bandes prefque blanches. Au relie,,
la couleur de ces écailles varie fuivant 1 habitation deS:
Mabouya : ceux qui demeurent au milieu des bois-
pourris , dans les endroits marécageux , ainfi que dans-
les vallées profondes & ombragées, ou les rayons du-
foleil ne peuvent point parvenir, font prefque noirs;;
& peut-être leurs couleurs juftifient-ellés alors, jufqu a
un certain point y ce qu’on a dit de leur afpeéi, que
l’on a voulu trouver hideux ; leurs écailles parodient
enduites d’huile, ou d’une forte de vernis (b )
Le mufeau des- Mabouya elt obtus; les ouvertures
des oreilles font allez grandes; les ongles crochus; la-
queue eft grofl’e , émouffée, & très-courte. L individu»
confervé au Cabinet du R o i, a huit pouces de long.
Les Mabouya décrits par Sloane étoient beaucoup plus;
( & ) « Tcrtiam fpeeiem Mabouyas appeflat. Coiore- different qui inf
» arboribus putridis, in locis pafoftribus, aut vallibus proforidioribus;
n quo-radii fokres non penetrant, degunt.Nigri font & afpedtu Horridt*.
»undeMabouyas id eft diaboferufa'nomen r.b-indis iis irapofoum.. Pofi-
, , itcera eircifer, aut paulo plus cratflfon’t ; fex aut feptem-pfclffefcs'lWngE.
Pell» velut oleo inisndta videtur. n Ray, Synopfis Qunctni£edum.„
jage 2.68.
D E S Q u A D R U P k D E S OUI P A R E S. 381
petits, parce qu’ils n’avoient pas encore atteint leur
entier développement.
Les Mabouya grimpent fur les arbres, ainfi que fur
le faîte & les chevrons des cafés des Nègres & des
Indiens; mais ils fe logent communément dans les cre-
valfes des vieux bois pourris ; ce n’eft ordinairement
que pendant la chaleur qu’ils en fortent. Lorfque le
tems menace de la pluie, on lés entend faire beaucoup
de bruit, & on les voit même quelquefois quitter
leurs habitations. Sloane penfe que l’humidité qui règne
dans l’air, aux approches de là pluie, gonfle les bois,,
& en diminue par conféquent les intervalles au point
d’incommoder les Mabouya, & de les obliger à fortir..
Indépendamment de cette raifon, que rien ne force à
rejeter, ne pourroit - on pas dire que ces animaux font
naturellement fenfibîes à l’humidité ou à la fécherefle ,
de même que les grenouilles, avec lesquelles la plupart
des lézards" ont de grands rapports ; & que ce font les
impréflions que les Mabouya reçoivent de l’état de l’at—
mofphère, qu’ils expriment par leurs mouvemens & par
le bruit qu’ils font ? Les Américains les croient venimeux,,
ainfi que le doré, avec lequel il doit être aifé, au premier
coup-d oe il, de les confondre ;; mais cependant Sloane
& Brown difent qu’ils n’ont jamais pu avoir une preuve
certaine de l’exiftence de leur venin (c ). Il arrive
1 c) Sloane x à [endroit déjà cité.-