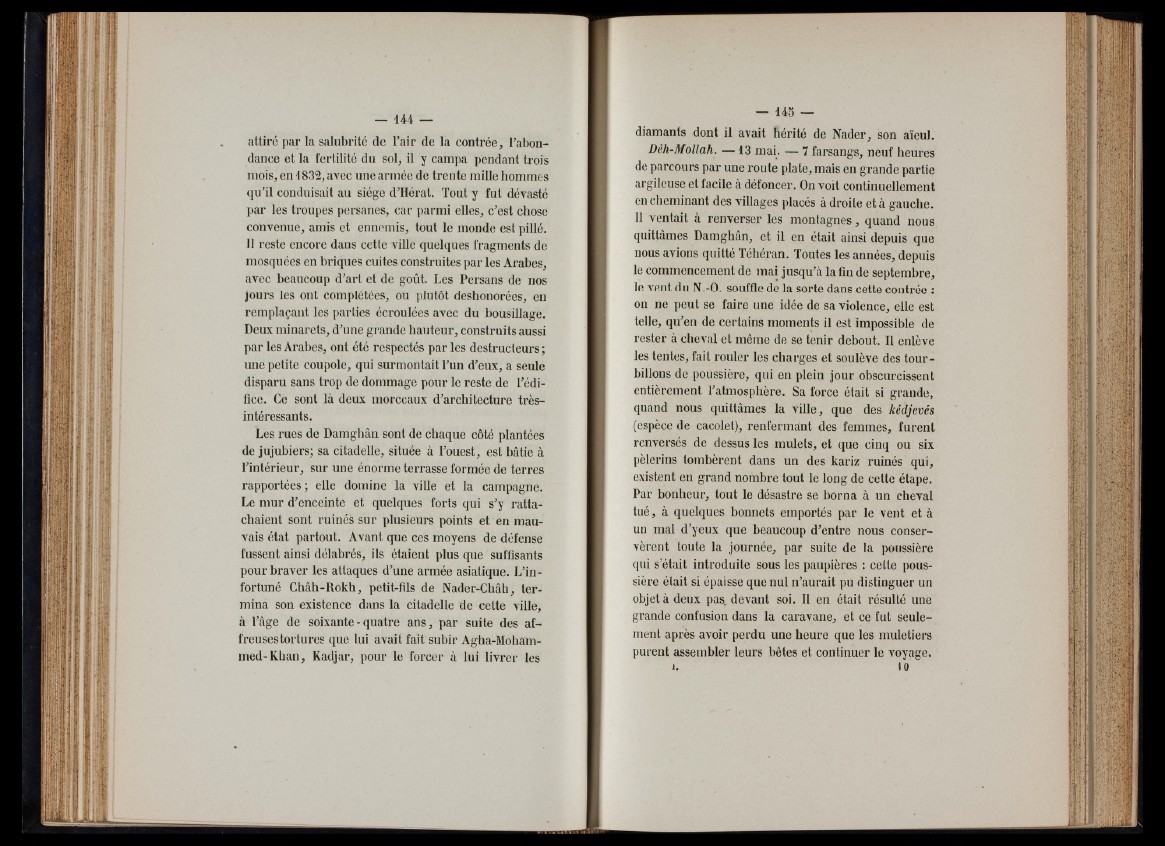
attiré par la salubrité de l’air de la contrée, l’abondance
et la fertilité du sol, il y campa pendant trois
mois, en 1832, avec une armée de trente mille hommes
qu’il conduisait au siège d’Hérat. Tout y fut dévasté
par les troupes persanes, car parmi elles, c’est chose
convenue, amis et ennemis, tout le monde est pillé.
Il reste encore dans cette ville quelques fragments de
mosquées en briques cuites construites par les Arabes,
avec beaucoup d’art et de goût. Les Persans de nos
jours les ont complétées, ou plutôt deshonorées, en
remplaçant les parties écroulées avec du bousillage.
Deux minarets, d’une grande hauteur, construits aussi
par les Arabes, ont été respectés parles destructeurs;
une petite coupole, qui surmontait l’un d’eux, a seule
disparu sans trop de dommage pour le reste de l’édifice.
Ce sont là deux morceaux d’architecture très-
intéressants.
Les rues de Damghân sont de chaque côté plantées
de jujubiers; sa citadelle, située à l’ouest, est bâtie à
l’intérieur, sur une énorme terrasse formée de terres
rapportées; elle domine la ville et la campagne.
Le mur d’enceinte et quelques forts qui s’y rattachaient
sont ruinés sur plusieurs points et en mauvais
état partout. Avant que ces moyens de défense
fussent ainsi délabrés, ils étaient plus que suffisants
pour braver les attaques d’une armée asiatique. L’infortuné
Châh-Rokh, petit-fils de Nader-Châh, termina
son existence dans la citadelle de cette ville,
à l’âge de soixante - quatre ans, par suite des af-
freusestortures que lui avait fait subir Agha-Moham-
med-Khan, Kadjar, pour le forcer à lui livrer les
diamants dont il avait hérité de Nader, son aïeul.
Dèh-Mollah. — 13 mai. — 7 farsangs, neuf heures
de parcours par une route plate, mais en grande partie
argileuse et facile à défoncer. On voit continuellement
en cheminant des villages placés à droite et à gauche.
Il ventait à renverser les montagnes, quand nous
quittâmes Damghân, et il en était ainsi depuis que
nous avions quitté Téhéran. Toutes les années, depuis
le commencement de mai jusqu’à la fin de septembre,
le vent du N.-O. souffle de la sorte dans cette contrée :
on ne peut se faire une idée de sa violence, elle est
telle, qu’en de certains moments il est impossible de
rester à cheval et même de se tenir debout. Il enlève
les tentes, fait rouler les charges et soulève des tourbillons
de poussière, qui en plein jour obscurcissent
entièrement l’atmosphère. Sa force était si grande,
quand nous quittâmes la ville, que des kédjevés
(espèce de cacolet), renfermant des femmes, furent
renversés de dessus les mulets, et que cinq ou six
pèlerins tombèrent dans un des kariz ruinés qui,
existent en grand nombre tout le long de cette étape.
Par bonheur, tout le désastre se borna à un cheval
tué, à quelques bonnets emportés par le vent et à
un mal d’yeux que beaucoup d’entre nous conservèrent
toute la journée, par suite de la poussière
qui s’était introduite sous les paupières : cette poussière
était si épaisse que nul n’aurait pu distinguer un
objet à deux pas. devant soi. Il en était résulté une
grande confusion dans la caravane, et ce fut seulement
après avoir perdu une heure que les muletiers
purent assembler leurs bêtes et continuer le voyage.
i. 10