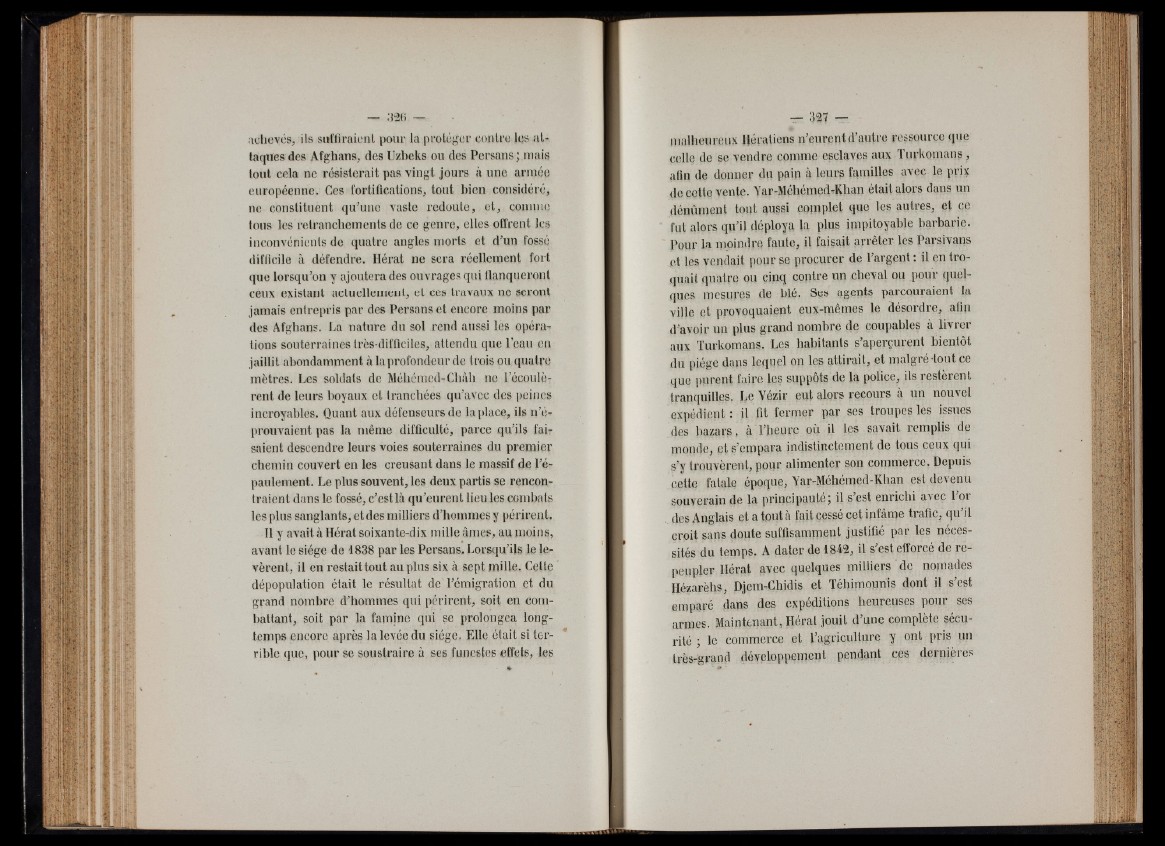
achevés, ils suffiraient pour la protéger contre les attaques
des Afghans, des Uzbeks ou des Persans ; mais
tout cela ne résisterait pas vingt jours à une armée
européenne. Ces fortifications, tout bien considéré,
ne constituent qu’une vaste redoute, et, comme
tous les retranchements de ce genre, elles offrent les
inconvénients de quatre angles morts et d’un fossé
difficile à défendre. Hérat ne sera réellement fort
que lorsqu’on y ajoutera des ouvrages qui flanqueront
ceux existant actuellement, et ces travaux ne seront
jamais entrepris par des Persans et encore moins par
des Afghans. La nature du sol rend aussi les opérations
souterraines très-difficiles, attendu que l ’eau en
jaillit abondamment à la profondeur de trois ou quatre
mètres. Les soldats de Méhémcd-Chàh ne l’écoulè-
rent de leurs boyaux et tranchées qu’avec des peines
incroyables. Quant aux défenseurs de la place, ils n ’éprouvaient
pas la même difficulté, parce qu’ils faisaient
descendre leurs voies souterraines du premier
chemin couvert en les creusant dans le massif de l’é-
paulement. Le plus souvent, les deux partis se rencontraient
dans le fossé, c’est là qu’eurent lieu les combats
les plus sanglants, et des milliers d’hommes y périrent.
Il y avait à Hérat soixante-dix mille âmes, au moins,
avant le siège de 1838 par les Persans, Lorsqu’ils le levèrent,
il en restait tout au plus six à sept mille. Cette
dépopulation était le résultat de l’émigration et du
grand nombre d’hommes qui périrent, soit en combattant,
soit par la famine qui se prolongea longtemps
encore après la levée du siège, Elle était si terrible
que, pour se soustraire à ses funestes effets, les
malheureux tjératiens n’eurent d’autre ressource que
celle de se vendre comme esclaves aux Turkomans,
afin de donner du pain à leurs familles avec le prix
de cette vente. Yar-Méhémed-Khan était alors dans un
dénûment tout aussi complet que les autres, et ce
fut alors qn’il déploya la plus impitoyable barbarie.
Pour la moindre faute, il faisait arrêter les Parsivans
et les vendait pour se procurer de l’argent : il en troquait
quatre q u cinq contre un cheval ou pour quelques
mesures de ble. Ses agents parcouraient la
ville et provoquaient eux-mêmes le désordre, afin
d’avoir un plus grand nombre de coupables à livrer
aux Turkomans. Les habitants s’aperçurent bientôt
du piège dans lequel on les attirait, et malgré-tout ce
que purent faire les suppôts de la police, ils restèrent
tranquilles. Le Yezir eut alors recours à un nouvel
expédient : il fit fermer par ses troupes les issues
des bazars, à l’heure où il les savait remplis de
monde, et s’empara indistinctement de tous ceux qui
s’y trouvèrent, pour alimenter son commerce. Depuis
cette fatale époque, Yar-Méhémed-Khan est devenu
souverain de la principauté; il s’est enrichi avec l’or
des Anglais et a tout à fait cessé cet ipfâroe trafic, qu’il
croit sans doute suffisamment justifié par les nécessités
du temps. A dater de 1842, il s’est efforcé de repeupler
Hérat avec quelques milliers de nomades
Hézarèhs, Djem-Chidis et Téhimounis dont il s’est
emparé dans des expéditions heureuses pour ses
armes. Maintenant, Hérat jouit d’une complète sécurité
; le commerce et l’agriculture y ont pris un
très-grand développement pendant ces dernières