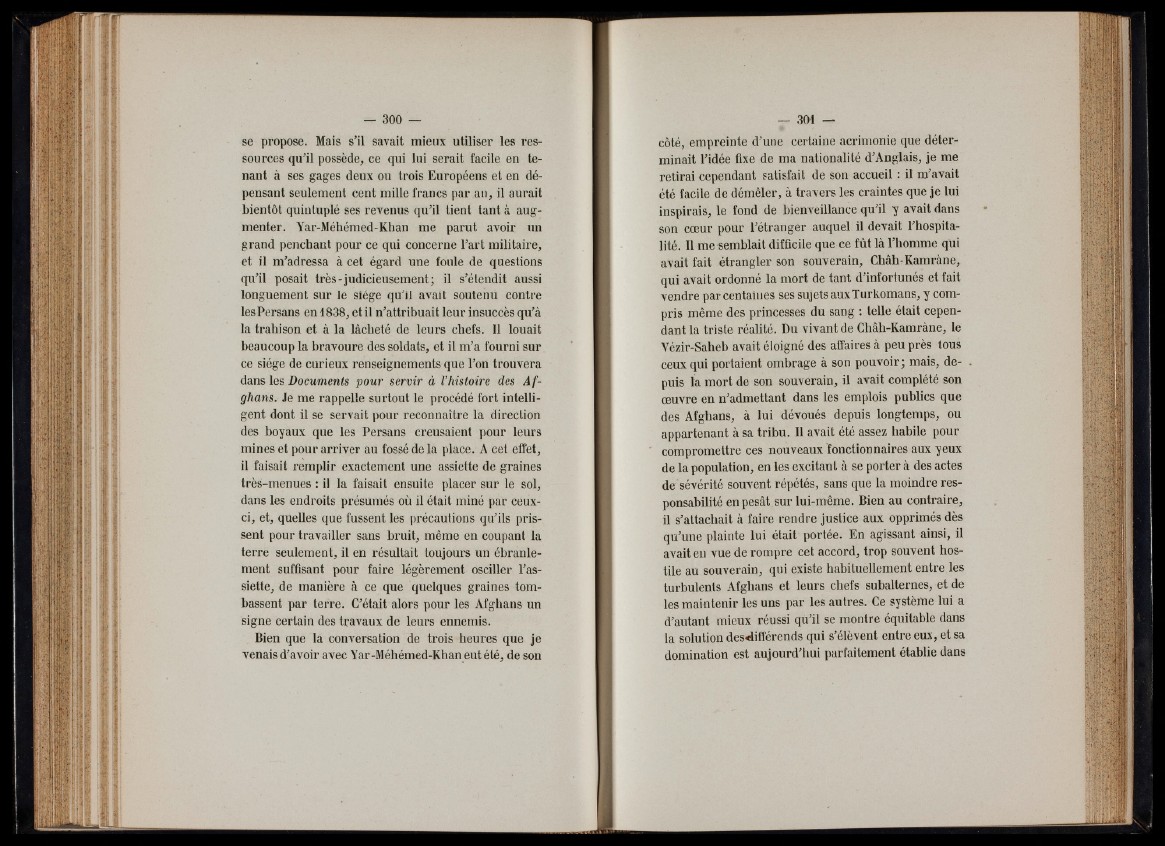
se propose. Mais s’il savait mieux utiliser les ressources
qu’il possède, ce qui lui serait facile en tenant
à ses gages deux ou trois Européens et en dépensant
seulement cent mille francs par an, il aurait
bientôt quintuplé ses revenus qu’il tient tant à augmenter.
Yar-Méhémed-Khan me parut avoir un
grand penchant pour ce qui concerne l’art militaire,
et il m’adressa à cet égard une foule de questions
qu’il posait très-judicieusement; il s’étendit aussi
longuement sur le siège qu’il avait soutenu contre
lesPersans en 1838, et il n’attribuait leur insuccès qu’à
la trahison et à la lâcheté de leurs chefs. Il louait
beaucoup la bravoure des soldats, et il m’a fourni sur
ce siège de curieux renseignements que l’on trouvera
dans les Documents pour servir à l’histoire des Afghans.
Je me rappelle surtout le procédé fort intelligent
dont il se servait pour reconnaître la direction
des boyaux que les Persans creusaient pour leurs
mines et pour arriver au fossé de la place. A cet effet,
il faisait remplir exactement une assiette de graines
très-menues : il la faisait ensuite placer sur le sol,
dans les endroits présumés où il était miné par ceux-
ci, et, quelles que fussent les précautions qu’ils prissent
pour travailler sans bruit, même en coupant la
terre seulement, il en résultait toujours un ébranlement
suffisant pour faire légèrement osciller l’assiette,
de manière à ce que quelques graines tombassent
par terre. C’était alors pour les Afghans un
signe certain des travaux de leurs ennemis.
Bien que la conversation de trois heures que je
venais d’avoir avec Yar-Méhémed-Khan eut été, de son
côté, empreinte d’une certaine acrimonie que déterminait
l’idée fixe de ma nationalité d’Anglais, je me
retirai cependant satisfait de son accueil : il m’avait
été facile de démêler, à travers les craintes que je lui
inspirais, le fond de bienveillance qu’il y avait dans
son coeur pour l’étranger auquel il devait l’hospitalité.
Il me semblait difficile que ce fût là l’homme qui
avait fait étrangler son souverain, Châh-Kamràne,
qui avait ordonné la mort de tant d’infortunés et fait
vendre par centaines ses sujets auxTurkomans, y compris
même des princesses du sang : telle était cependant
la triste réalité. Du vivant de Châh-Kamràne, le
Yézir-Saheb avait éloigné des affaires à peu près tous
ceux qui portaient ombrage à son pouvoir ; mais, depuis
la mort de son souverain, il avait complété son
oeuvre en n’admettant dans les emplois publics que
des Afghans, à lui dévoués depuis longtemps, ou
appartenant à sa tribu. Il avait été assez habile pour
compromettre ces nouveaux fonctionnaires aux yeux
de la population, en les excitant à se porter à des actes
de sévérité souvent répétés, sans que la moindre responsabilité
en pesât sur lui-même. Bien au contraire,
il s’attachait à faire rendre justice aux opprimés dès
qu’une plainte lui était portée. En agissant ainsi, il
avait en vue de rompre cet accord, trop souvent hostile
au souverain, qui existe habituellement entre les
turbulents Afghans et leurs chefs subalternes, et de
les maintenir les uns par les autres. Ce système lui a
d’autant mieux réussi qu’il se montre équitable dans
la solution des-différends qui s’élèvent entre eux, et sa
domination est aujourd’hui parfaitement établie dans