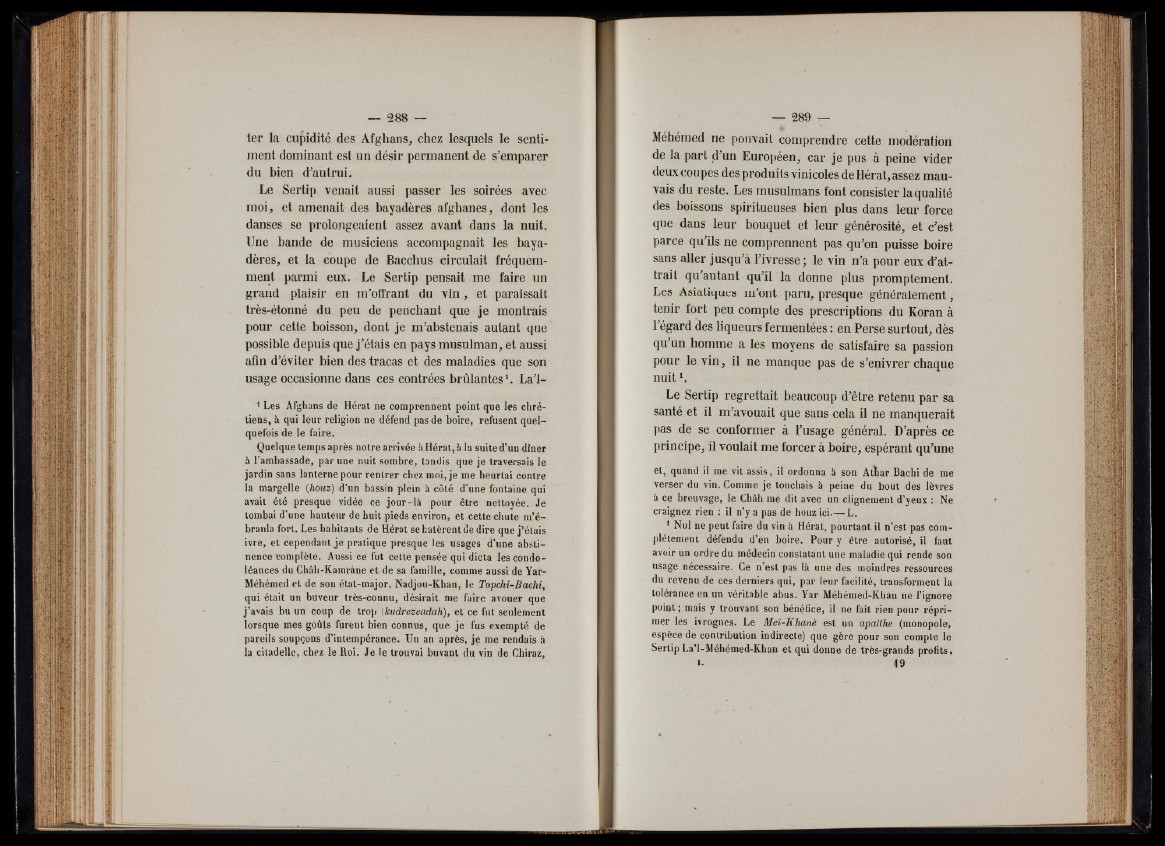
ter la cupidité des Afghans, chez lesquels le sentiment
dominant est un désir permanent de s’emparer
du bien d’autrui.
Le Sertip venait aussi passer les soirées avec
moi, et amenait des bayadères afghanes, dont les
danses se prolongeaient assez avant dans la nuit.
Une bande de musiciens accompagnait les bayadères,
et la coupe de Bacchus circulait fréquemment
parmi eux. Le Sertip pensait me faire un
grand plaisir en m’offrant du v in , et paraissait
très-étonné du peu de penchant que je montrais
pour cette boisson, dont je m’abstenais autant que
possible depuis que j’étais en pays musulman, et aussi
afin d’éviter bien des tracas et des maladies que son
usage occasionne dans ces contrées brûlantes1. La’l-
1 Les Afghans de Hérat ne comprennent point que les chrétien
s, h qui leu r religion ne défend pas de boire, refusent quelquefois
de le faire.
Quelque temps après notre arrivée à Hérat, à la suite d’un dîner
à l ’ambassade, par une nuit sombre, tandis que je traversais le
jardin sans lanterne pour re n tre r chez moi, je me h eurtai contre
la margelle (houz) d ’un bassin plein à côté d'une fontaine qui
avait été presque vidée ce jo u r - là pour être nettoyée. Je
tombai d’une hauteur de huit pieds environ, e t cette chute m’é -
branla fort. Les habitants de Hérat se hâ tè ren t de dire que j ’étais
ivre, e t cependant j e pratique presque les usages d’une abstinence
complète. Aussi ce fut cette pensée qui dicta les condoléances
du Châh-Kamràne e t de sa famille, comme aussi de Yar-
Méhémed et de son étal-major. Nadjou-Khan, le Topchi-Bachi,
qui était un buveur très-connu, désirait me faire avouer que
j ’avais bu un coup de trop (kudrezeadah), e t ce fut seulement
lorsque mes goûts furent bien connus, que je fus exempté de
pareils soupçons d’intempérance. Un an après, je me rendais à
la citadelle, chez le Roi. J e le trouvai buvant du vin de Chiraz,
Méhémed ne pouvait comprendre cette modération
de la part d’un Européen, car je pus à peine vider
deux coupes des produits vinicoles de Hérat, assez mauvais
du reste. Les musulmans font consister la qualité
des boissons spiritueuses bien plus dans leur force
que dans leur bouquet et leur générosité, et c’est
parce qu’ils ne comprennent pas qu’on puisse boire
sans aller jusqu’à l’ivresse ; le vin n’a pour eux d’attrait
qu’autant qu’il la donne plus promptement.
Les Asiatiques m’ont paru, presque généralement,
tenir fort peu compte des prescriptions du Koran à
l’égard des liqueurs fermentées : en Perse surtout, dès
qu un homme a les moyens de satisfaire sa passion
pour le vin, il ne manque pas de s’enivrer chaque
nuit L
Le Sertip regrettait beaucoup d’être retenu par sa
santé et il m’avouait que sans cela il ne manquerait
pas de se conformer à l’usage général. D’après ce
principe, il voulait me forcer à boire, espérant qu’une
et, quand il me vit assis, il ordonna à son Atliar Bachi de me
verser du vin. Comme je touchais à peine du bout des lèvres
à ce breuvage, le Châh me dit avec un clignement d’yeux : Ne
craignez rien : il n’y a pas de houz ici L.
1 Nul ne peut faire du vin à Hérat, pou rtan t il n’est pas complètement
défendu d’en boire. Pour y ê tre autorisé, il faut
avoir un ordre du médecin constatant une maladie qui rende son
usage nécessaire. Ce n ’e st pas là une des moindres ressources
du revenu de ces derniers qui, p a r leur facilité, transforment la
tolérance en un véritable abus. Yar Méhémed-Khan ne l’ignore
point ; mais y trouvant son bénéfice, il ne fait rien pour rép rimer
les ivrognes. Le Meï-Khanè est un apalthe (monopole,
espèce de contribution indirecte) que gère pour son compte le
Sertip La’l-Méhémed-Khan e t qui donne de très-grands profits,
i. 19