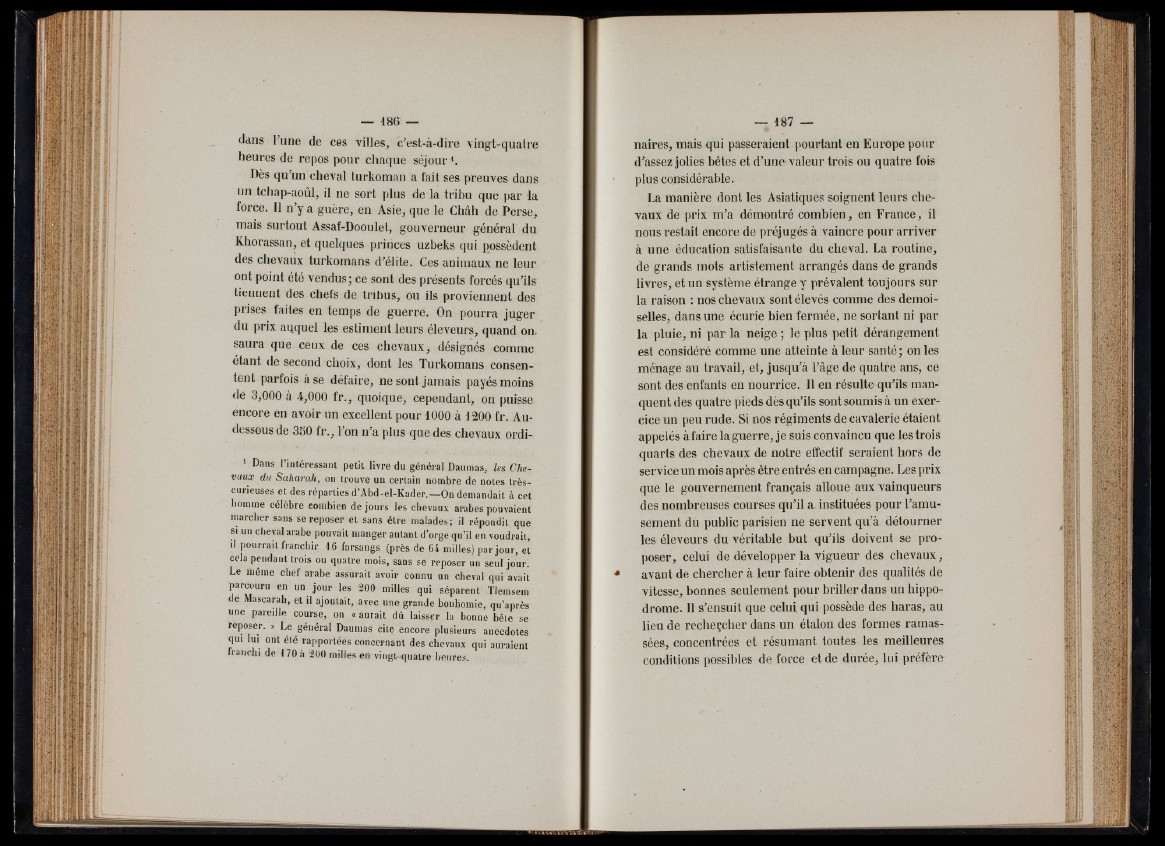
dans l’une de ces 'villes, c’est-à-dire vingt-quatre
heures de repos pour chaque séjour *.
Dès qu’un cheval turkoman a fait ses preuves dans
un tehap-aoûl, il ne sort plus de la tribu que par la
force. Il n’y a guère, en Asie, que le Châh de Perse,
mais surtout Assaf-Dooulet, gouverneur général du
Khorassan, et quelques princes uzbeks qui possèdent
des chevaux turkomans d’élite. Ces animaux ne leur
ont point été vendus; ce sont des présents forcés qu’ils
tiennent des chefs de tribus, ou ils proviennent des
prises faites en temps de guerre. On pourra juger
du prix auquel les estiment leurs éleveurs, quand on.
saura que ceux de ces chevaux, désignés comme
étant de second choix, dont les Turkomans consentent
parfois à se défaire, ne sont jamais payés moins
de 3,000 à 4,000 fr., quoique, cependant, on puisse
encore en avoir un excellent pour 4000 à 1200 fr. Au-
dessous de 350 fr., l’on n’a plus que des chevaux ordi1
Dans l’intéressant petit livre du général Daumas, les Chevaux
du Saharah, on trouve un certain nombre de notes très-
curieuses et des réparties d ’Abd-el-Kader.—On demandait à cet
bomrne célèbre eombien de jours les chevaux arabes pouvaient
marcher sans se reposer e t sans ê tre malades; il répondit que
si un cheval arabe pouvait manger autant d’orge q u ’il en voudrait,
il p ourrait franchir 16 farsangs (près de 64 milles) par jo u r, et
cela pendant trois ou quatre mois, sans se reposer un seul jour.
Le même chef arabe assurait avoir connu un cheval qui avait
parcouru en un jo u r les 200 milles qui séparent Tlemsem
de Mascarah, e t il ajoutait, avec une grande bonhomie, qu’après
une pareille course, on « au ra it dû laisser la bonne bêle se
reposer. » Le général Daumas cite encore plusieurs anecdotes
qui lui ont été rapportées concernant des chevaux qui auraient
franchi de 170 à 200 milles en vingt-quatre heures.
naires, mais qui passeraient pourtant en Europe pour
d’assez jolies bêtes et d’une valeur trois ou quatre fois
plus considérable.
La manière dont les Asiatiques soignent leurs chevaux
de prix m’a démontré combien, en France, il
nous restait encore de préjugés à vaincre pour arriver
à une éducation satisfaisante du cheval. La routine,
de grands mots artistement arrangés dans de grands
livres, et un système étrange y prévalent toujours sur
la raison : nos chevaux sont élevés comme des demoiselles,
dans une écurie bien fermée, ne sortant ni par
la pluie, ni par la neige ; le plus petit dérangement
est considéré comme une atteinte à leur santé; on les
ménage au travail, et, jusqu’à l’âge de quatre ans, ce
sont des enfants en nourrice. Il en résulte qu’ils manquent
des quatre pieds dès qu’ils sont soumis à un exercice
un peu rude. Si nos régiments de cavalerie étaient
appelés àfaire la guerre, je suis convaincu que les trois
quarts des chevaux de notre effectif seraient hors de
service un mois après être entrés en campagne. Les prix
que le gouvernement français alloue aux vainqueurs
des nombreuses courses qu’il a instituées pour l’amusement
du public parisien ne servent qu’à détourner
les éleveurs du véritable but qu’ils doivent se proposer,
celui de développer la vigueur des chevaux,
avant de chercher à leur faire obtenir des qualités de
vitesse, bonnes seulement pour briller dans un hippodrome.
Il s’ensuit que celui qui possède des haras, au
lieu de rechercher dans un étalon des formes ramassées,
concentrées et résumant toutes les meilleures
conditions possibles de force et de durée, lui préfère