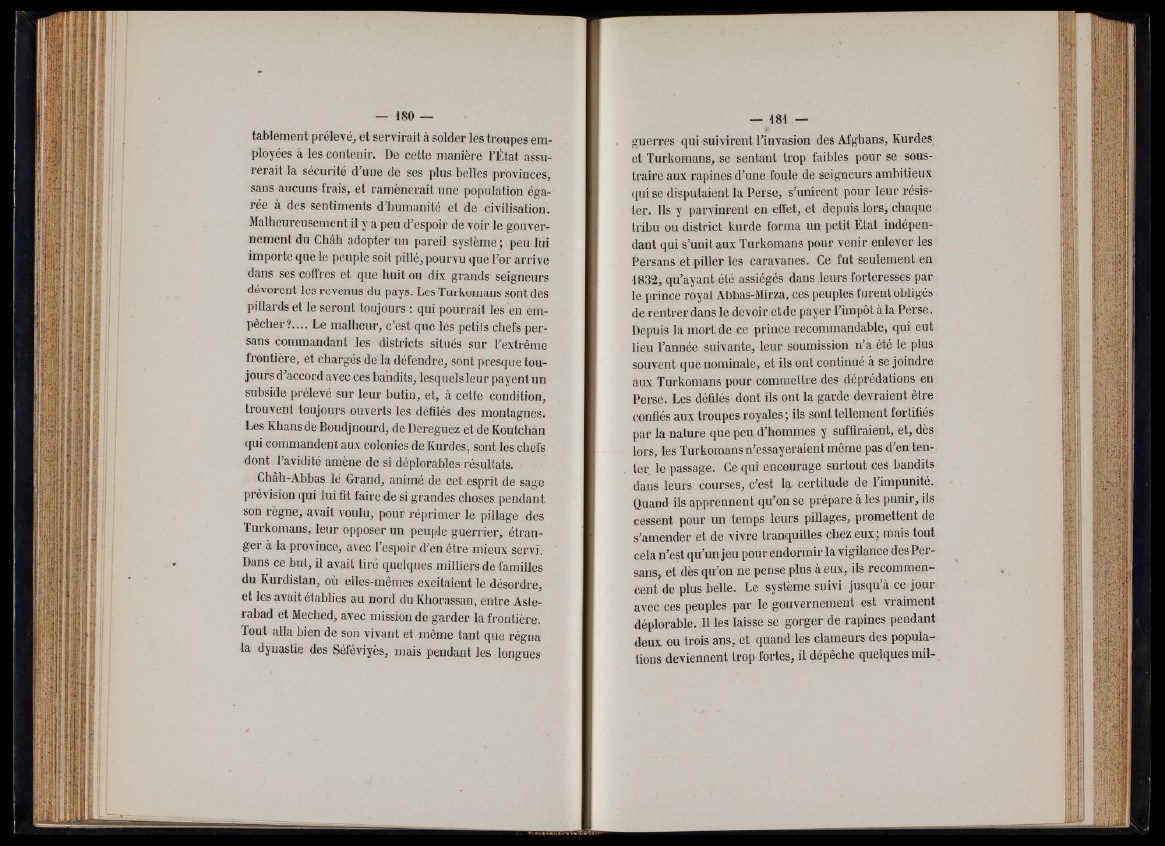
tablement prélevé, et servirait à solder les troupes employées
à les contenir. De cette manière l’État assurerait
la sécurité d’une de ses plus belles provinces,
sans aucuns frais, et ramènerait une population égarée
à des sentiments d’humanité et de civilisation.
Malheureusement il y a peu d’espoir de voir le gouvernement
du Châh adopter un pareil système; peu lui
importe que le peuple soit pillé, pourvu que l’or arrive
dans ses coffres et que huit ou dix grands seigneurs
dévorent les revenus du pays. Les Turkomans sont des
pillards et le seront toujours : qui pourrait les en empêcher?....
Le malheur, c’est que les petits chefs persans
commandant les districts situés sur l’extrême
frontière, et chargés de la défendre, sont presque toujours
d’accord avec ces bandits, lesquels leur payent un
subside prélevé sur leur butin, et, à cette condition,
trouvent toujours ouverts les défilés des montagnes.
Les Khans de Boudjnourd, de Dereguez et de Koutchan
qui commandent aux colonies de Kurdes, sont les chefs
dont l’avidité amène de si déplorables résultats.
Châh-Abbas lé Grand, animé de cet esprit de sage
prévision qui lui fit faire de si grandes choses pendant
son règne, avait voulu, pour réprimer le pillage des
Turkomans, leur opposer un peuple guerrier, étranger
à la province, avec l’espoir d’en être mieux servi.
Dans ce but, il avait tiré quelques milliers de familles
du Kurdistan, où elles-mêmes excitaient le désordre,
et les avait établies au nord duKhorassan, entre Aste-
rabad et Meched, avec mission de garder la frontière.
Tout alla bien de son vivant et même tant que régna
la dynastie des Séféviyès, mais pendant les longues
guerres qui suivirent l’invasion des Afghans, Kurdes
et Turkomans, se sentant trop faibles pour se soustraire
aux rapines d’une foule de seigneurs ambitieux
qui se disputaient la Perse, s’unirent pour leur résister.
Ils y parvinrent en effet, et depuis lors, chaque
tribu ou district kurde forma un petit État indépendant
qui s’unit aux Turkomans pour venir enlever les
Persans et piller les caravanes. Ce fut seulement en
1832, qu’ayant été assiégés dans leurs forteresses par
le prince royal Abbas-Mirza, ces peuples furent obligés
de rentrer dans le devoir et de payer l’impôt à la Perse.
Depuis la mort de ce prince recommandable, qui eut
lieu l’année suivante, leur soumission n’a été le plus
souvent que nominale, et ils ont continué à se joindre
aux Turkomans pour commettre des déprédations en
Perse. Les défilés dont ils ont la garde devraient être
confiés aux troupes royales; ils sont tellement fortifiés
par la nature que peu d’hommes y suffiraient, et, dès
lors, les Turkomans n’essayeraient même pas d’en tenter.
le passage. Ce qui encourage surtout ces bandits
dans leurs courses, c’est la certitude de l’impunité.
Quand ils apprennent qu’on se prépare à les punir, ils
cessent pour un temps leurs pillages, promettent de
s’amender et de vivre tranquilles chez eux; mais tout
cela n’est qu’un jeu pour endormir la vigilance des Persans,
et dès qu’on ne pense plus à eux, ils recommencent
de plus belle. Le système suivi jusqu’à ce jour
avec ces peuples par le gouvernement est vraiment
déplorable. Il les laisse se gorger de rapines pendant
deux ou trois ans, et quand les clameurs des populations
deviennent trop fortes, il dépêche quelques mil