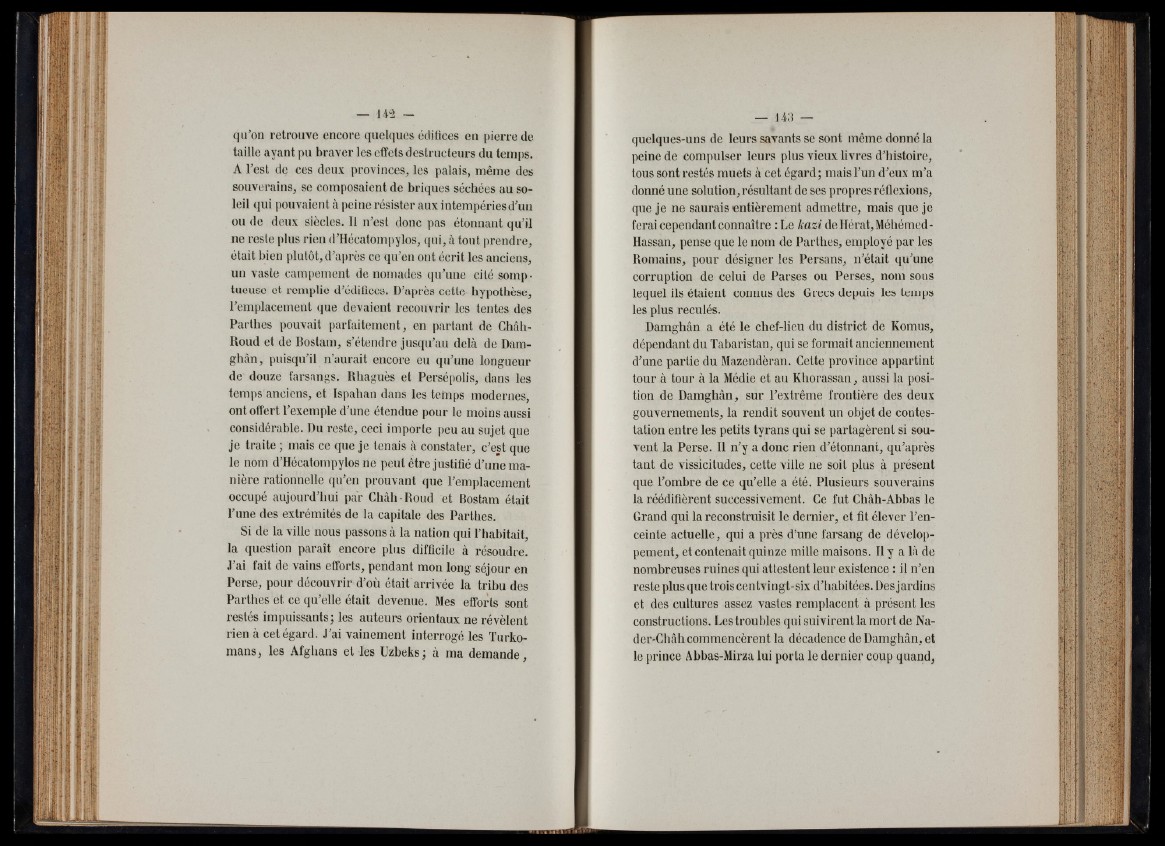
— m —
qu’on retrouve encore quelques édifices en pierre de
taille ayant pu braver les effets destructeurs du temps.
A l’est de ces deux provinces, les palais, même des
souverains, se composaient de briques séchées au soleil
qui pouvaient à peine résister aux intempéries d’un
ou de deux siècles. Il n’est donc pas étonnant qu’il
ne reste plus rien d’Hécatompylos, qui, à tout prendre,
était bien plutôt, d’après ce qu’en ont écrit les anciens,
un vaste campement de nomades qu’une cité somptueuse
et remplie d’édifices. D’après cette hypothèse,
l’emplacement que devaient recouvrir les tentes des
Parthes pouvait parfaitement, en partant de Châh-
Roud et de Bostam, s’étendre jusqu’au delà de Damghân,
puisqu’il n’aurait encore eu qu’une longueur
de douze farsangs. Rhaguès et Persépolis, dans les
temps anciens, et Ispahan dans les temps modernes,
ont offert l’exemple d’une étendue pour le moins aussi
considérable. Du reste, ceci importe peu au sujet que
je traite ; mais ce que je tenais à constater, c’est que
le nom d’Hécatompylos ne peut être justifié d’une manière
rationnelle qu’en prouvant que l’emplacement
occupé aujourd’hui par Châh-Roud et Bostam était
l’une des extrémités de la capitale des Parthes.
Si de la ville nous passons à la nation qui l’habitait,
la question paraît encore plus difficile à résoudre.
J’ai fait de vains efforts, pendant mon long séjour en
Perse, pour découvrir d’où était arrivée la tribu des
Parthes et ce qu’elle était devenue. Mes efforts sont
restés impuissants; les auteurs orientaux ne révèlent
rien à cet égard. J’ai vainement interrogé les Turko-
mans, les Afghans et les üzbeks; à ma demande,
quelques-uns de leurs savants se sont même donné la
peine de compulser leurs plus vieux livres d’histoire,
tous sont restés muets à cet égard; mais l’un d’eux m’a
donné une solution, résultant de ses propres réflexions,
que je ne saurais »entièrement admettre, mais que je
ferai cependant connaître : Le kazi deHérat.,Méhémed-
Hassan, pense que le nom de Parthes, employé par les
Romains, pour désigner les Persans, n’était qu’une
corruption de celui de Parses ou Perses, nom sous
lequel ils étaient connus des Grecs depuis les temps
les plus reculés.
Damghân a été le chef-lieu du district de Komus,
dépendant du Tabaristan, qui se formait anciennement
d’une partie du Mazendèran. Cette province appartint
tour à tour à la Médie et au Khorassan, aussi la position
de Damghân, sur l’extrême frontière des deux
gouvernements, la rendit souvent un objet de contestation
entre les petits tyrans qui se partagèrent si souvent
la Perse. Il n’y a donc rien d’étonnant, qu’après
tant de vissicitudes, cette ville ne soit plus à présent
que l’ombre de ce qu’elle a été. Plusieurs souverains
la réédifièrent successivement. Ce fut Châh-Abbas le
Grand qui la reconstruisit le dernier, et fit élever l’enceinte
actuelle, qui a près d’une farsang de développement,
et contenait quinze mille maisons. Il y a là de
nombreuses ruines qui attestent leur existence : il n’en
reste plus que trois centvingt-six d’habitées. Des jardins
et des cultures assez vastes remplacent à présent les
constructions. Les troubles qui suivirent la mort de Na-
der^Châh commencèrent la décadence de Damghân, et
le prince Abbas-Mirza lui porta le dernier coup quand,