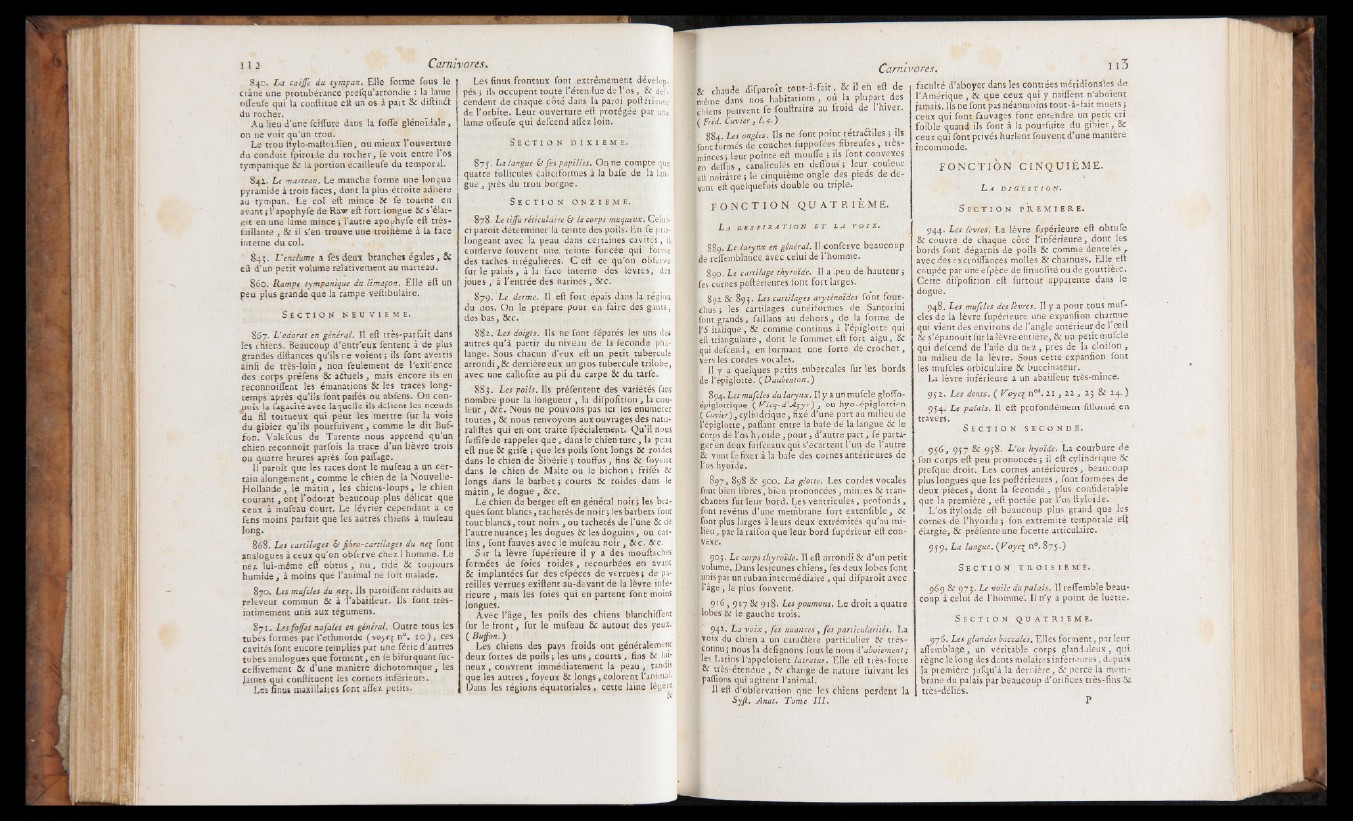
ISPH
84c. La caijfe du tympan. Elle forme fous le
crâne une protubérance prefqu’arrondie : la lame
offeufe qui la conftitue eft un os à paît & diftinéfc
du rocher.
Au lieu d’une fciffure dans la foffe glénoïdale,
on ne voit qu’ un trou.
Le trou Itylo-maltoïdien, ou mieux l’ouverture
du conduit fpiroïde du rocher, fe voit entre l’os
tympanique & la portion écailleufe du temporal.
841. Le marteau. Le manche forme une longue
pyramide à trois faces, dont la plus étroite adhère
au tympan. Le col eft mince 8c fe tourne en
avant ; l’ apophyfe de Raw eft fort longue & s’élargit
en une lame mince ; l’autre apophyfe eft très-
laillante , & il s’en trouve une troifième à la face
interne du col.
843. U enclume a fes deux branches égales, &
eft d'un petit volume relativement au marteau.
860. Rampe tympanique du limaçon. Elle eft un
peu plus grande que la rampe veftibulaire.
S e c t i o n n e u v i è m e .
867. U odorat en général. 11 eft très-parfait dans
les chiens. Beaucoup d'entr’eux fentent à de plus
grandes diftances qu’ils ne voient s ils font avertis
âinfi de très-loin, non feulement de l’exil'ence
des corps préfens & athiels, mais encore ils en
reconnoiffent les émanations & les traces longtemps
après qu’ ils font palfés ou abfens. On con-
noît la fagacité avec laquelle ils délient les noeuds
du fil toitueux qui peut les mettre fur la voie
du gibier qu’ils pourfuivent, comme le dit Buf-
fon. Valefcus de Tarente nous apprend qu’un
chien reconnoît parfois la trace d’ un lièvre trois
ou quatre heures après fon paffage.
Il paroît que les races dont le mufeau a un certain
alongement, comme le chien de la Nouvelle-
Hollande, le mâtin, les chiens-loups, le chien
courant, ont l’ odorat beaucoup plus délicat que
ceux à mufeau court. Le lévrier cependant a ce
fens moins parfait que les autres chiens à mufeau
long.
868. Les cartilages & fibro-cartilages du ne\ font
analogues à ceux qu’on obferve chezlhomme. Le
nez lui-même eft obtus , n u, ridé & toujours
humide, à moins que l’animal ne foit malade.
870. Les mufcles du nez. Ils paroiffenc réduits au
releveur commun & àTabaiiïeur. Ils font très-
intimement unis aux tégumens.
871. Lesfojfes nafales en général. Outre tous les
tubes formés par l’ethmoïde (voye^ n°. 10) , ces
cavités font encore remplies par une férié d’autres
tubes analogues que forment, en fe bifurquant fuc-
ceffivement & d’une manière dichotomique, les
lames qui conflituent les cornets inférieurs.
Les finus maxillaiies font allez petits.
Les finus frontaux font extrêmement dévelop. I
pés 5 ils occupent toute l'étendue de l’ o s , & def- I
cendent de chaque côté dans la paroi poftérieure I
de l’ orbite. Leur ouverture eft protégée par une I
lame offeufe qui defcend affez loin.
S e c t i o n d i x i è m e .
875. La langue & fes papilles. On ne compte que I
quatre follicules caliciformes à la bafe de la lan- I
gue , près du trou borgne.
S e c t i o n o n z i è m e .
878. Le tijfu réticulaire & le corps muqueux. Celui- I
ci paroît déterminer la teinte des poils. En fe pro- I
longeant avec la peau dans certaines .cavités, il I
conferve fouvent une. teinte foncée qui forme I
des taches irrégulières. C elt ce qu’on obferve f
fur le palais, à la face interne des lèvres, des I
joues , à l’entrée des narines, &c.
879. Le derme. Il eft fort épais dans la région |
du dos. On le prépare pour en faire des gants, I
des bas, &c.
882. Les doigts. Ils ne font féparés les uns de« I
autres qu’ à partir du niveau de la fécondé phi- I
lange. Sous chacun d’eux eft un petit tubercule I
arrondi, & derrière eux un gros tubercule trilobé, I
avec une callofité au pli du carpe & du tarfe.
883. Les poils. Ils préfentent des variétés fans I
nombre pour la longueur , la difpofition , la cou* I
leur, & c . Nous ne pouvons pas ici les énumérer I
toutes, & nous renvoyons aux ouvrages des natu- I
raliftes qui en ont traité fpécialement. Qu’il nous f
fufïïfede rappeler que, dans le chien turc , la peau I
eft nue & grife ; tjue les poils font longs & roides I
dans le chien de Sibérie ; touffus, fins & foyeux I
dans le chien de Malte ou le bichon ; frifés & I
longs dans le barbet; courts & roides dans le I
mâtin, le dogue , & c .
Le chien de berger eft en général noir; les bra-1
ques font blancs, tachetés de noir; les barbets font I
tout blancs, tout noirs, ou tachetés de l’ une & de I
l’autre nuance; les dogues & lesdoguins, ou car* I
lins, font fauves avec le mufeau noir, &c. &c.
Sur la lèvre fupérieure il y a des mouftaches I
formées de foies roides, recourbées en avant I
& implantées fur des efpèces de verrues; de pa- I
reilles verrues exiftent au-devant de la lèvre infé* I
rieure , mais les foies qui en partent font moins |
longues.
Avec l’âge, les poils des chiens blanchiffent I
fur le front, fur le mufeau & autour des yeux.
( Buffon. ) 1
Les chiens des pays froids ont généralement
deux fortes de poils ; les uns, courts, fins & la» I
neux, couvrent immédiatement la peau, tandis I
que les autres, foyeux & longs,colorent l’animal. ,
Dans les régions équatoriales, cette laine légère
cl I
chaude difparoît tout-à-fait, &r il efi eft de ;
même dans nos habitations, ou la plupart des
[chiens peuvent fe fouftraire au froid de 1 hiver. ;
[( Fréd. Cuvier, L e .)
f 884. Les ongles. Ils ne font point rétractiles ; ils [ifont formés de couches fuppofées fibreufes, très*
[niinces; leur pointe eft moufle ; ils font convexes
en deflus, canaliculés en deffous ; leur couleur
lelt noirâtre ; le cinquième ongle des pieds de devant
eft quelquefois double ou triple.
I F O N C T I O N q u a t r i è m e .
L a r e s p i r a t i o n e t l a v o i x .
1 889. Le larynx en général. Il conferve beaucoup
[de reffeinblance avec celui de l’homme,
i 890. Le cartilage thyroïde. II a .peu de hauteur ;
[fes cornes poftérieures font Fort larges,
i 892 & 893 . Les cartilages aryténoïdes font four-
[chus ; les cartilages cunéiformes de Santorini
[font grands, faillans au dehors, de la fornie de
[l’5 italique, & comme continus à l’épiglotte qui
«eft triangulaire, dont le fommet eft fort aigu, &
iqui defcend, en formant une forte ^ de crochet,
■ vers les cordes vocales.
! Il y a quelques petits tubercules fur les bords
g de l’épiglotte. ( Daubenton.)
I 894. Les mufcles du larynx. Il y a un mufcle gloflo-
lépiglottique {Vicq-d' A^yr) , ou hyo-épiglottien
|( Cuvier)3 cylindrique, fixé d’ une part au milieu de
«l’épiglotte, paffanc entre la bafe de la langue & le
Icorps de l’os hyoïde, pour, d’autre part, fé parta-
Jgeren deux faifeeaux qui s’écartent l’un de l’ autre
|& vont fe fixer à la bafe des cornes antérieures de
l’os hyoïde.
B . 897, 898 & 900. La glotte. Les cordes vocales
Ifont bien libres, bien prononcées, minces & tran-
jehantes fur leur bord. Les ventriculès, profonds,
Ifont revêtus d’une membrane fort extenfible, &
Ifont plus larges à leurs deux extrémités qu’au millieu,
par la raifon que leur bord fupérieur eft con-
jvexe.
B 905. Le corps thyroïde. Il eft arrondi & d’ un petit
I volume. Dans les jeunes chiens, fes deux lobes font
: unis par un ruban intermédiaire, qui difparoît avec
B ’âge, le plus fouvent.
K 9,6j 9i7 & 9 i8. Les poumons. Le droit a quatre
1 lobes & le gauche trois.
K 9 4 La voix, fes nuances, fes particularités. La
voix du chien a un caradlère particulier & très-
j connu; nous la défignons fous ie nom d‘aboiement;
■ les Latins l’appeloient latratus. Elle eft très-forte
| & très-étendue, 8c change de nature fuivant les
i pallions qui agitent l’animal.
K 11 eft d’obfervation que les chiens perdent la
Syfi. Anat. Tome 111.
faculté d’aboyer dans les contrées méridionales de
l’Amérique, & que ceux qui y naiffent n'aboient
jamais. Ils ne font pas néanmoins tout-à-fait muets ;
ceux qui font fauvâges font entendre un petit cri
foible quand ils font à la pourfuîte du gibier, &
ceux qui font privés hurlent fouvent d’ une manière
incommode.
F O N C T I O N C I N Q U I È M E .
L a d i g e s t i o n .
S e c t i o n p r e m i è r e .
944. Les lèvres. La lèvre fupérieure eft obtufe
& couvre de chaque côté l’ inférieure, dont les
bords font dégarnis de poils & comme dentelés ,
avec des excroiffances molles & charnues. Elle eft
coupée par une efpèce de finuofité ou de gouttière.
Cette difpofition eft furtout apparente dans le
dogue.
948. Les mufcles des lèvres. Il y a pour tous mufcles
de la lèvre fupérieure une expanfion charnue
; qui vient des environs de l’angle antérieur de l’oeil
& s’épanouit fur la lèvre entière, & un petit mufcle
! qui defcend de l’aile du nez, près de la cloifon ,
au milieu de la lèvre. Sous cette expanfion font
les mufcles orbiculaire & buccinateur. -
La lèvre inférieure a un abaiffeur très-mince.
952. Les dents. ( Voye£ nos. 21 , 22 , 23 & 24. )
954. Le palais. Il eft profondément fïllonné en
travers.
S e c t i o n s e c o n d e .
9.f6» 957 Sc 958. L’os hyoïde. La courbure de
fon corps eft peu prononcée; il eft cylindrique &
prefqùe droit. Les cornes antérieures, beaucoup
plus longues que les poftérieures, font formées de
deux pièces, dont la fécondé, plus confidérable
que la première, eft portée par l’os ftyloïie.
L’os ftyloïde eft beaucoup plus grand que les
cornes de l’hyoïde ; fon extrémité temporale eft
élargie, & préfente une facette articulaire.
939. La langue. (Voye{ n°. 87J.)
S e c t i o n t r o i s i è m e .
969 & 973. Le voile du palais. Il reffemble beau*
coup à celui de l’homme". Il n’y a point de luette.
S e c t i o n q u a t r i è m e .
976. Les glandes buccales. Elles forment, par leur
affemblage, un véritable corps glanduleux, qui
règne le long des dents molaires inférieures, depuis
la première jufqu’à la dernière, & perce la membrane
du palais par beaucoup d’orifices très-fins 5c
très-déliés.
P