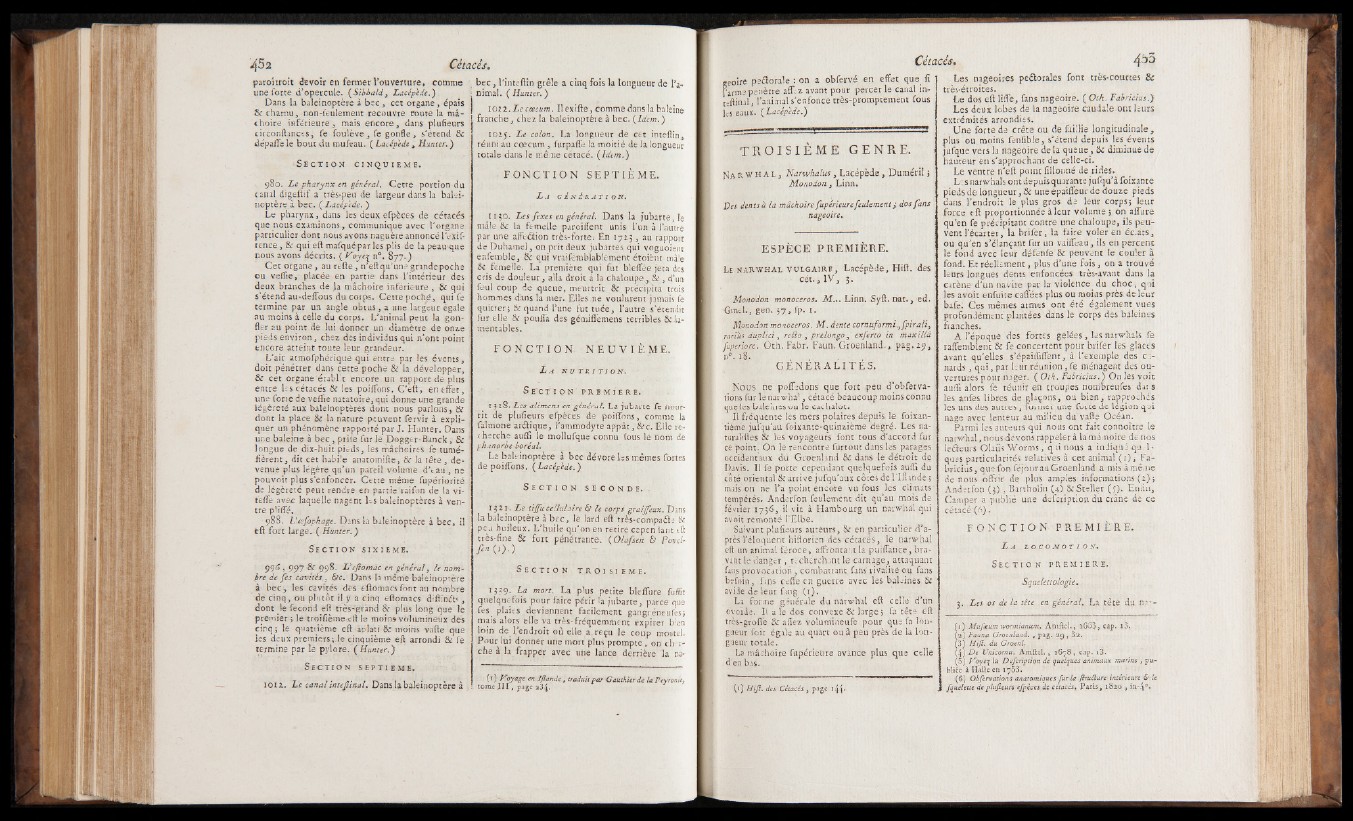
paroîtroit devoir en fermer l'ouverture, comme
une forte d’opercule. ( Sibbald} Lacépede.)
Dans la baleinoptère à b e c , cet organe, épais
& charnu, non-feulement recouvre route la mâchoire
inférieure , mais ehcore, dans plufieurs
ci-rconfhnces, fe foulève, fe gonfle, s’étend &
dépafle le bout du mufeau. ( Lacépede , Hunter. )
S e c t i o n c i n q u i è m e .
> 980. Le pharynx en général. Cette portion du
canal digeftif a'très-peu de largeur dans la balei-
noptère à bec. ( Lacépede. )
Le pharynx, dans les deux efpèces de cétacés
que nous examinons , communique avec l’organe
particulier dont nous avons naguère annoncé lVxif-
tence, & qui eft mafquéparles plis de la peamque
nous avons décrits. ( Foyei n°. 877.^
Cet organe, au refte, n’ eft qu’une grande poche
ou velfie, placée en partie dans l’intérieur des
deux branches de )a mâchoire inférieure , & qui
s’étend au-deffous du corps. Cette poche', qui fe
termine par un angle obtus, a une largeur égale
au moins à celle du corps. L’animal peut la gonfler
au point de lui donner un diamètre de onze
pieds environ, chez des individus qui n’ont point
encore atteint toute leur grandeur.
L’air atmofphérique qui entre par les évents,
doit pénétrer dans cette poche & la développer,
& cet organe ‘établit encore un rapport de plus
entre k s cétacés & les poiffons. C ’eft, en effet,
une forte de veffie natatoire, qui donne une grande
légèreté aux baleinoptères dont nous parlons, &
dont la place & la nature peuvent fervit à expliquer
un phénomène rapporté par J. Hunter. Dans
une baleine à b e c , prife fur le Dogger-Banck, &
longue de dix-huit pieds, les mâchoires fe tuméfièrent,
dit cet habile anatomifte, & la tê te , devenue
plus légère qu’un'pareil volume dkauj, ne
pouvoit plus s’enfoncer. Cette même fupériorité
de légèreté peut rendre en partie raifon de la vi-
teffe avec laquelle nagent les baleinoptères à ventre
pliffé.
988. U.oefophage. Dans la baleinoptère à bec, il
tft fort laige. ( Hunter.)
S e c t i o n s i x i è m e .
996 §997 $>98. L ’ eft0màc en général, le nombre
de fes cavités, &c. Dans la même baleinoptère
à bec-, les cavités dés eftbmacsfont au nombre
de cinq, ou plutôt il ÿ a cinq eftomacs diftinck ,
dont le fécond eft très^grând & plus long que le
premier ; le troifième'.eft le moins volumineux des
cinq j le quatrième eft aplati & moins vafte que
les deux premiers;.le cinquième eft arrondi & fe
termine par le pylore. ( Hunter.)
S e c t i o n s e p t i è m e .
1012. Le canal inteÿinal. Dans la baleinoptère à
b e c , l’inteftin grêle a cinq fois la longueur de l’animal.
(Hunter.)
1021. Le cæcum. Ilexifte, comme dans la baleine
franche, chez la baleinoptère à bec. (Idem.)
I02y. Le colon. La longueur de cet inteftin,
réuni au cæcum, furpaffe la moitié de la.longueur
totale dans le même cétacé. (Idem.)
F O N C T I O N S E P T I È M E .
L a g I ngrat 1 on.
1130. Les fexes en général. Dans la jubarte, le
mâle & la femelle puroiffent unis l'un à l’autre
par une affeétion très-forte.' En 1725, au rapport
de Duhamel, on prit deux jubartes. qui voguoient
enfemble, & qui vraifemblablement étoiént mâle
& femelle. La première qui fut bleffée jeta des
cris de douleur, alla droit à la chaloupe, & | d’un
feul coup de queue, meurtrit & précipita trois
hommes dans la mer. Elles ne voulurent jamais fe
quitter j & quand l’une fut tuée, l’autre s’étendit
fur elle & pouffa des gémiffemens terribles &: lamentables.
F O N C T I O N N E U V I È M E .
L a vu tr i ti on.
S E'CT I O N P REMI E R E.
1318. Les alimens en général. La jubarte fe nourrit
de plufieurs efpèces de poiffons, comme la
falmone arétique, Kammodyte appât, &c. Elle recherche
auffi le mollufque connu fous lé nom de
pkandrbe boréal.
La baleinoptère à bec dévore les mêmes fortes
de poiffons. (Lacépede.)
S e c t i o n s e c o n d e . .
1321. Le tiffu cellulaire & le corps graijfeux. Dans
la baleinoptère à bec, le lard eft très-compa-éle &
peu huileux. L’ huile qu’ on en retire cep en la rit tft
très-fine & fort pénétrante. (Olafsen & Povcl-
/ ^ ( 0 0 . |
S e c t i o n t r o i s i è m e .
1339. La mort. La plus petite bleffure fuffit
quelquefois pour faire périr la jubarte, parce que
fes plaies deviennent facilement gangréneufes*
mais alors elle va très-fréquemment expirer b:en
foin de 1/endroit où elle a reçu le coup mortel.
Pour lui donner une mort plus prompte, on clvr-
che à la frapper avec une lance derrière la na-
( t ) V oyage en Jftande , traduit par Gauthier de la Peyronie,
tome JII, page 234.
geoire pe&orale : on a obfervé en effet que fi
l’arme pénètre aflkz avant pour percer le canal in-
teftinal, l’animal s’enfonce très-promptement fous
les eaux. (Lacépede.)
T R O I S I È M E G E N R E .
Na r w h a l , Narwhalus, Lacépède, Duméril j
Monodon , Linn.
Des dents a la mâchoire fupêrieure feulement y dos fans
nageoire..
E S P È C E P R E M I È R E .
Le n a r w h a l v u l g a ir e , Lacépède, Hift. des
c é t., IV , 3.
Monodon monoceros» M... Linn. Syft. nat., ed.
■ G me h , gen. 37, fp. 1.
Monodon monoceros. M. dente cornuformi.,fpirali,
rariiis duplici, recto , pr&longo 3 exferto in maxillâ
fuperiore. Oth. Fabr. Faun. Groenland., pag.29,
M K B
G E N E R A L I T E S ,
Nous ne' pofledôns que fort peu d’obferva- ;
tions fur le narwhal, cétacé beaucoup moins connu
que les baleines ou le cachalot.
Il fréquente les mers polaires depuis le foixan-
tième jufqu’au foixante-quinzième degré. Les na-
turaîiftes & les voyageurs font tous d’accord fur
ce point. Ôn le rencontre fur tout dans les parages
occidentaux du Groenland & dans le détroit de
Davis. Il fe porte cependant quelquefois suffi du
côté oriental & arrive jufqu’aux côtes de l'ifhnde ;
mais on ne l ’a point encoVe vu fous les climats
tempérés. Anderfon feulement dit qu’ au mois de
février 1736, il vie à Hambourg un narwhal qui
avoit remonté l’Elbe.
Suivant plufieurs auteurs, & en particulier d’ après
l’éloquent hiftorien des cétacés, le narwhal
eft un animal féroce, affrontant la puiffance, bravant
le danger, recherchant le carnage, attaquant
fans provocation , combattant fans rivalité ou fans
b e foin, fins ceffe en guerre avec les bak-ines &
avide de leur fan g (1).
La forme générale du narwhal eft celle d’un
ovoïde. Il ale dos convexe & large ; fa tête éft
très-groffe & allez volumineufe pour que fa longueur
foie égale au quart ou à peu près de la longueur
totale.
La mâchoire fupériëüre avance plus que celle
d’en bas.
Les nageoires pe&orales font très-courtes &
très-étroites.
Le dos eft liffe, fans nageoire. ( Oth. Fabricius.)
Les deux lobes de la nageoire caudale>onc leurs
extrémités arrondies.
Une forte de crête ou de faillie longitudinale,
plus ou moins fenfible, s’étend depuis les évents
jufque vers la nageoire de la queue, & diminue de
hauteur en s’approchant de celle-ci.
Le ventre n’eft point fillonné de rides.
L:s narwhals ontdepuisquarante jufqù’ à foixante
pieds de longueur, & une épaiffeur de douze pieds
dans l’endroit le plus gros de leur corps* leur
force eft proportionnée à leur volume* on affure
qu'en fe préc ipitant contre une chaloupe, ils peu-
ventl’écarter, la brifer, la faire voler en éc.ats,
ou qu'en s’élançant fur un vaiffc.au, ils en percent
le fond avec leur défenfe & peuvent le couler à
fond. Et réellement, plus d’une fo is , on a trouvé
leurs longues dents enfoncées très-avant dans la
carène1 d'un navire par la violence du ch o c , qui
les avoit enfui ce xaflees plus ou moins près de leur
bafel Ces mêmes armes ont été également vues
profondément plantées dans le corps des baleines
franches.
A l’époque des fortes gelées , les narwhals fe
raffembl.ent & fe concertent pour brifer les glaces
avant qu’elles s’épaiififfent, à l’exemple des canards
, qui, par kur réunion , fe ménagent des ouvertures
pour nager. ( Oth. Fabricius.) On les voit
auftï alors fe réunir en troupes nombreufes da; s
les anfes libres de glaçons, ou bien, rapprochés
les uns des autres, former.une forte de légion qui
nage avec lenteur au milieu du vafte Océan.
Parmi les auteurs qui nous ont fait connoître le
narwhal, nous devons rappeler à la mémoire de nos
le&eurs Olatis Worms, q ii nous a indiqué qu l-
qurs particularités relatives à cet animal (1), Fabricius,
quefon féjôur au Groenland a mis à même
de nous offrir de plus amples informations (2}*
Anderfon (3), Barthoiin (4) & Steller (y). Enfin,
Camper a publié une defeription du crâne de ce
cétacé (6)I
F O N C T I O N P R E M I È R E.
L a l o c o m o t i o n .
S e c t i o n p r e m i è r e .
Squelettologie.
3. Les os de la tête en général. La tête du n:v-
(j.) Mufieum wormianum. Amftel., iGS3, cap. i 3.
(2) Pauna Groenland. , pag. 29, 32.
(3) Hift. du Groenl.
(4) De Vnicornu. Amftel. , 1678, cap. i3.
(5) y’oye\ la Defeription de quelques animaux marins , publiée
à Halle erri753.
(6) Obfervations anatomiques fur la ftrufturc intérieure & le
fquelettc de plufieurs efpèces de cétacés.(1) Hift. des Cétacés , page 14-1* Paris, 1820 , ia-4°.