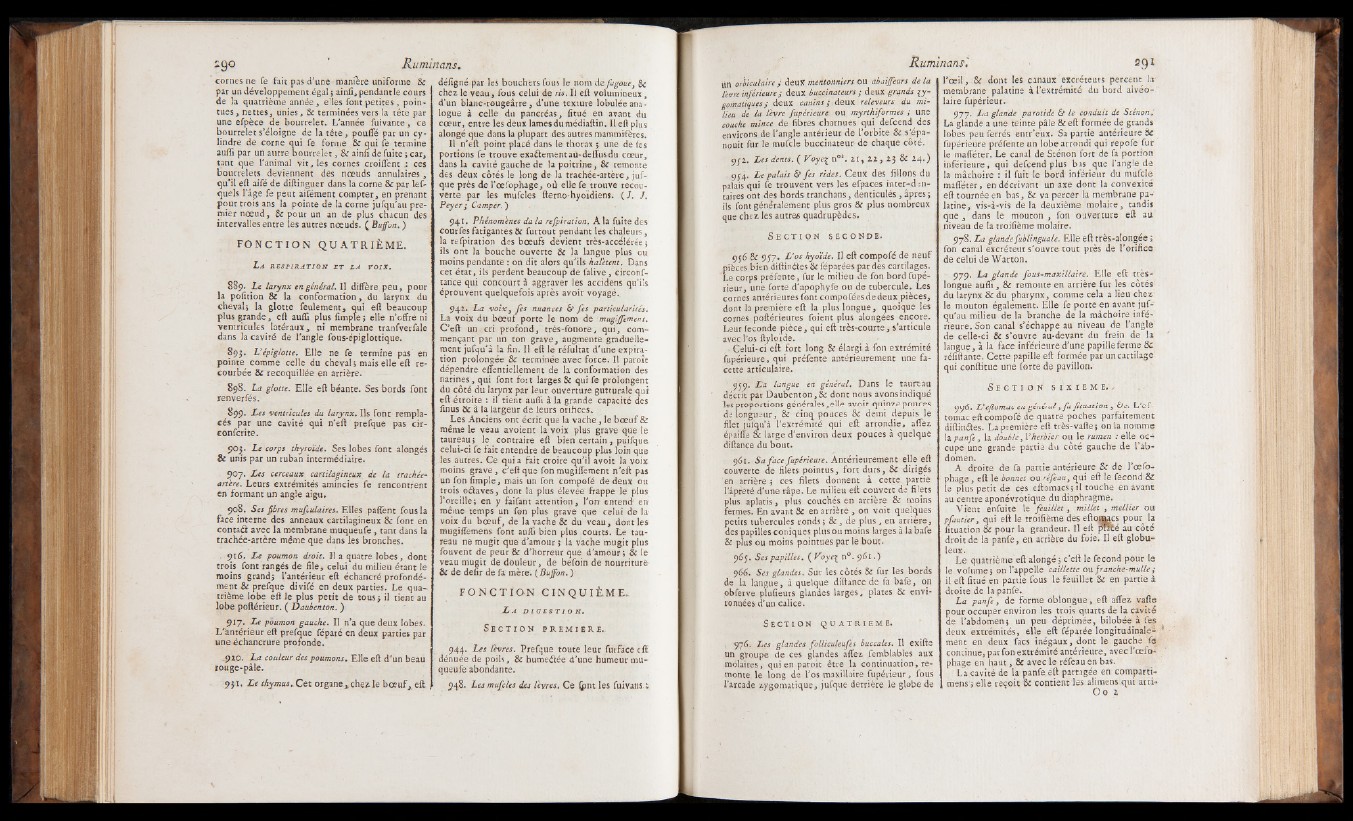
cornes ne fe fait pas d'une manière uniforme &
par un développement.égal ; ainfi, pendant le cours
de la quatrième année , elles font petites , pointues,
nettes, unies, & terminées vers la tête par
une efpèce de bourrelet. L'année fui vante, ce
bourrelet s'éloigne de la tê te , pouffé par un cylindre
de corne qui fe forme & qui fe termine
aufli par un autre bourrelet, & ainh de fuite ; car,
tant que l'animal v it , les cornes croiffent z ces
bourrelets deviennent des noeuds annulaires,
qu'il eft aifé de diftinguer dans la corne & par lesquels
l'âge fe peut aifément compter, en prenant
pour trois ans la pointe de la corne jufqu'au premier
noeud, & pour un an de plus chacun des
intervalles entre lés autres noeuds. ( Buffon. )
F O N C T I O N Q U A T R I È M E .
La r es p i rat ion e t l a v oix.
88p. Le larynx en général. Il diffère peu, pour
la pofition & la conformation, du larynx du
chevalj la glotte feulement, qui eft beaucoup
plus grande, eft aufli plus fimple ; elle n'offré ni
ventricules latéraux, ni membrane tranfverfale
dans la cavité de l'angle fous-épiglottique.
893. Vépiglotte. Elle ne fe termine pas en
pointe comme celle du cheval 5 mais elle eft recourbée
& recoquillée en arrière.
898. La glotte. Elle eft béante. Ses bords font
renverfés.
899. Les ventricules du larynx. Ils font remplacés
par une cavité qui n'eft prefque pas cir-
confcrite.
903. Le corps thyroïde. Ses lobes font alongés
& unis par un ruban intermédiaire. 1
907. Les cerceaux cartilagineux de la trachée-
artère. Leurs extrémités amincies fe rencontrent
en formant un angle aigu.
908. Ses fibres musculaires. Elles paffent fous la
face interne des anneaux cartilagineux & font en
eontaéfc avec la membrane muqueufe, tant dans la
trachée-artère même que dans les bronches.
. 916. Le poumon droit. Il a quatre lobes, dont
trois font rangés de file, celui du milieu étant le
moins grand; l’antérieur eft échancré profondément
& prefque divifé en deux parties. Le quatrième
lobe eft le plus petit de tous > il tient au
lobe poflérieur. ( Daubenton. )
917. Le poumon gauche. U n’a que deux lobes*
L'antérieur eft prefque féparé en deux parties par
une échancrure profonde.
.920. La couleur des poumons. Elle eft d'un beau
rouge-pâle.
931. Le thymus,. C et organe* ch e z le boe u f,e f t
défigné par les bouchers fous le nom defugoue, &
chez le veau, fous celui de ris. Il eft volumineux,
d’un blanc-rougeârre, d’une texture lobulée analogue
à celle du pancréas, iïtué en avant du
coeur, entre les deux lames du médiaftin. Il eft plus
alongé que dans la plupart des autres mammifères.
Il n'eft point placé dans le thorax ; une de fes
portions fe trouve exactement au-deffus du coeur,
dans la cavité gauche de la poitrine, & remonte
des deux côtés le long de la trachée-artère, juf-
que près de l'oefophage, où elle fe trouve recouverte
par les mufcles fterno-hyoïdiens. (J . J.
Beyer ; Camper.')
941. Phénomènes da la refpiration. A la fuite des
courfes fatigantes St furtout pendant les chaleurs,
la refpiration des boeufs devient très-accélérée;
ils ont la bouche ouverte & la langue plus ou
moins pendante : on dit alors qu'ils halètent. Dans
cet état, ils perdent beaucoup de falive, circonf-
tarice qui concourt à aggraver les accidens qu’ils
éprouvent quelquefois après avoir voyagé.
942» La voix, fes nuances & fes particularités.
La voix du boeuf porte le nom de mugiffement.
C'eft un cri profond, très-fonore, qui, commençant
par un ton grave, augmente graduellement
jufqu'à la fin. Il eft le réfultat d’une expiration
prolongée & terminée avec force. Il paroîc
dépendre effentiellement de la conformation des
narines, qui font foit larges & qui fe prolongent
du côté du larynx par leur ouverture gutturale qui
eft étroite : il tient aufli à la grande capacité des
finus & à la largeur de leurs orifices.
Les Anciens ont écrit que la vache, le boeuf &
même le veau avoient la voix plus grave que le
taureau} le contraire eft bien certain, puifque
celui-ci fe fait entendre de beaucoup plus loin que
les autres. Ce qui a fait croire qu'il avoit la voix
moins grave, c'eft que fon mugiffement n'eft pas
un fon fimple, mais un fon compofé de deux ou
trois oCtaves, dont la plus élevée frappe le plus
l’oreille; en y faifant attention, l’on- entend en-
même temps un fon plus grave que celui de la
voix du boeuf, de la vache & du veau, donc les
mugiffemens font aufli bien plus courts. Le taureau
ne mugit que d'amour > la vache mugit plus
fouveftt de peur & d'horreur que d’amour; & le
veau mugit de douleur, de befoin de nourriture-
& de defir de fa mère. [ Buffon. )
F O N C T I O N C I N Q U I È M E .
L a l LG EST IO N.,
S e c t i o n p r e m i è r e ..
944. Les lèvres. Prefque toute leur furfâce eft
dénuée de poils, & humeCtée d’une humeur muqueufe
abondante.
948. Les mufcles des lèvres. Ce Çpnt les fuivans t
un orïiculalre ; deut ihehtonniers OU abaijfeurs de la
lèvre inférieure ; deux buccinateurs ; deux grands zygomatiques;
deux canins; deux releveurs du milieu
de la lèvre Supérieure ou myrthiformes ; une
couche mince de fibres charnues qui defcend des
environs de l’angle antérieur dé l'orbite & s’épanouit
fur le mufde buccinateur de chaque côté.
932. Les dents. ( Voyez nos. 21 , 22, 23 & 24.)
934. Le palais & fes rides. Ceux des filions du
palais qui fe trouvent vers les efpaces inter-diii-
taires ont des bords tranchans, denticulés, âpres;
ils font généralement plus gros & plus nombreux
que chez les autre* quadrupèdes.
S e c t i o n , s e c o n d e .
oc6 & 957. L ’os hyoïde. Il eft compofé de neuf
pièces bien diftinétes & féparées par des cartilages.
Le corps préfente, fur le milieu de fon bord fupé-
rieur, une forte d’apophyfe ou de tubercule. Les
cornes antérieures font compofées de deux pièces,
dont la première eft la plus longue, quoique les
cornes poftérieures foient plus alongées encore.
Leur fécondé pièce, qui eft très-courte, s’articule
avec l'os ftyloide.
Celui-ci e it fort long & élargi à fon extrémité
fupérieure, qui préfente antérieurement une facette
articulaire.
' 9^9. La langue en général. Dans le taureau
décrit par Daubenton, & donc nous avons indiqué
les proportions générales,elle avoir quinze pouces
de longueur, & cinq pouces & demi depuis le
filet jufqu’à l’extrémité qui eft arrondie, affez
épaiffe & large d’environ deux pouces à quelque
diftançe du bout.
: 961. Sa face Supérieure. Antérieurement elle eft
•couverte de filets pointus, fort durs, & dirigés
en arrière; ces filets donnent à cette partie 1’,âpreté d’une râpe. Le milieu eft couvert de filets
plus aplatis, plus couchés en arrière & moins
fermes. En avant & en arrière , on voit quelques
petits tubercules ronds; & , de plus, en arrière,
des papilles coniques plus ou moins larges à la bafe
& plus ou moins pointues par lè bout.
965. Ses papilles. ( Voyez n°. 9^1 •)
966. Ses glandes. Sur les côtés & fur les bords
de la langue, à quelque diftançe de fa bafe, on
obferve plufieurs glandes larges, plates & environnées
d’ un calice.
S e c t i o n q u a t r i è m e .
. 976. Les glandes folliculeufes buccales. Il exifte
un groupe de ces glandes affez femblables aux
molaires, qui en paroît être la continuation, remonte
le long de l’os maxillaire fupérieur, fous
l’arcade zygomatique, jufque derrière le globe de
l’oeil, & dont les canaux excréteurs percent la
membrane palatine à l’extrémité du bord alvéolaire
fupérieur.
977. La glande parotide & le conduit de Sténonl
La glande a une teinte pâle & eft formée de grands
lobes peu ferrés entr’èux. Sa partie antérieure 3c
fupérieure préfente un lobe arrondi qui repofe fur
le mafféter. Le canal de Sténon fort de fa portion
inférieure, qui defcend plus bas que l’angle de
la mâchoire : il fuit le bord inférieur du mufcle
mafféter, en décrivant un axe dont la convexité
eft tournée en bas, & va percer la membrane palatine,
vis-à-vis d elà deuxième molaire, tandis
q u e , dans le mouton , fon ouverture eft au
niveau de la troifième molaire.
978. La glande fublinguale. Elle eft très-alongée j
fon canal excréteur s’ouvre tout près de l’orifice
de celui de Warton.
' 979. La glande fous-maxillaire. Elle eft très-
longue aufli, & remonte en arrière fur les côtés
du larynx & du pharynx, comme cela a lieu chez
le mouton également. Elle fe porte en avant jufqu'au
milieu de la branche de la mâchoire inférieure.
Son canal s’échappe au niveau de l’angle
de celle-ci & s’ouvre au-devant du frein de la
langue, à la face inférieure d’une papille ferme &
réfiftante. Cette papille eft formée par un cartilage
qui conftitue une forte de pavillon.
S e c t i o n s i x i è m e ./
996. L'eflomac en général 3 fa fituation, L'ef-
tomac eft compofé de quatre poches parfaitement
diftin&es. La première eft très-vafte; on la nomme
la panfe, la double, Vherbier ou le rumen : elle occupe
une grande partie du côté gauche de l’àb-
domen.
A droite de fa partie antérieure & de l’oefo-
phage, eft le bonnet ou réfeau3 qui eft le fécond &
le plus petit de ces eftomacs; il touche en avant
au centre aponévrorique du diaphragme.
Vient enfuite le feuillet, millet , mellier ou
pfautier 3 qui eft le troifième des eft ° ma es pour la
fituation & pour la grandeur. Il eft ^rcé au côté
droit de la panfe, en arrière du foie. Il eft globuleux.
Le quatrième'eft alongé; c’eft le fécond pour le
le volume; on l’appelle caillette ou franche-mulle;
il eft fitué en partie fous le feuillet 81 en partie à
droite de la panfe*
La panfe, de forme oblongue, eft affez vafte
pour occuper environ les trois quarts de la cavité
de l’abdomen; un peu déprimée, bilobée à fes
; deux extrémités, elle eft réparée longitudinalement
en deux facs inégaux, dont le gauche fe
continue, par fon extrémiré antérieure, avec l’oefo-
phage en haut, & avec le réfeau en bas.
La.cavité de la panfe, ëft partagée en comparti-
mens ; elle reçoit & contient les.alimens qui arri-
O o 2