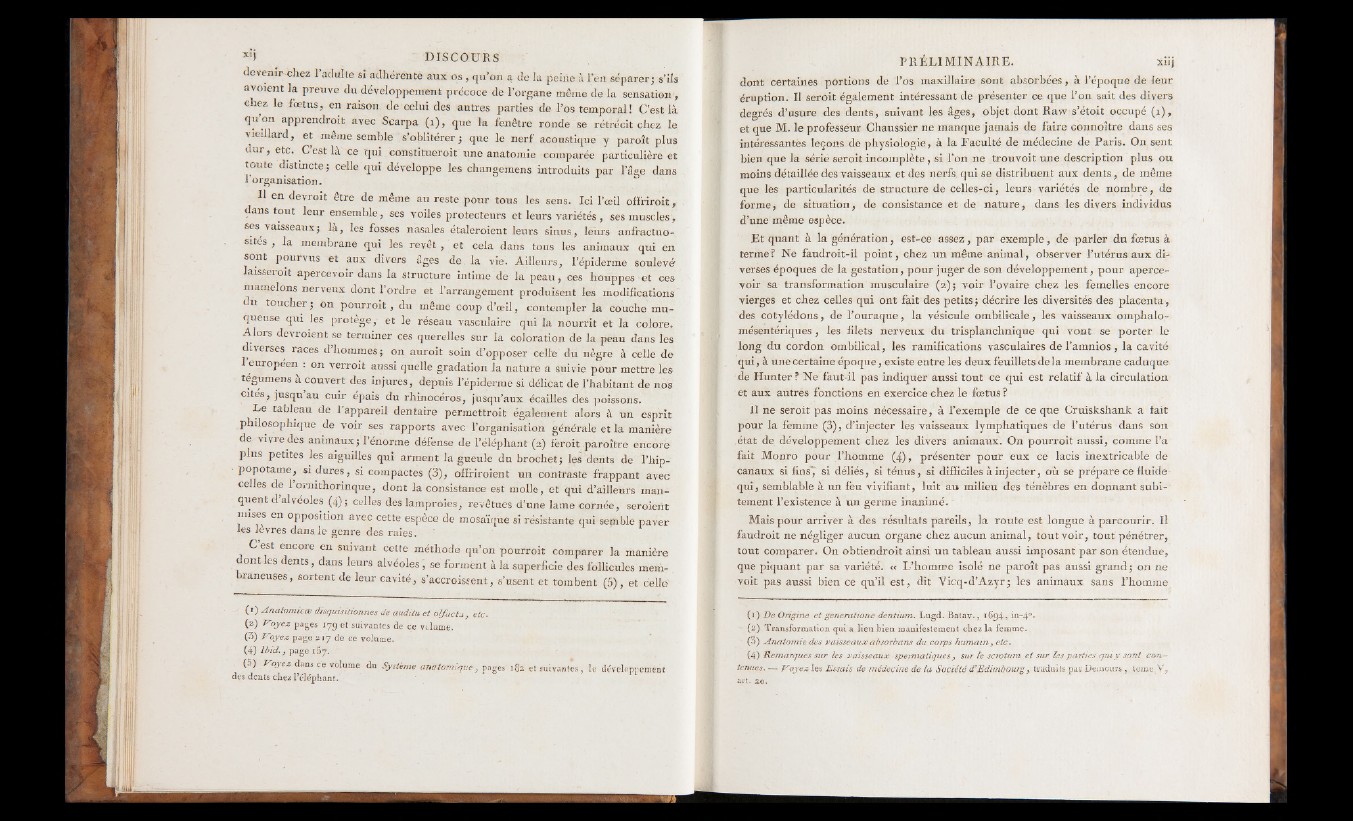
devenir chez l ’adulte si adhérente aux os , qu’on a de la peine à i’en séparer; s’ils
avoient la preuve du développement précoce de l ’organe même de la sensation,
chez le foetus, en raison de celui des autres parties de l ’os temporal! C’est là
qu’on apprendroit avec Scarpa (1), que la fenêtre ronde se rétrécit chez le
vieillard, et même semble s’oblitérer; que le nerf acoustique y paroît plus
dur , etc. C est la ce qui constitueroit une anatomie comparée particulière et
toute distincte; celle qui développe les changemens introduits par l ’âge dans
l ’organisation.
Il en devroit être de même au reste pour tous les sens. Ici l ’oeil offrirait,
dans tout leur ensemble, ses voiles protecteurs et leurs variétés , ses muscles;
ses vaisseaux; là , les fosses nasales étaleroient leurs sinus, leurs anfractuosités
, la membrane qui les revêt , et cela dans tous les animaux qui en
sont pourvus et aux divers âges de. la vie. Ailleurs, l ’épiderme soulevé
Iaisseroit apércevoir dans la structure intime de la peau, ces houppes et ces
mamelons nerveux dont l’ordre et l ’arrangement produisent les modifications
dù toucher ; on pourroit, du même coup d’oeil, contempler la couche muqueuse
qui les protégé, et le réseau vasculaire qui la nourrit et la colore.
Alors devroient se terminer ces querelles sur la coloration de la peau dans les
diverses races d’hommes ; on auroit soin d’opposer celle du nègre à celle de
1 européen : on verroit aussi quelle gradation la nature a suivie pour mettre les
tégumens à couvert des injures, depuis l ’épiderme si délicat de l’habitant de nos
cités, jusqu au cuir épais du rhinocéros, jusqu’aux écailles des poissons.
Le tableau de l ’appareil dentaire permettroit également alors à un esprit
philosophique de voir ses rapports avec l ’organisation générale et la manière
de vivre des animaux; 1 énorme défense de l’éléphant (2) ferait paroître encore
plus petites les aiguilles qui arment la gueule du brochet; les dents de l’hippopotame,
si dures, si compactes (3), offriraient un contraste frappant avec
celles de 1 ornithorinque, dont la consistance est molle, et qui d’ailleurs manquent
d alvéoles (4); celles des lamproies, revêtues d’une lame cornée, seroierit
mises en opposition avec cette espèce de mosaïque si résistante qui semble paver
les lèvres dans le genre des raies.
C est encore en suivant cette méthode qu’on pourroit comparer la manière
dont les dents, dans leurs alvéoles) se forment à la superficie des follicules membraneuses,
sortent de leur cavité, s’accroissent, s’usent et tombent (5), et celle'
(1) Anatomicoe disquisitionn.es de auditu et olfactu, etc.
(2) Voyez pages 179 et suivantes de ce volume.
(3) Fioyez page 217 de ce volume. (41 Ibid., page 157.
(5) Voyez dans ce Volume du Système anatomique , pages' 182 et suivantes , le développement
des dents chez l’éléphant.
dont certaines portions de l ’os maxillaire sont absorbées, à l’époque de leur
éruption. Il seroit également intéressant de présenter ce que l’on sait des divers
degrés d’usure des dents, suivant les âges, objet dont Raw s’étoit occupé (r),
et que M. le professeur Chaussier ne manque jamais de faire connoître dans ses
intéressantes leçons de physiologie, à la Faculté de médecine de Paris. On sent
bien que la sérié seroit incomplète , si l’on ne trouvoit une description plus ou
moins détaillée des vaisseaux et des nerfs qui se distribuent aux dents, de même
que lés particularités de structure de celles-ci, leurs variétés de nombre, de
forme, de situation, de consistance et de nature, dans les divers individus
d’une même espèce.
Et quant à la génération, est-ce assez, par exemple, de parler du foetus à
terme? Ne faudroit-il point, chez un même animal, observer l ’utérus aux diverses
époques de la gestation, pour juger de son développement, pour apercevoir
sa transformation musculaire (2) ; voir l’ovaire chez les femelles encore
vierges et chez celles qui ont fait des petits; décrire les diversités des placenta,
des cotylédons, de l’ouraque, la vésicule ombilicale, les vaisseaux omphalo-
mésentériques , les filets nerveux du trisplanchnique qui vont se porter le
long du cordon ombilical, les ramifications vasculaires de l’amnios , la cavité
qui, à une certaine époque, existe entre les deux feuillets de la membrane caduque
de Hiinter? Ne faut-il pas indiquer aussi tout ce qui est relatif à la circulation
et aux autres fonctions en exercice chez le foetus ?
Il ne seroit pas moins nécessaire, à l’exemple de ce que Cruiskshank a fait
pour la femme (3), d’injecter les vaisseaux lymphatiques de l’utérùs dans son
état de développement chez les divers animaux. On pourroit aussi, comme l’a
fait Monro pour l’homme (4) , présenter pour eux ce lacis inextricable de
canaux si fins") si déliés, si ténus, si difficiles à injecter, où se préparé ce fluide
qui, semblable à un feu vivifiant, luit au milieu des ténèbres en donnant subitement
l’existence à un germe inanimé. -
Mais pour arriver à des résultats pareils, la route est longue à parcourir. Il
faudrait ne négliger aucun organe chez aucun animal, tout voir, tout pénétrer,
tout comparer. On obtiendrait ainsi un tableau aussi imposant par son étendue,
que piquant par sa variété. « L ’homrpe isolé ne paroît pas aussi grand; on ne
voit pas aussi bien ce qu’il est, dit Vicq-d’A zyr; les animaux sans l ’homme
( ï) De Origine et generatione dentium. Lugd. Balav., 1694, in-40.
(2) Transformation qui a lieu bien manifestement chez la femme.
' (o) Anatomie des vaisseaux absorbant du corps humain, etc.
(4) Remarques sur les vaisseaux spermatiques, sur le scrotum et sur les parties qui y sont contenues.
— Voyez les Essais de médecine de la Société diEdimbourg> traduits par Uemours, tome V ,
art. 2e.