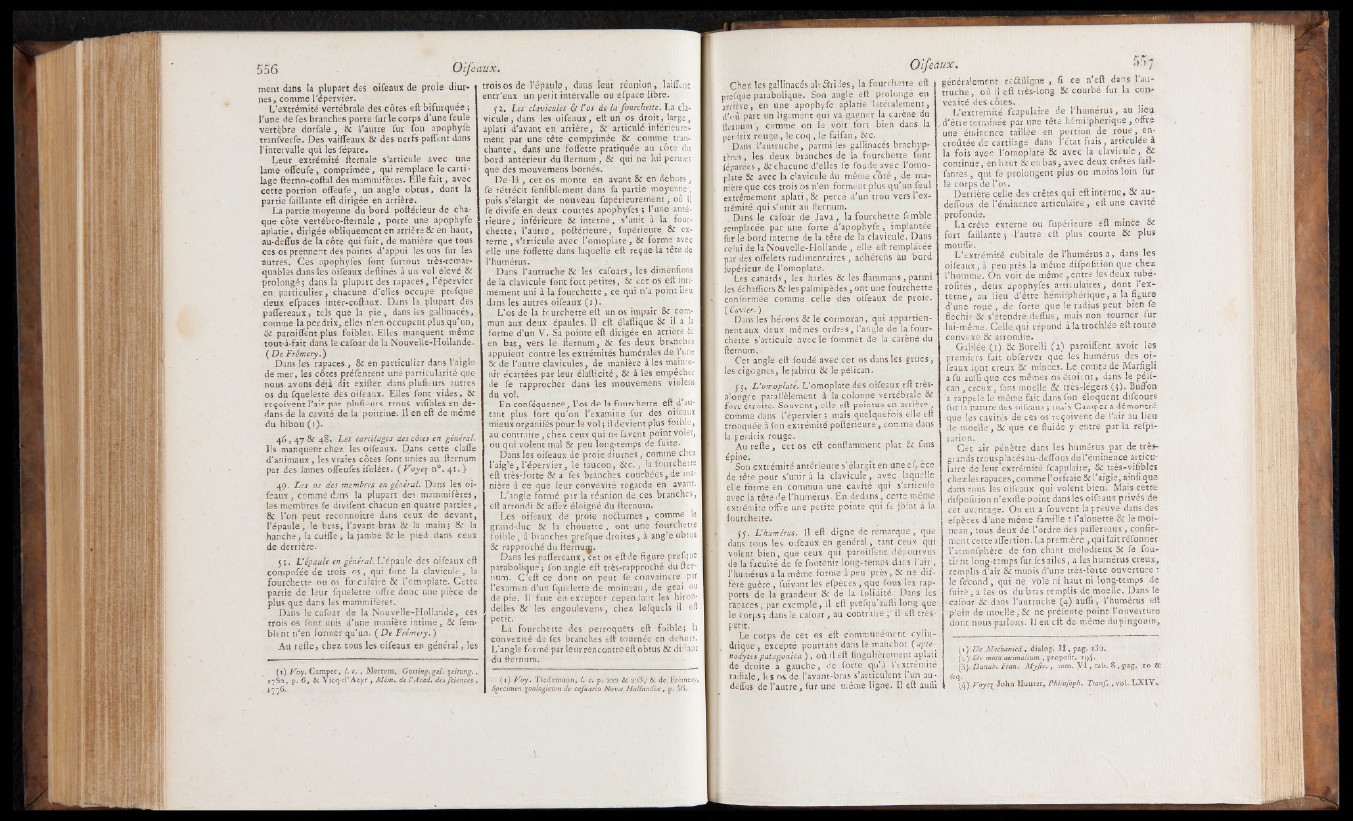
ment dans la plupart des oifeaux de proie diur-
lies., comme i'épervier.
L’extrémité vertébrale des côtes eft bifurquée;
l’une de Tes branches porte furie corps d’ une feule
vertèbre dorfale , & l’autre fur fon apophyfe
tranfverfe. Des vaifleaux & des nerfs pafTenc dans
l'intervalle qui les fépare.
Leur extrémité fternale s’articule avec une
lame offeufe, comprimée, qui remplace le cartilage
fterno-coftal des mammifères. Elle fa it, avec
cette portion offeufe, un angle obtus, dont la
partie Taillante eft dirigée en arrière.
La partie moyenne du bord poftérieur de chaque
côte vertébro-fternale, porte une apophyfe
aplatie, dirigée obliquement en arrière & en haut,
au-deffus de la côte qui fuit, de manière que tous
ces os prennent des points d’ appui les uns fur les
autres. Ces apophyfes font furtout très-remarquables
dans les oifeaux deftinés à un vol élevé &
prolongé} dans la plupart des rapacesy I’épervier
en particulier, chacune d’elles occupe prefque
deux efpaces inter-coftaux. Dans la plupart des
paffereaux, tels que la p ie , dans les gallinacés*^
comme la perdrix, elles n’en occupent plus qu’ un,
& paroiffent plus foibles. Elles manquent même
tout-à-fait dans le cafoar de la Nouvelle-Hollande.
( D e F r ém e r y .) .
Dans le* rapaces , & en particulier dans l’aigle^
de mer, les côtes prélément une particularité que
nous avons déjà dit exïfter dans plufieurs autres
os du fquelette des oifeaux. Elles font vides, &
reçoivent l’air par plufieurs trous vifibles en dedans
de la cavité de la poitrine. Il en eft de même
du hibou ( i) .
46, 47 & 48. L e s ca r tila g e s d es cô te s en g én é ra l.
Ils manquentxhez les oifeaux. Dans cette claffe
d’animaux, les vraies côtes font unies au fternum
par des lames offeufes ifolées. ( V oy e% n°. 4 1 .) 1
49. L e s o s d e s m em b re s en g én é ra l. Dans les oifeaux
, comme dans la plupart des mammifères,
les membres fe divifent chacun en quatre parties,-
& l'on peut reconnoître dans ceux de devant,
l’épaule, le bras, l’avant-bras & la main; & la
hanche, la cuiffe, la jambe & le pied dans ceux
de derrière.
51. U ép a u le en g én é ra l. L’épaule des oifeaux eft
compofée de trois os, qui font la clavicule, la
fourchette ou os fmculajre & l’ cmoplate. Cette
partie de leur fquelette offre donc une pièce de
plus qué dans les mammifères.
Dans le cafoar de la Nouvelle-Hollande, ces
trois os font unis d’ une manière intime, 8c fem-
blent n’en former qu’un. ( D e F r ém e r y . )
Au refte, chez tous les oifeaux en général, les
Yî) Foy. Camper, l. c. , Merrem, Gotting. gel. %eitung.,
1^82, p. 6, ôc Vicq-d'Azyr , Mém.. de l’Acad. des Jciences ,
M m
trois os de l’épaule, dans leur réunion, laiffcnt !
entr'eux un petit intervalle ou efpace libre.
52, L e s c la v i c u le s & F o s d e la fo u r c h e t t e . La clavicule,
dans les oifeaux, eft un os droit, large,
aplati d’avant en arrière, & articulé inférieure* j
mènt par une tête comprimée 8c comme tran* 1
chante , dans une foffette pratiquée au côté du ;
bord antérieur du fternum, & qui ne lui permet 1
que des mouvemens bornés.
De-là , cet os monte en avant & en dehors, j
fe rétrécit fenfiblement dans fa partie moyenne, !
puis s’élargit de nouveau fupérieurement, où il
fe divife en deux courtes apophyfes ; l’ une anté- j
rieure, inférieure & interne, s’ unit à la fourchette;
l’autre, poftérieure, fupérieure 8c ex-
| terne, s’articule avec l’omoplate, & forme avec
elle une foffette dans laquelle eft reçue la tête de ;
l’humérus. .
Dans l’autruche 8c lés cafoars, les dimenfions
de la clavicule font fort petites, 8c c e t os eft intimement
uni à la fourchette, ce qui n'a point lieu
dans les autres oifeaux (1 ).
L’os de la fr.urchette eft un os impair & çom- I
mun aux deux épaules. Il eft élaftique 8c il a la
forme d’un V. Sa pointe eft dirigée en arrière &
en bas, vers lé fternum, 8c fes deux branches
appuient contre les extrémités humérales de l’une
& de l’autre clavicules, de manière aies maintenir
écartées par leur élafticité, & à les empêcher
de fe rapprocher dans les mouvemens violeris
du vol.
En conféquence, l’os de la fourchette eft d’autant
plus fort qu'on l’examine fur des oifeaux
mieux organifés pour le vol ; il devient plus foible,
au contraire, chez ceux qui rie fa vent point voler,
ou qui volent mal & peu long-temps de fuite.
Dans les oifeaux de proie diurnes, comme chez
l’aigle, I'épervier, le faucon, & c . , la fourchette
eft très-forte 8c a fes branchés courbées, de manière
à ce que leur convexité regarde en avant.
L’angle formé par la réunion dexces branches,
eft arrondi 8c affez éloigné du fternum.
Les oifeaux de proie no&urnes,. comme le
grand-duc 8c la chouette , ont une fourchette
foible, à branches gréfque droites, à ang’eobtus
8c rapproché du fternum.
Dans les paffereaux, cet os eft de figure prefque
parabolique; fon angle eft très-vapproché du fternum.
C'eft ce dont1 on peut fe convaincre par
l ’examen d’ un fquelette de moineau, de geai ou
de pie. Il faut en excepter cependant les hirondelles
8c les engoulevens', chez lefquels il eft
petit.
La fourchette des perroquets eft foible; la
convexité de fes branches eft tournée en dehors.
L’angle formé par leur rencontre eft obtus & disant
du ftérnuni.
• (1) V^ôy. Tiedemann, /. c. p. 222 & 223/ & de. Eréiner/,.
Specimen 700logician de cafuario Nova Holland.ne, p. 56.
Chez les gallinacés ale éc ri des, la fourchette eft
prefque parabolique. Son angle eft prolongé en
arrière, en une apophyfe aplatie latéralement,
d’ où part un ligament qui va gagner la carène du
fternum , comme on le voit tort bien dans la
perdrix rouge, le co q , le faifan; &c.
Dans l’autruche, parmi les gallinacés brachyp-
tères, les deux branches de la fourchette font
féparées, & chacune d’elles fe foude^avec l’omoplate
& avec la clavicule du même c ô té , de manière
que ces trois os n’en forment plus qu’ un feul
extrêmement aplati, & percé d’un trou vers l’extrémité
qui s’ unit aii fternum.
Dans le cafoar de Java, la fourchette femble,
remplacée par une forte d’apophyfe, implantée
fur ie bord interne de la tête de la clavicule. Dans
celui de la Nouvelle-Hollande, elle eft remplacée
par des offelets rudimentaires , adhérens au bord
fupérieur de l’omoplate.
Les canards, les harles & les flammans, parmi
les échafliers 8c les palmipèdes, ont une, fourchette
conformée comme celle des oifeaux de proie.
( Cu vier . )
Dans les hérons & le cormoran, qui appartiennent
aux deux mêmes ordres, l’angle dé la fourchette
s’articule avec le fommet de la carène du
fternum.
Cet angle eft foudé avec cet os dans les grues,
les cigognes, le jabiru 8c le pélican.
y 3. L 'om o p la t e . L’omoplate des oifeaux eft très-
alongée parallèlement à la colonne vertébrale &
fort étroite. Souvent, elle eft pointue en arrière ,
comme dans I’épervier; mais quelquefois elle eft
tronquée à fon extrémité poftérieure, comme dans
la perdrix roijge.
Au refte , cet os eft conftamment plat 81 fans
épine.
Son extrémité antérieure s’élargit en une efpèce
de tête pour s’unira la clavicule, avec laquelle
elle forme en commun une cavité qui s’articule
avec la tête de l’humérus. En dedans, cette même
extrémité offre une petite pointe qui fe joint à la
fourchette.
'55. L 'h um é r u s . Il eft digne de remarque, que
dans tous les oifeaux en général , tant ceux qui
volent bien, que ceux qui paroiffent dépourvus
< de la faculté de fe foutenir long-temps dans l'air ,
l'humérus a la même forme à peu près, & ne diffère
guère , fuivanc les efpèces, que fous les rapports
de la grandeur 8c dé la lolidité. Dans les
rapaces, par exemple, il eft prefqu’aufti long que
le Corps ; dans le cafoar, au contraire, il eft très-
petit.
Le corps de cet os eft communément cylindrique
, excepté pourtant dans le manchot ( a p te -
n ôd y tes p a ta g o n ic a ) , où il eft fingulièrement aplati
de droite à gauche, de forte qu’à l’extrémité
radiale, les os de l’avant-bras s’articulent l’un au-
deffus de l’autre , fur une même ligne. Il eft aufii
généralement reétiligne , fi ce n eft dans 1 autruche,
où il eft très-long & courbé fur la convexité
des côtes.'. .
L’extrémité fcapulaire de l’humerus, au lieu
d’être terminée par une tête hémifphérique , offre
une éminence taillée en portion de .roue, encroûtée
de cartilage dans l’état frais, articulée à
la fois avec l’omoplate 8c avec la clavicule, 8 c
continue, en haut & en bas, avec deux crêtes fail-
fantes, qui fe prolongent plus ou moins loin fur
le corps de l’ os. . , • .r
Derrière celle des crêtes qui eft interne, & au-
deffous de l’éminence articulaire,, eft une cavité
profonde.
La crête externe ou fupérieure eft mince 8c
fort faillante ; l’autre eft plus courte 8 c plus
mouffe. . '
L’extrémité cubitale de l’humérus a , dans les
oifeaux, à peu près la même difpofition que chez
l’homme. On voit de même ,entre les deux tubé-
r o fi té s , deux apophyfes articulaires, dont l’externe,
au lieu d’être hémifphérique, a la figure
d’une roue, de forte que le radius peut bien fe
fléchir & s’étendre.deffus, mais non tourner fur
lui-même. Celle.qui répond àlatrochlée eft toute
convexe & arrondie.
Galilée (1) & Borelli (2) paroiffent avoir les
premiers fait obferver que les. humérus des oifeaux
fçnt creux 8c minces. Le comte de Marfigli
a fu auAi que ces mêmes os étoient, dans le pélican,
creux, fans moelle & très-légers (3). Buffon
a rappelé le même fait dans fon éloquent difeours
fur la nature des oifeaux ; mais Camper a démontré
que les cavités de ces os reçoivent de l’air au lieu
de moelle, 8c que ce fluide y entre par la refpi-
rarion.
C et air pénètre dans les humérus par de très-
grands trous placés au-deffous dél’éminence articulaire
de leur extrémité fcapulaire, & très-vifibles
chez les rapaces, comme l’orfraie & l’aigle, ainfi que
dans tous les oifeaux qui volent bien. Mais cetre
difpofition n’ exifte point dans les oifeaux privés de
cet avantage. On en a fouvent la preuve dans des
efpèces d'une même famille : l’alouette & le moineau,
tous deux de l’ ordre des paffereaux, confirment,
cette affertion. La première, qui faitréfonner
l’atmofphère de fon chant mélodieux & fe fou-
tient long-temps fur fes ailes, a Les humérus creux,
remplis d’air 8c munis d'une très-forte ouverture :
le fécond, qui ne vole ni haut ni long-temps de
fuite, a les os du bras remplis de moelle. Dans le
cafoar 8c dans l’autruche (4) aufii, l’humérus eft
plein de moelle , 8c ne préfente point l’ouverture
dont nous parlons. Il en eft de même du pingouin,
(1) D e M e c h a n ic â., dialog. II , pag. i3a.
[d'y D e motu an ima lium , propofic. 194*
(3)- D a n u b . F ran. M y f i c . , com. VI, cab. 8 ,-pag. 10 6C
^(4) F o y e i John Huneer, P h ilo fo p h . Tranf. , vol. LXIV