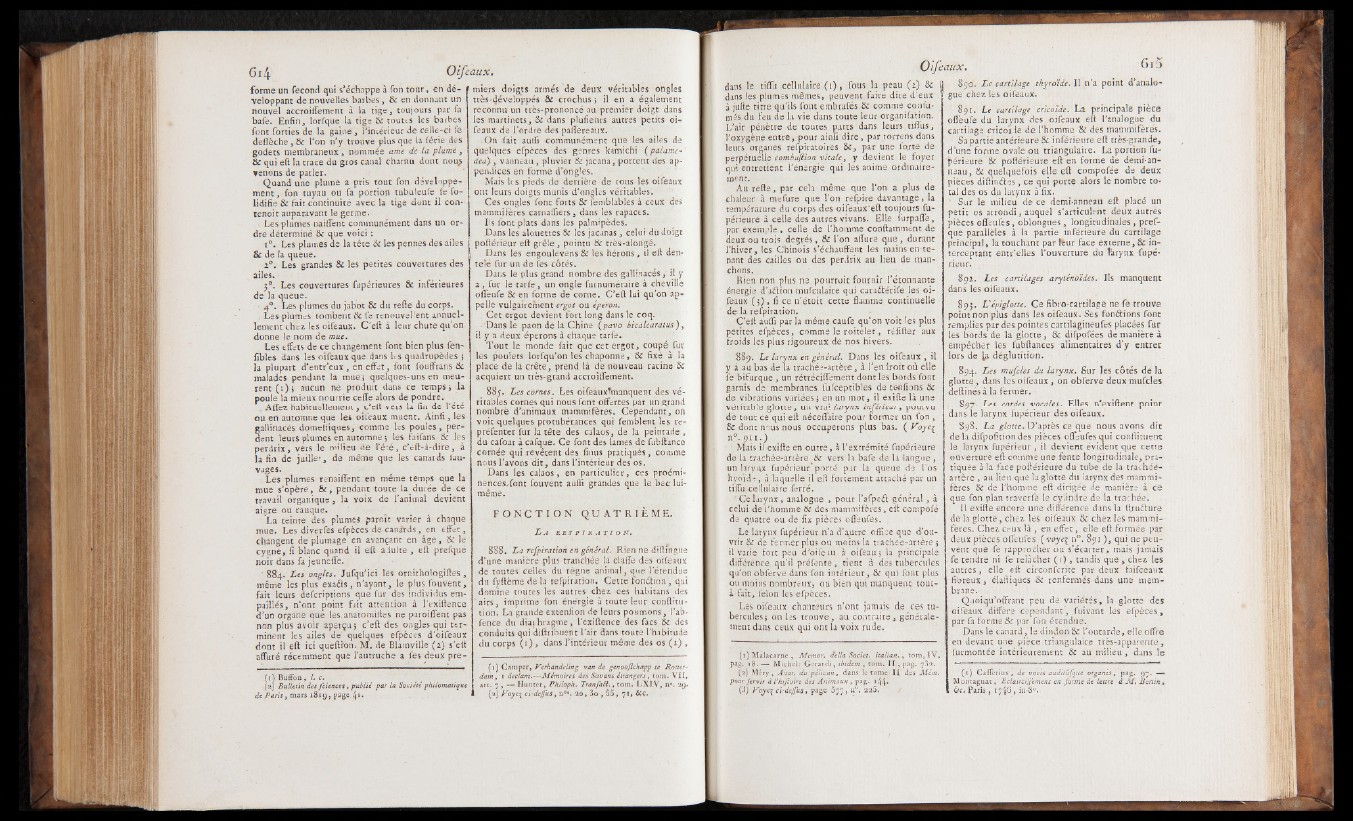
forme un fécond qui s’échappe à fon tour, en dé- >
veloppant de nouvelles barbes, & en donnant un
nouvel accroiffement à la tige , toujours par fa
bafe. Enfin, lorfque la tige & toutes les barbes
font (orties de la gaine, l’intérieur de celle-ci fe
de ffè che ,& l’on n’ y trouve plus que la férié des
godets membraneux, nommée ame de Ja plume ,
& qui eft la trace du gros canal charnu dont nou.s
venons de parler.
Quand une plume a pris tout fon développement,
fon tuyau ou fa portion tubuleufeTe fo-
lidifie & fait continuité avec la tige dont il con-
tenoit auparavant le germe.
Les plumes naiffent communément dans un ordre
déterminé & que voici :
i° . Les plumes de la tête & les pennes des ailes
& de la queue.
2°. Les grandes & les petites couvertures des
ailes. •
3°. Les couvertures fupérieures & inférieures
de la queue.
■ 40. Les plumes du jabot & du refte du corps.
. Les plumes tombent & fe renouvellent annuellement
chez les oifeaux. C'eft à leur chute qu’on
donne le nom de mue.
Les effets de ce changement font bien plus fen-
fibles dans lés oifeaux que dans fes quadrupèdes ;
la plupart d’ entr’eux , en effet, font fouffranS &
malades pendant la muer~quelques-uns en meurent
( i ) > aucun ne produit dans ce temps > -la
poule la mieux nourrie celle alors de pondre.
. Affez habituellement, c’ eft vers la fin de l’été
ou en automne que les oifeaux muent. Ainlî, les
gallinacés domeltiques, comme les poules, perdent
leurs plumes en automne 5 les fai fans & lés
perdrix , vers le milieu de l’é té , c*eft-à-dire, à
la fin de ju ille t de même que les canards iau-
vages.
Les plumes renaiffent en même temps que la
mue s’opère , & , pendant toute la durée de ce
travail organique, la voix de l’animal devient
aigre ou rauque. 1 2 r
La teinte des plumes paroît varier à chaque
mue. Les diverfes efpèces,de canards, en effet,
changent de plumage en avançant en âge , & le
cygne, fi blanc quand il eft adulte , eft prefqué
noir dans fa jeuneffe.
884. Les ongles. Jufqu’ ici les ornithologiftes ,
même les plus exaéts, n’ayant, le plus fouvent,
fait leurs deferiptions que fur des individus empaillés,
n’ont point fait attention à l'exiftence
d’un organe que lesanatomiftes ne paroiffent pas
non plus avoir apetçu; c’eft des ongles qui terminent
les ailes de quelques efpèces d’oifeaux
dont il eft ici quefti'on. M. de Blainville (2) s'eft
affuré récemment que l’autruche a fes deux pre(
1) BufFon y l . c .
.(a) B u lle tin des fc i e n c e s , p u b lié p a r la S o c ié té p hilomatique
d e P a r i s , mars 18x9, page.^x.
miers doigts armés de deux véritables ongles
très-çléveloppés & crochus; il en a également
reconnu un très-prononcé au premier doigt dans
les martinets, & dans plufieiirs autres petits oifeaux
de l ’ordre des pafferealix.
.On -fait audî communément que les ailes de
quelques efpèces des genres kamichi ( palamc
dea), vanneau, pluvier & jacana, portent des appendices
en forme d’ongles.
Mais les pieds de derrière de tous les oifeaux
ont leurs doigts munis d’ongles véritables.
Ces ongles font forts & femblables à ceux dès
mammifères carnaiTiers, dans les rapaces.
Ils Tant plats dans les palmipèdes.
Dans les alouettes & les jacanas, celui du doigt
poftérieur eft grêle, pointu & très-alongé.
Dans les engoulevens & les hérons, il eft dentelé
fur un de fes côtés.
Dans le plus grand nombre des gallinacés, il y
a , fur le tarfe, un ongle furnuméraire à cheville
offeufe & en forme de corne. C ’eft lui qu’on appelle
vulgairement ergot ou éperon.
Cet.ergot devient fort long dans le coq.
'Dans le paon de la Chine ( pavo bicàlcaratiis),
il y a deux éperons à chaque tarfe.
Tout le monde fait que cet ergot, coupé fur
les poulets lorfqu’on les chaponne, & fixé à la
place de la crête, prend là de nouveau racine &
acquiert un très-grand accroiffement.
88y. Les cornes. Les oifeauxlmanquent des véritables
cornes qui nous font offertes par un grand
nombre d’animaux mammifères. Cependant, on
voit quelques protubérances qui femblent les re-
préfenter fur la tête des calaos, de la peintade ,
du cafoar à câfque. Ce font des lames de fubftfance
cornée qui revêtent des finus pratiqués, comme
nous l ’avons d it, danis l’intérieur des os.
Dans les calaos, en particulier, ces proéminences,
font fouvent auflï grandes que le bec lui-
même.
F O N C T I O N Q U A T R I È M E .
L a r e s p i r a t i o n .
888. La refpiration en général. Rien ne diftingue
d’une manière plus tranchée la cl a (Te des oifeaux
de toutes celles du règne animal, que l'étendue
du fyftème de la refpiration. Cette fonction , qui
domine toutes les autres chez-ces habitans des
"airs, imprime fon énérgie à toute leur conftitu-
tion. La grande extenfion de leurs poumons, l’ab-
fence du diaphragme, l’exiftence des facs & des
conduits qui diftrihuent l'air dans toute l’habitude
du corps ( 1 ) , dans l’intérieur même des os (1) ,
(1) Camper, Verh and eling van de genoojlch app te Rotterdam
y 1 d eclam .— M ém o ir e s des S a va ns étrangers, com. VII,
art. 7 y — Hun ter, P h ilo p h . T ra n fa S t., com. LXIV, n°. 29.
(2) V o y e j ci-deffus, u°*. 20, So , 55 , 71 , ôçç.
dans le tiffu cellulaire ( i ) , fous la peau ( i ) &
dans les plumes mêmes, peuvent,faire dire d eux
à jufte titre qu’ils font embrafés & comme confu-
més du feu de la vie dans toute leur organifation.
L’air pénètre de toutes parts dans leurs tiffus,
l’oxygène entre, pour.ainfi dire, par torrens dans
leurs organes refpiratoirès & , par une lo,rte de
perpétuelle combujlion vitale, y devient l.e foyer
qui entretient l’énergie qui les anime ordinairement.
Au refte, par cela même que l’on a plus de
chaleur à mefure que l’on refpire davantage, la
température du corps des oifeaux'eft toujours fu-
périeure à celle des autres vivans. Elle furpaffe,
par exemple, celle de l’homme conftamment de
deux ou trois degrés, & l'on alTure que, durant
l’hiver, les Chinois s’échauffent les mains en-tenant
des cailles ou des perdrix au lie,u de manchons..
;
Rien non plus ne pourrait fournir l’étonnante
énergie d’aélîon mufculaire qui cara&êrife les oifeaux
(3 ) , fi ce n’étoit cette flamme continuelle
de la refpiration.
Ç ’eft auffi par la même caufe qu’ on voit les plus
petites efpèces, comme le roitelet, réfifter aux
froids les plus rigoureux de nos hivers.
889. Le larynx en général. Dans les oifeaux , il
y à au bas de la trachée-artère, à l’eniroit où elle
fe bifurque , un rétréciffement dont les bords font
garnis de membranes, fufceptibles de tenfions &
de.vibrations variées ; en un mot, il exifte là une
véritable glotte, un vrai larynx inférieur, pourvu
de tout ce qui eft néceffaire pour former un fon ,
& dont nous nous occuperons plus bas. ( Voyeç
n°. 9 1 1 .)
Mais il exifte en outre, à l’extrémité fupérieure
de la trachée-artère & vers U bafe de la langue,
un larynx fupérieur* porté par la queue de l ’os
hyoïde, à laquelle il e.ft fortement attaché par un
tiffu ^cellulaire ferré.
'Celarynx, analogue , pour l’afpeét général, à
celui de l’homme & des mammifères, eft compôfé
de quatre ou de fix pièces offeufes. ,
Le larynx fupérieur n’a d’ autre office que d’ouvrir
& de fermer plus ou moins la trachée-artère ;
il varie fort peu d ’oifeui à oifeau ; la principale
différence, qu’il préfente, tient à des tubercules
qu’on obferve dans-fon intérieur, & qui font plus
ou moins nombreux, ou bien qui manquent touc-
à fait, félon les efpèces.
Les oifeaux chanteurs n’ont jamais de ces tubercules;
on les trouvé, au contraire, généralement
dans ceüx qui ont la voix rude.
(1) Malacarne , M em o r . d élia S o c ie t. ita lia n . , tom, IV,
pag. 18. — Michel j Gérard i , ib idem , tom. I I , pag. 702.
(-2) Méry, A n a t. du p é lic a n , dans-k tome 11' des M èm .
pour fe r v ir à Vhiflo ire des A n im a u x , pag. l44* (3) V o y e q c i-d e jfu s , page 577,11°. 225.
89 êf. Le cartilage thyroïde. Il n’a point d’analogue
chez lès oïfeaux.
891 .L e cartilage cricoide. La principale pièce
offeufe du larynx des . oifeaux eft l’analogue du
cartilage cricoïde de l’homme & des mammifères.
Sa partie antérieure & inférieure eft très-grande,
d ’une forme ovale ou triangulaire. La portion fù-
'^érieure & poftérieure eft en forme de demi-anneau,
& quelquefois elle eft compofée de deux
pièces diftinétes, ce qui porte alors le nombre total
des os du larynx à fix.
* Sur le milieu de ce demi-anneau eft placé un
petit os arrondi, auquel s’articulent deux autres
pièces offeufes, oblongues, longitudinales, pref-
que parallèles à la partie inférieure du cartilage
principal, la touchant par feur face externe, & interceptant
enu’elles l’ouverture du îârynx fupérieur.
892. Les cartilages aryténoïdes. Ils manquent
dans les oifeaiix.
893. Vépiglotte. Ce fibro-cartilage ne fe trouve
point non plus dans les oifeaux. Ses fonétions font
remplies par des pointes, cartilagineufes placées fur
les bords de la glo tte, & difpofées de manière à
empêcher les fubftanees alimentaires d’y entrer
lors de ^ déglutition.
894. Les mufcles du larynx. Sur les côtés de la
glo tte, dans les oifeaux, on obferve deux mufcles
-deftinés à la fermer.
897. Les cordes vocales. Elles n’exiftent point
dans le larynx fupérieur des oifeaux.
898. La glotte. D’après ce que nous avons dit
delà difpofition des pièces offeufes qui conftituent
le larynx fupérieur , il devient évident que cette
ouverture eft comme une fente longitudinale, pra-1
tiquée à la face poftérieure du tube de la trachée-
artère , au lieu que la glotte du larynx des mammifères
& de l’homme eft dirigée de manière à ce
que fon plan traverfé le cylindre de Iajrrachée.
Il exifte encore une différence dans la ffruéture
de la glotte, chez les oifeaux & chez les mammifères.
Chez ceux-là, en effet, elle eft formée par
deux pièces offeufes ( voye% n°. 891 ) , qui ne peuvent
que fe rapprocher ou s’écarter, mais jamais
fe tendre ni fe relâcher ( 1 ) , tandis que , chez les
autres, elle eft circonfcrite par deux faifeeaux
fibreux, élaftiques & renfermés dans une membrane.
Quoiqu’offrant peu de variétés, la glotte des
oifeaux diffère cependant, fuivant les efpèces,
par fa forme & par fon étendue.
Dans le canard, le dindon & l’outarde, elle offre
en devant une pièce triangulaire très-apparente,
furmontée intérieurement & au milieu, dans le
' (1) Cafferius , de v o c is audit&fque o rg a n is , pag. 97. —-
Moncagnac, E cla ircijfemens en fo rm e de lettre à M . B e n in ,
Grc. Paris, 1746, in-8°.