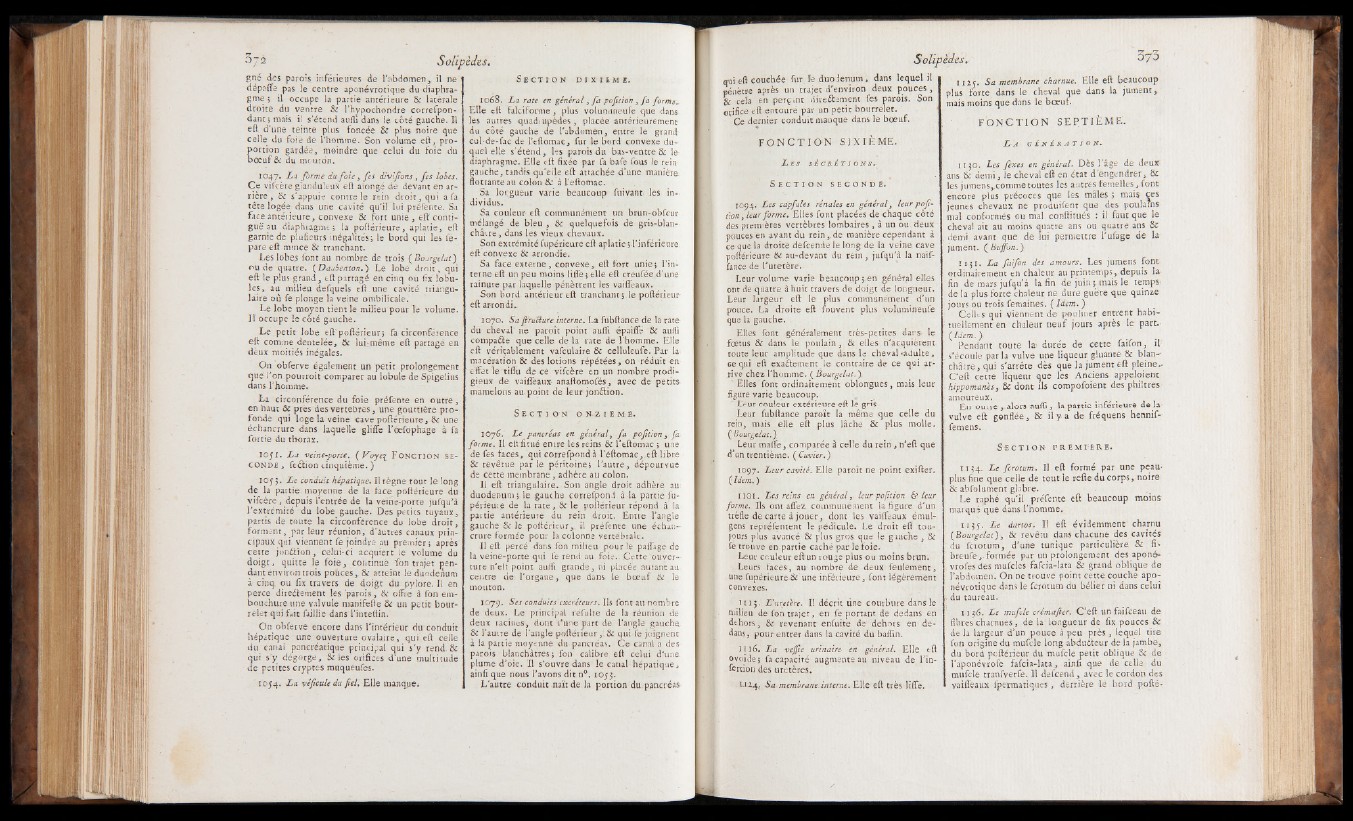
gné des patois inférieures de l’abdomen, il ne
dépaffe pas le centre aponévrotique du diaphragme
5 il occupe la partie antérieure & latérale
droite du ventre 8c Thypochondre correfpon-
dant > mais il s’étend auffi dans le côté gauche. Il
eft d’une teinte plus foncée & plus noire que
celle du foie de l’homme. Son volume eft, proportion
gardée, moindre que celui du foie du
boe u f& du mouton.
IO47. La forme du foie , fes d iv i f io n s , fes lobes.
C e vifcère glanduleux eft alongé de devant en arrière
, & s’ appuie contre le rein droit, qui a fa
tête logée dans une cavité qu’il lui préfente. S.i
face antétieure, convexe & fort unie , eft contiguë
au diaphragm e ; la poftérieure, aplatie, eft
garnie de plufieurs inégalités; le bord qui les fé-
pare eft mince & tranchant.
Les lobexs font au nombre de trois ( Bourgelat)
ou de quatre. ( Daubeaton.) Le lobe droit, qui
eft le plus grand, eft partagé en cinq ou fix'lobules*
au milieu defquels eft.une cavité triangulaire
ou fe plonge la veine ombilicale.
Le lobe moyen tient le milieu pour le volume.
Il occupe le côté gauche.
Le petit-lobe eft'poftérieur; fa circonférence
eft comme dentelée, & lui-même eft partagé en
deux moitiés inégales.
On obferve également un petic prolongement
que l’on pourroit comparer au lobule de Spigeiius
dans l’homme.
La circonférence du foie préfente en outre,
en haut & près des vertèbres, une gouttière profonde
qui loge la veine cave poftérieure, & une
échancrure dans laquelle gliffe l’ôefophage à fa
fortie du thorax.
io y i . La veine-porte. ( Voye{ FONCTION SECONDE
, feélion cinquième. )
1 oy 3. Le conduit hépatique. Il règne tout le long
de la partie moyenne de la face poftérieure du
vifcère, depuis l’entrée de la veine-porte jufqu’à
l’extrémité du lobe gauche. Des petits tuyaux,
partis de toute la circonférence du lobe droit,
forment, par leur réunion, d’autres canaux principaux
qui viennent fe joindre au premier 5 après
cette jon&ioh, celui-ci acquiert le volume du
doigt, quitte le fo ie , continué Ton trajet pendant
environ trois polices, & atteint le duodénum
à cinq ou fîx travers de doigt du pylore. Il en
perce directement les parois, & offre à fon embouchure
une valvule manifefte & un petit bourrelet
qui fait faillie dansTinteftin.
On obferve encore dans l’ intérieur du conduit
hépatique une ouverture ovalaire, qui eft celle
du canal pancréatique principal qui s’y rend. &
qui s'y dégorge, Scies orifices d’une multitude
de petites cryptes muqueufes.
; 1054. La véficule du fiel. Elle manque.
S e c t i o n d i x i è m e .
1068. La rate en générât, fia pofitio'n, fia forme,.
Elle eft falciforme, plus volununeufe que dans
les autres quadiupèdes, placée antérieurement
du côté gauche de l’abdomen, entre le grand
cul-de-fac de l’eftomac, fur le bord convexe duquel
elle s’étend, les parois du bas-ventre & le
diaphragme. Elle t-ft fixée par fa bafe fous le rein
gauche, tandis qu’eile eft attachée d’une manière-
flottante au colon & à L’eftomac.
Sa longueur varie beaucoup fuivant les individus.
Sa couleur eft communément un brun-obfcur
mélangé de bleu , & quelquefois de gris-blan-
châire, dans les vieux chevaux.
Son extrémité fupérieure eft aplatie , 1’ inférieure.
eft convexe & arrondie.
Sa face externe, convexe,.eft fort unie; l’interne
eft un peu moins lilfe> elle eft creufée d’ une
rainure par laquelle pénètrent les vaiffeaux.
Son bord antérieur eft tranchant j . le poftérieur
eft arrondie
1070. Sa ffruclure. interne. La fubftance de la rate
du cheval- ne paroît point aufli épaiffe & auffi
compacte que celle de là rate de l ’homme. Elle
eft véritablement vafculaire & celluleufe. Par la
macération & des lotions répétées, on réduit en
effet le tiftu de ce vifcère en un nombre prodigieux
de vaiffeaux anaftomofés, avec de petits
mamelons au. point de leur jonction.
S e c t i o n o n z i è m e .
IO76. Le pancréas en général, fa pofition, fa-
forme. Il eit fitué entre les reins & l’ eftomac ; une
de fes faces, qui correfpondà l’éftomac,.eft libre
& revêtue par le péritoine» l ’autre, dépourvue
de Cette membrane, adhère au colon. 11 eft triangulaire. Son angle droit adhéré au
duodénum; le gauche correfpôn.1 à la partie fu-
périeure de la rate, & le poftérieur répond à la
partie antérieure du rein droit. Entre l’angle
gauche & le poftérieur,. il préfente une échancrure
formée pour la colonne vertébrale.
Il eft percé dans fon milieu pour le paffage de
la veine-porte q ui fe rend-au foie- Cette 'ouverture
n’eit point auffi grande, ni placée autant au
centre de l’organe, que dans le boeuf .& le
mouton.
1079. Ses conduits excréteurs. \\s fon tau nombre
de deux. Le principal réfulte de la réunion de
deux racines-, dont l’une part de l’angle gauche
& l’autre de l’angle poftérieur qui-fe joignent
à la partie moyenne du pancréas. C e canal a des
parois blanchâtres; fon calibre ëft celui d'une,
plume d’oie. Il s'ouvre dans le canal hépatique,
ainfi que nous l’ avons dit n°. 1013.
L'autre conduit naît de la portion du pancréas
qui eft couchée fur le duoienuvn, dans lequel il
pénètre après un trajet d'environ deux pouces,
Sc ceia en perçint direélsmem fes parois. Son
orifice eft .entouré par un'petit bourrelet.
Ce dernier conduit manque dans le boeuf.
F O N C T I O N S IX IÈ M E .
L e s s é c r é t i o n s .-
S e c t i o n s e c o n d e . ’
JO94. Les cdpfuies rénales en général, leur pofition
, leur forme. Elles font placées de chaque côté
des premières vertèbres lombaires, à un ou, deux
pouces en avant du rein,.de manière cependant à
ce que la droite defcende le long de la veine cave
poftérieure & au-devant du rein, jufqu’à la naif-
fance de l’uretère.
Leur volume varie beaucoup ^en général elles
ont de quatre à huit travers de doigt de longueur.
Leur largeur eft le plus communément d’un
pouce. La droite eft fouvent plus volumineufe
que la gauche.
Elles font généralement très-petites dans- le
foetus & dans le poulain, & elles n’acquièrent
toute leur amplitude que dans le cheval-adulte,
ce qui eft exaétement le contraire de ce qui arrive
chez l’homme. ( Bourgelat. ),
' Elles font ordinairement oblongues, mais leur
figure varie beaucoup.
Leur couleur extérieure eft le gris.
Leur fubftance paroît la même que celle du
rein, mais elle eft plus lâche & plus molle.
{Bourgelat. ).
Leur maffe, comparée â celle du rein, n’eft que
d’un trentième. (.Cuvier.)
1097. Leur cavité. Elle paroît ne point exifter.
(•Idem.)
IIOI. Les reins en général-y. leur pofition & leur
forme. Us ont affez communément la ligure d’un
trèfle de carte à jouer, dont les vaiffeaux émul-
gens repréfentent lè pédicule. Le droit eft toujours
plus avancé & plus gros que le gauche , &
fe trouve en partie caché parle foie.
Leur couleur eft un rouge plus ou moins brun.
Leurs faces, au nombre de deux feulement,
une fupérieure.& une inférieure, font légèrement
convexes.
H 15. L ’uretère. I! décrit une courbure dans le
milieu de fon trajet, en fe portant de dedans en
dehors, & revenant enfuite de dehors en dedans,
pour entrer dans la cavité du baffm.
I l 16. La veffiè urinaire- en général. Elle eft
ovoïde; fa capacité augmente au niveau de l’in-
fertion des uretères.
I'ii4f Sa. membrane, interne. Elle eft très-liffe.
H2y. Sa membrane charnue. Elle eft beaucoup
plus forte dans le cheval que dans la jument,,
mais moins que dans le boeu f
F O N C T I O N S E P T I È M E .
L a g é n é r a t i o n .
1130. Les fexes en général. Dès 1 âge de deux-
ans & demi, le cheval eft en état d'engendrer, &
les jumens,.comme toutes les autres femelles, font
encore plus précoces que lès mâles ; mais ces
jeunes chevaux ne produifent que des poulains
mal conformés ou mal conftirués : il faut que le
cheval ait au moins quatre ans ou quatre ans &
demi avant que de lui permettre i’ ufage de la
jument. ( Buffon. )
1131. La faifon des amours. Les jumens font-
ordinairement en chaleur au printemps, depuis la-
fin de mars jufqu’à la fin de juin ; mais le temps-
de la plus forte chaleur ne dure guère que quinze
jours ou trois femaines. ( Idem. )
Celles qui viennent de pouliner entrent habi-
: tuellement en chaleur neuf jours après le parc.
( Idem. )v - \
Pendant toute ta durée de cette faifon, il
s’écoule par la vulve une liqueur gluante & blanchâtre,
qui s’arrête dès que la jument eft pleine.*
; C ’eft cette liqueur que les Anciens appelaient
hippomanesy & dont ils compofoient des philtres
: amoureux.
En outre, alors auffi, la partie inférieure de la;
vulve eft gonflée, & il y a de fréquens hennif-
• femens-.
S e c t i o n - p r e m i è r e .
1134. Le ferotum. U eft formé par une peau*
plus fine que celle de tout le refte du corps, noire
& abfolument gbbre.
Le raphé qu’il préfente eft beaucoup moins
marqué que dans l’homme.
1135. Le dartos. Il eft évidemment' charnu
{Bourgelat), & revêtu dans chacune des cavités
du ferotum, d’ une tunique particulière 8c fi-
breufe, formée par un prolongement des aponé-
vrofesdes mufcles fafcia-lata & grand oblique de
l’abdomen. On ne trouve point cette couche aponévrotique
dans le ferotum du bélier ni dans celui
- du taureau.
1136. Le mufcle crémaflcr. C ’eft un fa-ifeeau de
fibres charnues, de la longueur de fix pouces 8c
de la largeur d’un pouce à peu près , lequel tire
fon origine du mufcle long abduèteur de la jambe,
du bord poftérieur du mufcle petit oblique 8c de
l’aponévrofe fafcia-lata, ainfi que de celle du
mufcle tranfverfe. Il defeend, avec le cordon des
vaiffeaux fpermatiques, derrière le bord pofté