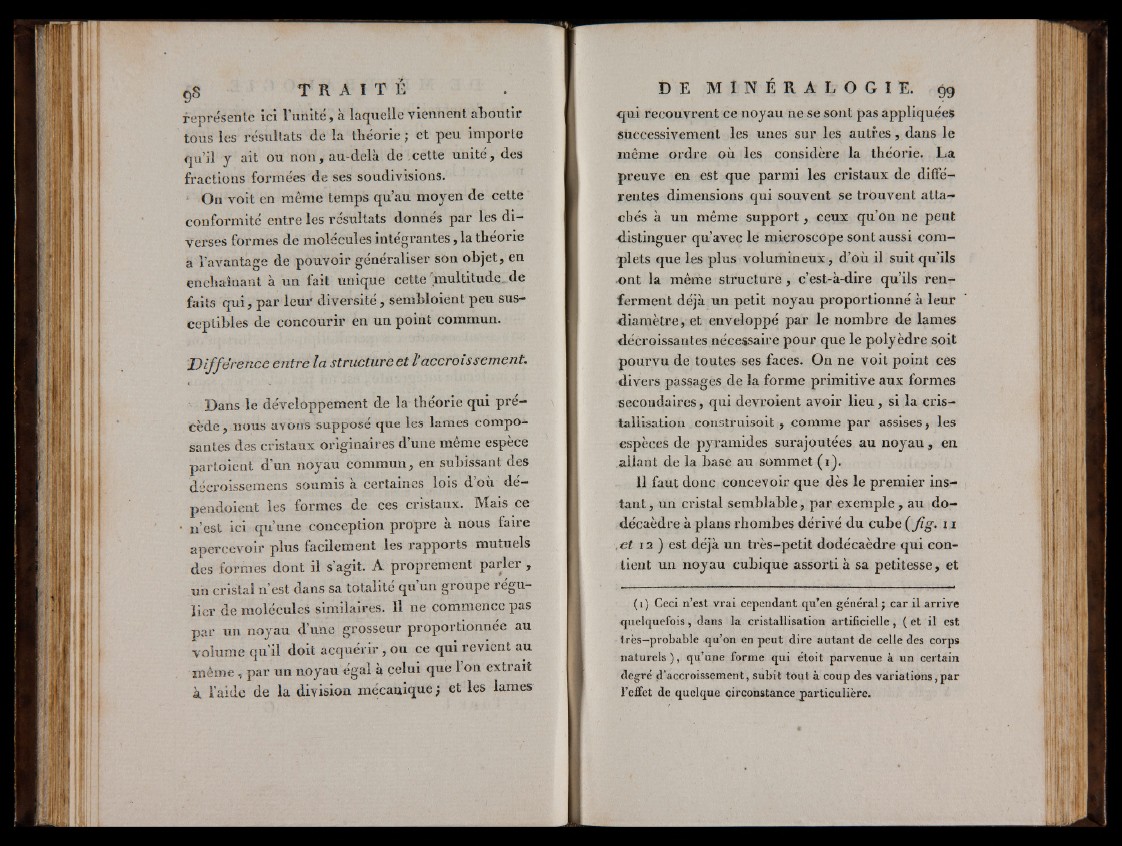
représente ici Futiitë, a laquelle viennent aboutir
tous les résultats de la théorie ; et peu importe
qu’il y ait ou non, au-delà de cette unité, des
fractions formées de ses soudivisions.
On voit en même temps qu’au mojen de cette
conformité entre les résultats donnés par les diverses
formes de molécules integrantes, la théorie
a l’avantage de pouvoir généraliser son objet, en
enchaînant à un fait unique cette multitude, de
faits qui, par leur diversité , sembloiént peu susceptibles
de concourir en un point commun.
D iffé r en ce entre la structure et l'accroissement.
Dans le développement de la théorie qui précède
, nous avons supposé que les lames composantes
des cristaux originaires d’une même espèce
partoient d’un nojau commun, en subissant des
dscroissemens soumis à certaines lois d’ou dé-
pendoient les formes de ces cristaux. Mais ce
n’est ici qu’une conception propre à nous faire
apercevoir plus facilement les rapports mutuels
des formes dont il s’agit. A proprement parler ,
un cristal n’est dans sa totalité qu’un groupe régulier
de molécules similaires. 11 ne commence pas
par un noyau d’une grosseur proportionnée au
volume qu’il doit acquérir, ou ce qui revient au
même, par un nojau égal à celui que 1 on extrait
à, l’aide de la division mécanique} et les lames
D E M I N É R A L O G I E . 99
qui recouvrent ce noyau ne se sont pas appliquées
successivement les unes sur les autres, dans le
même ordre où les considère la théorie. La
preuve en est que parmi les cristaux de différentes
dimensions qui souvent se trbuvent attachés
à un même support, ceux qu’on ne peut
distinguer qu’avec le microscope sont aussi complets
que les plus volumineux, d’où il suit qu’ils
ont la même structure, c’est-à-dire qu’ils renferment
déjà un petit noyau proportionné à leur
diamètre, et enveloppé par le nombre de lames
décroissantes nécessaire pour que le polyèdre soit
pourvu de toutes ses faces. On ne voit point ces
divers passages de la forme primitive aux formes
secondaires, qui devroient avoir lieu , si la cristallisation
construisoit, comme par assises, les
espèces de pyramides surajoutées au noyau , en
allant de la base au sommet (1).
11 faut donc concevoir que dès le premier instant,
un cristal semblable, par exemple, au dodécaèdre
à plans rhombes dérivé du cube ( f ig. 11
et 12 ) est déjà un très-petit dodécaèdre qui contient
un noyau cubique assorti à sa petitesse, et
(1) Ceci n’est vrai cependant qu’en général $ car il arrive
quelquefois, dans la cristallisation artificielle, (e t il est
très-probable qu’on en peut dire autant de celle des corps
naturels), qu’une forme qui étoit parvenue à un certain
degré d’accroissement, subit tout à coup des variations, par
l ’effet de quelque circonstance particulière.