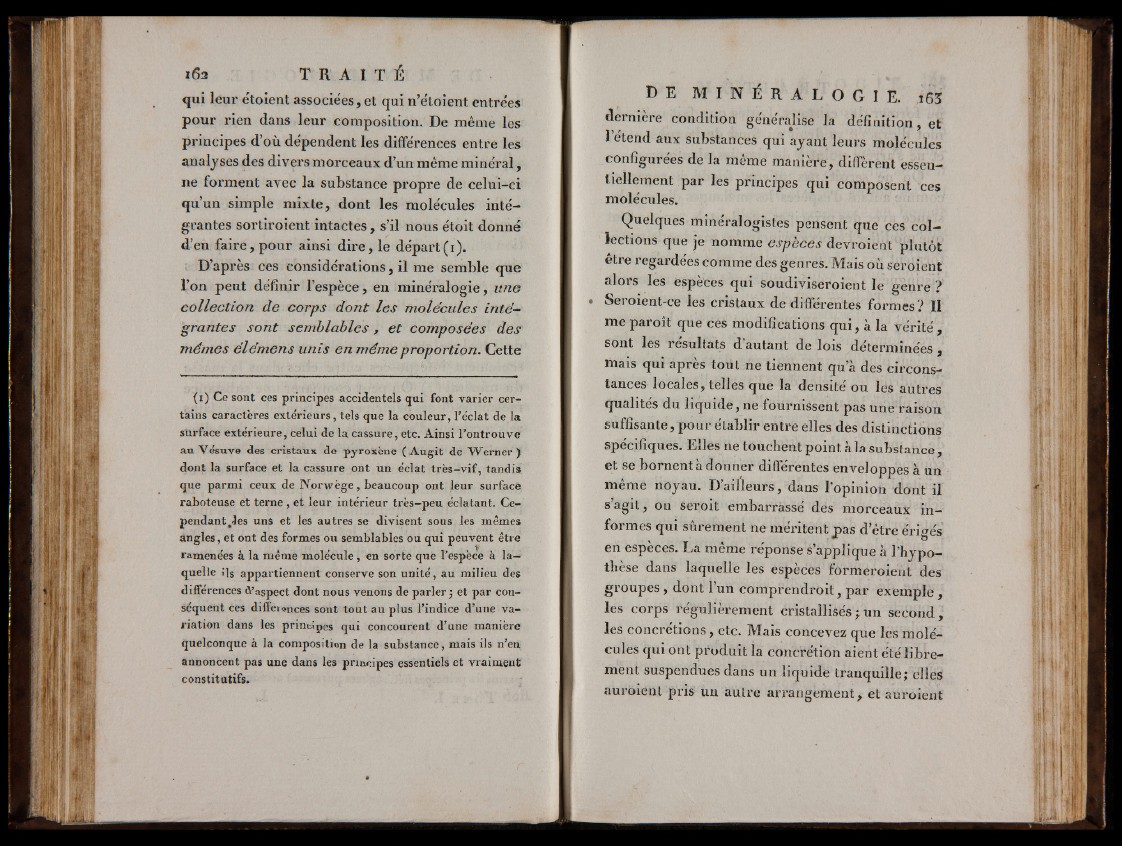
qui leur etoient associées, et qui n’étoient entrées
pour rien dans leur composition. De même les
principes d’où dépendent les différences entre les
analyses des divers morceaux d’un même minéral,
ne forment avec la substance propre de celui-ci
qu’un simple mixte, dont les molécules intégrantes
sortiroient intactes , s’il nous étoit donné
d’en faire, pour ainsi dire, le départ(i).
D’après ces considérations, il me semble que
l ’on peut définir l ’espèce, en minéralogie, une
collection de corps dont le s molécules intégrantes
sont semblables, et composées des
mêmes élémens unis en même proportion. Cette
(i) Ce sont ces principes accidentels qui font varier certains
caractères extérieurs, tels que la couleur, l’éclat de la
surface extérieure, celui de la cassure, etc. Ainsi l ’ontrouvé
au Vésuve des cristaux de pyroxene (A u g it de Werner )
dont la surface et la cassure ont un éclat très-vif, tandis
que parmi ceux de N o rw è g e , beaucoup ont leur surface
raboteuse et terne , et leur intérieur très-peu éclatant. Cependant
,4 es uns et les autres se divisent sous les mêmes
angles, et ont des formes ou semblables ou qui peuvent être
»'amenées à la même molécule, en sorte que l’espèce à laquelle
ils appartiennent conserve son unité, au milieu des
differences A’aspect dont nous venons de parler ; et par conséquent
ces differences sont tout au plus l’indice d’une variation
dans les principes qui concourent d’une manière
quelconque à la composition de la substance, mais ils n’en
annoncent pas une dans les principes essentiels et vraiment
constitutifs.
dernière condition généralise la définition, et
l ’étend aux substances qui ayant leurs molécules
configurées de la même manière, diffèrent essentiellement
par les principes qui composent ces
molécules.
Quelques minéralogistes pensent que ces collections
que je nomme espèces devroient plutôt
être regardées comme des genres. Mais où seroient
alors les espèêes qui soudiviseroient le genre ?
Seroient-ce les cristaux de différentes formes ? Il
me paroit que ces modifications qui, à la vérité
sont les résultats d autant de lois déterminées
mais qui après tout ne tiennent qu a des circonstances
locales, telles que la densité ou les autres
qualités du liquide,ne fournissent pas une raison
suffisante, pour établir entre elles des distinctions
spécifiques. Elles ne touchent point à la substance
et se bornent à donner différentes enveloppes à un
même noyau. D’aiÎleurs, dans l’opinion dont il
s’agit, on seroit embarrassé des morceaux informes
qui sûrement ne méritent pas d’être érigés
en especes. La meme réponse s applique a l ’hypothèse
dans laquelle les espèces formeroient des
groupes, dont l’un comprendroit, par exemple ,
les corps régulièrement cristallisésfun second,
les concrétions, etc. Mais concevez que les molécules
qui ont produit la concrétion aient été librement
suspendues dans un liquide tranquille; elles
auroient pris un autre arrangement, et auroient