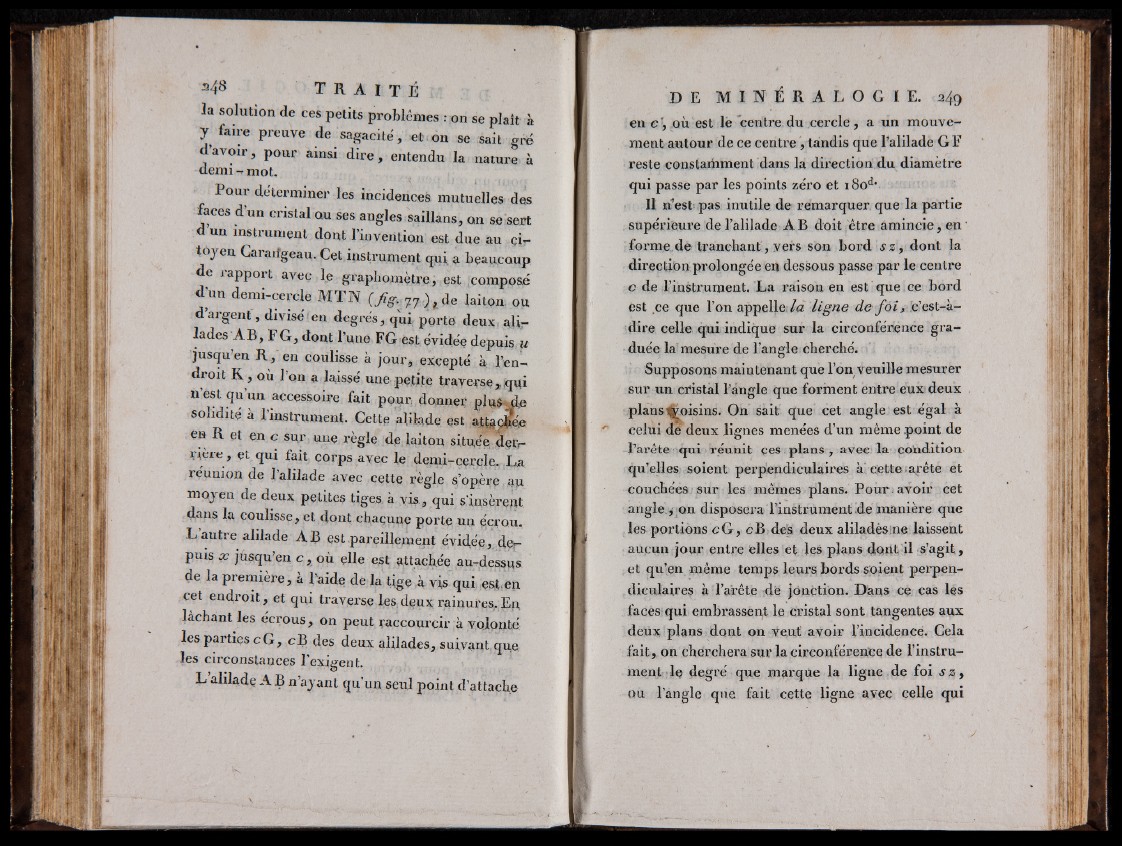
la solution de ces petits problèmes : on se plait à
y faire preuve de sagacité, et.on se sait gré
d’avoir, pour ainsi d ire , entendu la nature à
demi -» mot.
Pour déterminer les incidences mutuelles des
faces d’un cristal au ses angles saillans, an se sert
d un instrument dont l'invention est due au citoyen
Caraifgeau. Cet instrument qui. a beaucoup
dt i apport avec le grapliomètre, est composé
d’un demi-cercle M T N de laiton; ou
d’argent, divisé-en degrés, qui, porte deux, aU-
lades A B , F G , dont l’une FG est évidée depuis it
jusqu’en R , en coulisse à jour, excepté à l’en-
droit K , où l ’on a laissé une petite traverse ,.,qni
n’est qu’un accessoire fait pour, donner plus ..de
sohdité à l’instrument. Cette alikde est a H a jE
en R et en c sur une règle de laiton située dety-
rière, et qui fait corps avec le demi-cercle. La
reunion de 1 alilade avec cette règle s’opère au
moyen de deux petites tiges à vis , qui s'insèrent
dans la coulisse, et dont chacune porte un écrou,
L autre alilade A B est pareillement évidée, dcr
puis æ jusqu’en c , où elle est attachée au-dessus
de la première, a l ’aide de la tige à vis qui est en
cet endroit, et qui traverse les,deux rainures. En
lâchant les écrous, on peut raccourcir à volonté
les parties cG , cB des deux alilades, suivant que
les circonstances l ’exigent.
L alilade A B n’ayant qu’un seul point d’attache
en c \ où est le centre du cercle, a un mouvement
autour de ce centre , tandis que l’alilade G F
reste constaiiiment dans la direction du diamètre
qui passe par les points zéro et i8odv
Il n?est- pas inutile de remarquer que la partie
supérieure de l’alilade A B doit être amincie, en
forme de tranchant, vers son bord s z , dont la
direction prolongée en dessous passe par le centre
c de l’instrument. La raison en est que ,ce bord
èst ce que l’on appelle: la ligne de f o i , c’est-à-
dire celle qui indique sur la circonférence graduée
la mesure de l’angle cherché.
Supposons maintenant que l’on veuille mesurer
sur un cristal l’angle que forment entre eux deux
plans ^voisins. On sait que cet angle est égal à
celui dé deux lignes menées d’un même .point de
l’arête qui réunit ces , plans , avec la condition
qu’elles soient perpendiculaires à cette-arête et
couchées sur les mêmes plans. Pour , avoir cet
angle , on disposera l’instrument de manière que
les portions c G , cB des deux aliladèsine laissent
aucun jour entre elles et les plans dont il s’a g it,
et qu’en même temps leurs bords soient perpendiculaires
à l ’arête de jonction. Dans ce cas les
faces:qui embrassen,t le cristal sont tangentes aux
deux plans dont on veut avoir l’incidence. Gela
lait, on cherchera sur la circonférence de l’instrument
le degré que marque la ligne de foi s z ,
ou l’angle que fait cette ligne avec celle qui