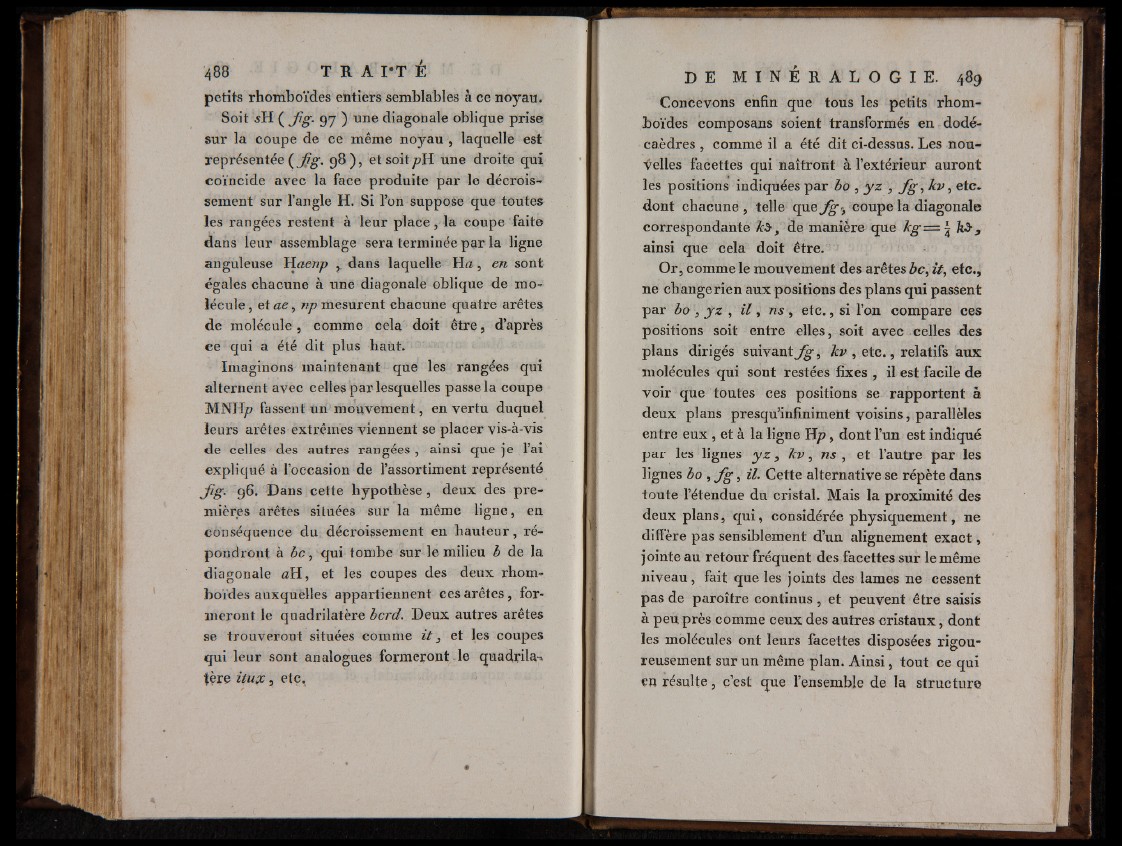
petits rhomboïdes entiers semblables à ce noyau.
Soit jH ( Jjg. 97 ) une diagonale oblique prise
sur la coupe de ce même noyau , laquelle est
représentée { jjg . 98) , et soit une droite qui
coïncide avec la face produite par le décroissement
sur l’angle H. Si l’on suppose que toutes
les rangées restent à leur p lace , la coupe faite
dans leur assemblage sera terminée par la ligne
anguleuse VLaenp ^ dans laquelle H a , en sont
égales chacune à une diagonale oblique de molécule
, et ae, np mesurent chacune quatre arêtes
de molécule, comme cela doit être, d’après
ce qui a été dit plus haut. •
Imaginons maintenant que les rangées qui
alternent avec celles par lesquelles passe la coupe
MNHjn fassent un mouvement, en vertu duquel
leurs arêtes extrêmes viennent se placer vis-à-vis
de celles des autres rangées , ainsi que je l’ai
expliqué à l’occasion de l’assortiment représenté
Jig. 96. Dans cette hypothèse, deux des premières
arêtes situées sur la même ligne, en
conséquence du décroissement en hauteur, répondront
à bc, qui tombe sur le milieu b de la
diagonale aH, et les coupes des deux rhomboïdes
auxquelles appartiennent ces arêtes, formeront
le quadrilatère bcrd. Deux autres arêtes
se trouveront situées comme it 3 et les coupes
qui leur sont analogues formeront le quadriln-*
fère itu p , etc.
Concevons enfin que tous les petits rhomboïdes
composans soient transformés en dodécaèdres
, commé il a été dit ci-dessus. Les nou-
f elles facettes qui naîtront à l’extérieur auront
les positions indiquées par bo , y z , f g , k v , etc.
dont chacune, telle que coupe la diagonale
correspondante k& > de manière que k g = \ k&3
ainsi que cela doit être.
Or, comme le mouvement des arêtes bc, it, etc.,
ne ch ange rien aux positions des plans qui passent
par bo 1 y z , i l , ns , e tc ., si l’on compare ces
positions soit entre elles, soit avec celles des
plans dirigés suivant f g , kv , e tc ., relatifs aux
molécules qui sont restées fixes , il est facile de
voir que toutes ces positions se rapportent à
deux plans presqu’infiniment voisins, parallèles
entre eux , et à la ligne U p , dont l’un est indiqué
par les lignes y z 3 k v , ns , et l’autre par les
lignes bo , f g , il. Cette alternative se répète dans
toute l’étendue du cristal. Mais la proximité des
deux plans, q u i, considérée physiquement, ne
diffère pas sensiblement d’un alignement e x a c t ,
jointe au retour fréquent des facettes sur le même
niveau, fait que les joints des lames ne cessent
pas de paroître continus , et peuvent être saisis
à peu près comme ceux des autres cristaux, dont
les molécules ont leurs facettes disposées rigoureusement
sur un même plan. A in s i, tout ce qui
en résulte, c’est que l’ensemble de la structure