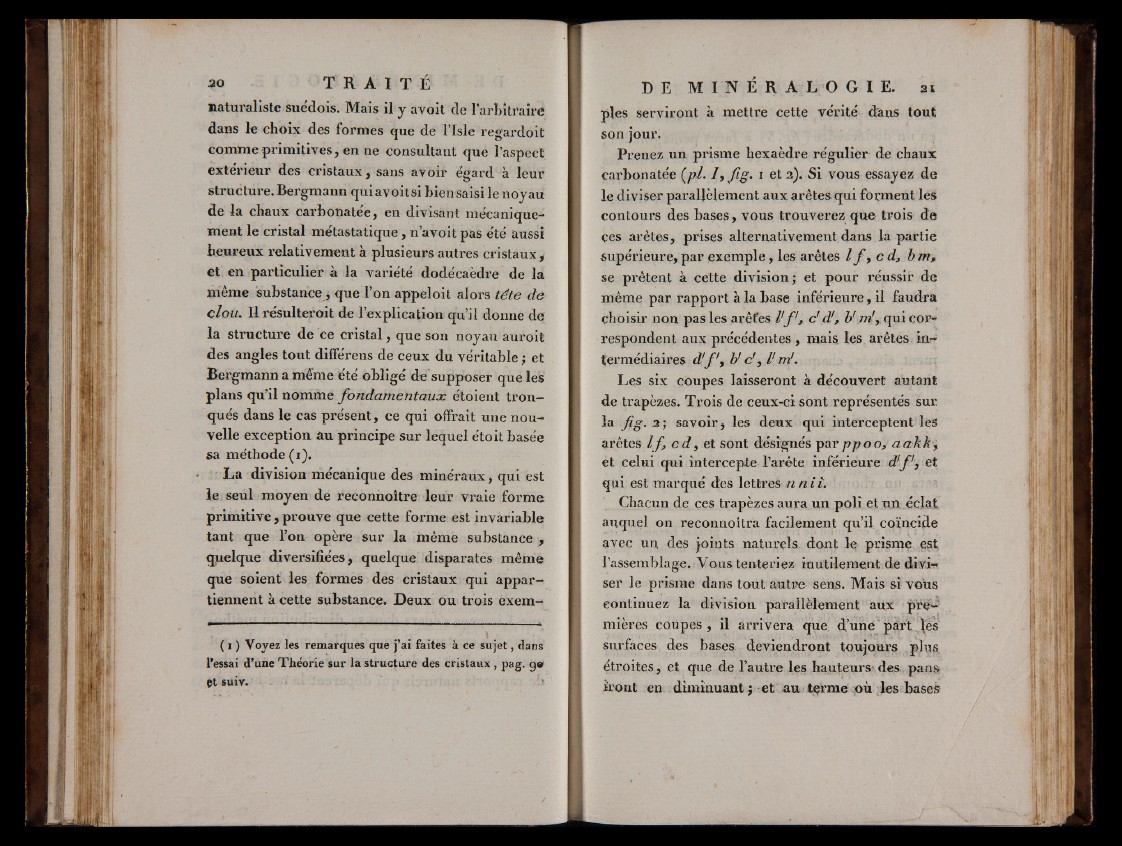
naturaliste suédois. Mais il y avoit de l’arbitmirU
dans le choix des formes que de l’Isle regardôit
comme primitives, en ne consultant que l’aspect
extérieur des cristaux, sans avoir égard à leur
structure. Bergmann qui avoit si bien saisi le noyau
de la chaux carbonatée, en divisant mécanique^-
ment le cristal métastatique, n’avoit pas été aussi
heureux relativement à plusieurs autres cristaux,
et en particulier à la variété dodécaèdre de la
même substance , que l’on appeloit alors tête de
clou. Il résulterait de l’explication qu’il donne de
la structure de ce cristal, que son noyau auroit
des angles tout différens de ceux du véritable ; et
Bergmann a même été obligé de supposer que les
plans qu’il nomme fondamentaux étoient tronqués
dans le cas présent, ce qui offrait une nouvelle
exception àu principe sur lequel étoit basée
sa méthode (i).
La division mécanique des minéraux, qui est
le seul moyen de reconnaître leur vraie forme
primitive, prouve que cette forme est invariable
tant que l’on opère sur la même substance ,
qjaelque diversifiées, quelque disparatés même
que soient les formes des cristaux qui appartiennent
à cette substance. Deux ou trois exem-
( i ) Voyez les remarques que j’ai faites à ce sujet, dans
l’essai d’une Théorie sur la structure des cristaux , pag. 99
çt suiv. ï
D E M I N É R A L O G I E . a i
pies serviront à mettre cette vérité dans tout
son jour.
Prenez un prisme hexaèdre régulier de chaux
carbonatée (pl. / , fig. 1 et a). Si vous essayez de
le diviser parallèlement aux arêtes qui forment les
contours des bases, vous trouverez que trois de
ces arêtes, prises alternativement dans la partie
supérieure, par exemple, les arêtes l f , c d , bm,
se prêtent à cette division; et pour réussir de
même par rapport à la base inférieure, il faudra
choisir non pas lesarêtês Vfij d d!, ¿/ W , qui correspondent
aux précédentes , mais les arêtes intermédiaires
d !f\ b'dy l'm!. : r
Les six coupes laisseront à découvert autant
de trapèzes. Trois de ceux-ci sont représentés sur
la fig. 2; savoir , les deux qui interceptent les
arêtes I f, c d , et sont désignés par ppoo, aa k k ,
ét celui qui intercepte l’arête inférieure d 'f 1, et
qui est marqué des lettres n n ii.
Chacun de ces trapèzes aura un poli et un éclat,
auquel on reconnoîtra facilement qu’il coïncide
avec un des joints naturels dont le prisme est
l ’assemblage. Vous tenteriez inutilement de diviser
le prisme dans tout autre sens. Mais si vous
continuez la division parallèlement aux premières
coupes , il arrivera que d’une part'. \ès
surfaces des bases deviendront toujours plus
étroites , et que de l’autre les hauteurs-des pans
iront en diminuant ; et au tçrme où les bases