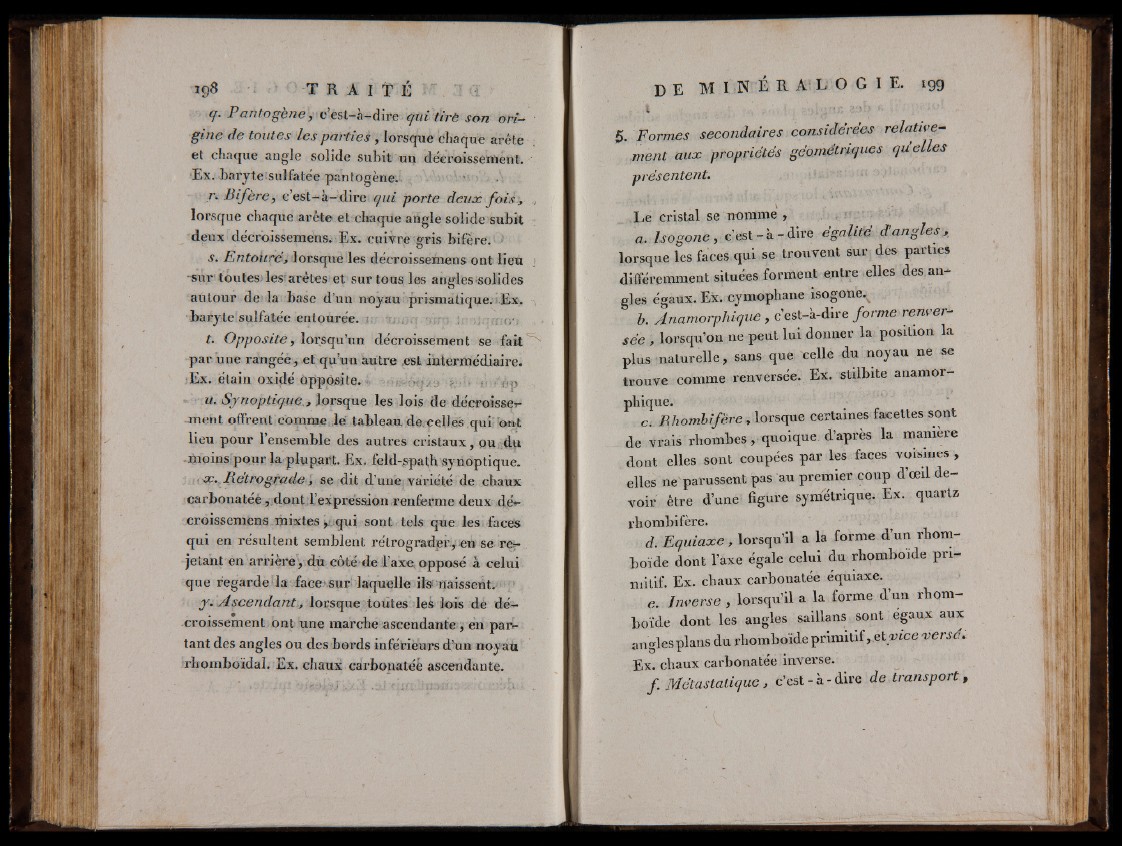
q. Pautogène, c’est-à-dire qui tiré son origine
de toutes les parties, lorsque chaque arête
et chaque angle solide subit un décroissement.
Ex. baryte sulfatée pantogène,
n. Bifère, c’est-a- dire qui porte deuæ fois:,
lorsque chaque arête et chaque angle solide subit
deux décroissemens. Ex. euivregris bifère.
s. Entohré, lorsque les décroissemens ont lieu
sur toutes: les? arêtes et sur tous les angles ;solides
autour de la base d’un noyau prismatique. i,Es.
baryte sulfatée entourée. * . . ; : : v î/
t. Opposite, lorsqu’un décroissement se fait
par une rangée, et quun autre .est intermédiaire.
Ex. étain oxidé opposite. . . t ) J .. . « f.0
u. Synoptique , lorsque les lois de décroissey
ment offrent comme le tableau de celles qui but
lieu pour l’ensemble des autres cristaux, ou du
moins pour la plupart. Ex. feld-spat,h sy noptique.
( x., Rétrograde, se dit d’une; variété de chaux
carbonatée, dont,l’expression renferme deux dé**
croissemens mixtes > qui sont tels que les faces
qui en résultent semblent rélrograder.,en se rer
jetant en arrière , dû côté de l ’axe opposé à celui
que regarde la face-sur laquelle ils naissent, p
y . Ascendant, lorsque toutes les lois de décroissement
ont une marche ascendante, en pan*
tant des angles ou des bords inférieurs d’un noyau
rhomboïdal. Ex. chaux carbonatée ascendante.
5. Formes secondaires considérées relativement
aux propriétés géométriques q u e lle s
présentent.
Le cristal se nomme , . <
n. Isogone, c’est - à - dire égalité d’angles ,
lorsque les faces qui se trouvent sur des parties
différemment situées forment entre elles des angles
égaux. Ex. cymophane isogone.
b. Anamorphique , c’est-à-dire forme renversée
, lorsqu’on ne peut lui donner la position la
p lu s naturelle, sans que celle du noyau ne se
trouve comme renversée. Ex. stilbite anamorphique.
c. Bhombifère , lorsque certaines facettes sont
de vrais rhombes, quoique d’après la maniere
dont elles sont coupées par les faces voisines ,
elles ne parussent pas au premier coup doeil devoir
être d ’ u n e figure symétrique. Ex. quartz
rhombifère. - \
d. E q u ia x e , lorsqu’il a la forme d’un rhomboïde
dont l’axe égale celui du rhomboïde primitif.
Ex. chaux carbonatée équiaxe.
p Inverse , lorsqu’il a la forme d’un rhomboïde
dont les angles saillans sont égaux aux
angles plans du rhomboïde primitif,et auce versé.
Ex. ch aux carbonatée inverse.
/. Métastatique, c’est - à - dire de transport,