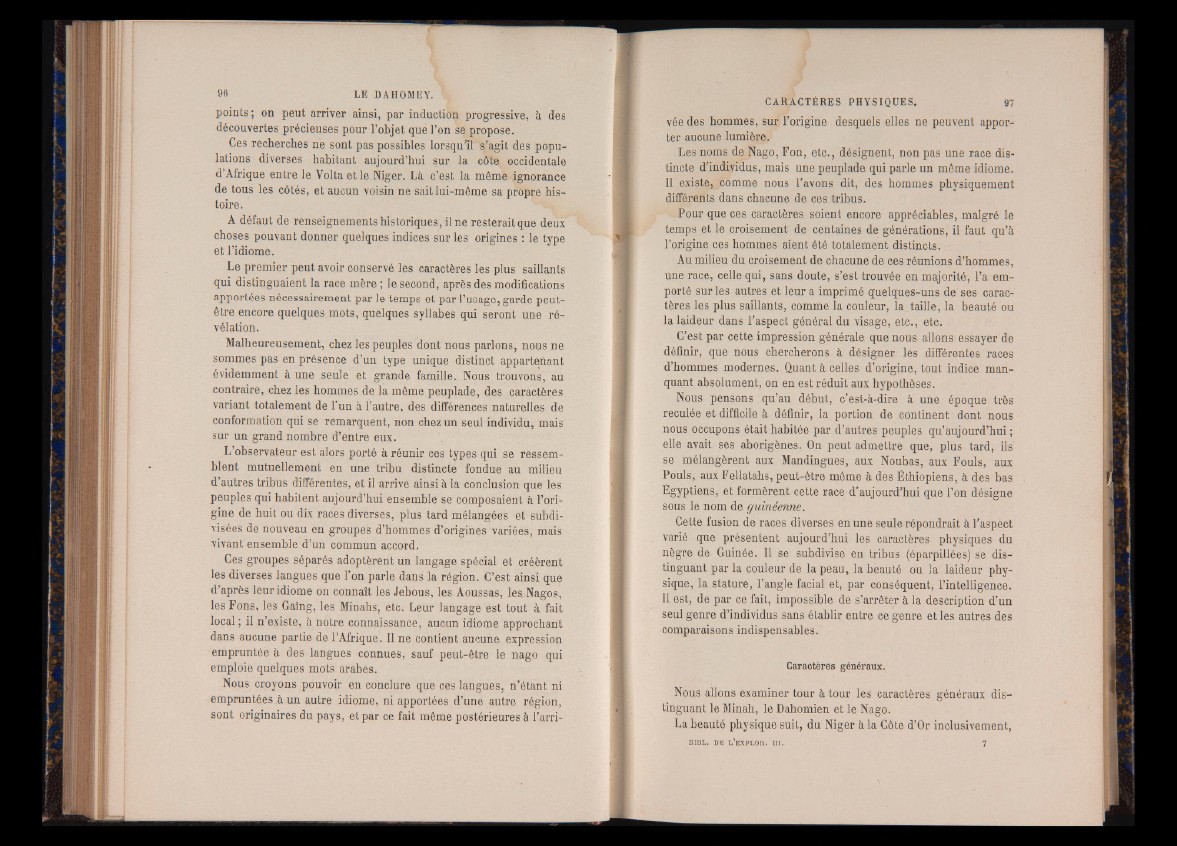
points; on peut arriver ainsi, par induction progressive, à des
découvertes précieuses pour l’objet que l’on se propose.
Ces recherches ne sont pas possibles lorsqu'il s’agit des populations
diverses habitant aujourd’hui sur la côte occidentale
d’Afrique entre le Yolta et le Niger. Là c’est la même ignorance
de tous les côtés, et aucun voisin ne sait lui-même sa propre histoire.
A défaut de renseignements historiques, il ne resterait que deux
choses pouvant donner quelques indices sur les origines : le type
et l’idiome.
Le premier peut avoir conservé les caractères les plus saillants
qui distinguaient la race mère ; le second, après des modifications
apportées nécessairement par le temps et par l’usage, garde peut-
être encore quelques mots, quelques syllabes qui seront une révélation.
Malheureusement, chez les peuples dont nous parlons, nous ne
sommes pas en présence d’un type unique distinct appartenant
évidemment à une seule et grande famille. Nous trouvons, au
contraire, chez les hommes de la même peuplade, des caractères
variant totalement de l’un à l’autre, des différences naturelles de
conformation qui se remarquent, non chez un seul individu, mais
sur un grand nombre d’entre eux.
L’observateur est alors porté à réunir ces types qui se ressemblent
mutuellement en une tribu distincte fondue au milieu
d’autres tribus différentes, et il arrive ainsi à la conclusion que les
peuples qui habitent aujourd’hui ensemble se composaient à l’origine
de huit ou dix races diverses, plus tard mélangées et subdivisées
de nouveau en groupes d’hommes d’origines variées, mais
vivant ensemble d’un commun accord.
Ces groupes séparés adoptèrent un langage spécial et créèrent
les diverses langues que l’on parle dans la région. C’est ainsi que
d’après leur idiome on connaît les Jebous, les Aoussas, les Nagos,
lesFons, les Gaîng, les Minahs, etc. Leur langage est tout à fait
local ; il n ’existe, à notre connaissance, aucun idiome approchant
dans aucune partie de l’Afrique. Il ne contient aucune expression
empruntée à des langues connues, sauf peut-être le nago qui
emploie quelques mots arabes.
Nous croyons pouvoir en conclure que ces langues, n’étant ni
empruntées à un autre idiome, ni apportées d’une autre région,
sont originaires du pays, et par ce fait même postérieures à l’arrivée
des hommes, sur l’origine desquels elles ne peuvent apporter
aucune lumière.
Les noms de Nâgo, Fon, etc., désignent, non pas une race distincte
d'individus, mais une peuplade qui parle un même idiome.
Il existe, comme nous l’avons dit, des hommes physiquement
différents dans chacune de ces tribus.
Pour que ces caractères soient encore appréciables, malgré le
temps et le croisement de centaines de générations, il faut qu’à
l’origine ces hommes aient été totalement distincts.
Au milieu du croisement de chacune de ces réunions d’hommes,
une race, celle qui, sans doute, s’est trouvée en majorité, l’a emporté
sur les autres et leur a imprimé quelques-uns de ses caractères
les plus saillants, comme la couleur, la taille, la beauté ou
la laideur dans l'aspect général du visage, etc., etc.
C’est par cette impression générale que nous allons essayer de
définir, que nous chercherons à désigner les différentes races
d’hommes modernes. Quant à celles d’origine, tout indice manquant
absolument, on en est réduit aux hypothèses.
Nous pensons qu’au début, c’est-à-dire à une époque très
reculée et difficile à définir, la portion de continent dont nous
nous occupons était habitée par d’autres peuples qu’aujourd’hui ;
elle avait ses aborigènes. On peut admettre que, plus tard, ils
se mélangèrent aux Mandingues, aux Noubas, aux Fouis, aux
Pouls, aux Fellatahs, peut-être même à des Éthiopiens, à des bas
Égyptiens, et formèrent cette race d’aujourd’hui que l’on désigne
sous le nom de guinéenne.
Cette fusion de races diverses en une seule répondrait à l'aspect
varié que présentent aujourd’hui les caractères physiques du
nègre de Guinée. Il se subdivise en tribus (éparpillées) se distinguant
par la couleur de la peau, la beauté ou la laideur physique,
la stature, l’angle facial et, par conséquent, l’intelligence.
II est, de par ce fait, impossible de s’arrêter à la description d’un
seul genre d’individus sans établir entre ce genre et les autres des
comparaisons indispensables.
Caractères généraux.
Nous allons examiner tour à tour les caractères généraux distinguant
le Minah, le Dahomien et le Nago.
La beauté physique suit, du Niger à la Côte d’Or inclusivement,