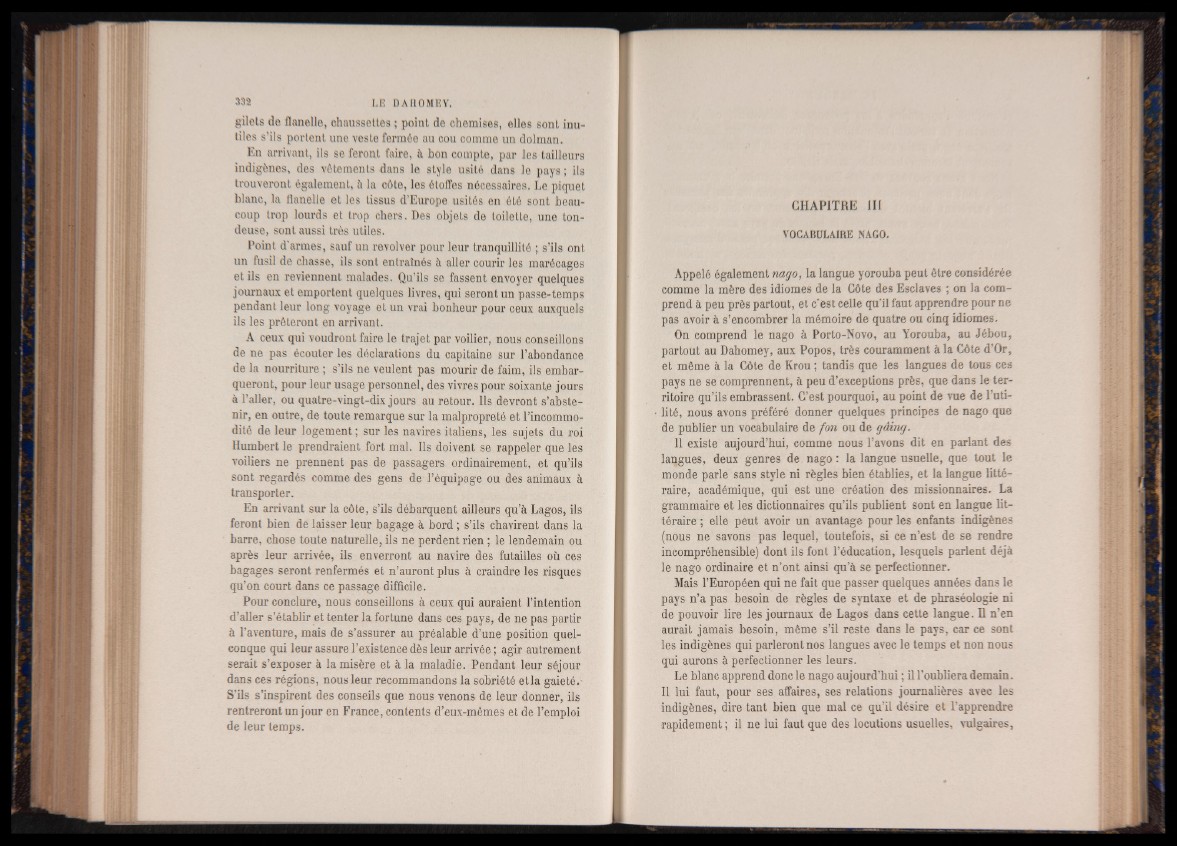
gilets do flanelle, chaussettes ; point de chemises, elles sont inutiles
s'ils portent une veste fermée au cou comme un dolman.
En arrivant, ils se feront faire, à bon compte, par les tailleurs
indigènes, des vêtements dans le style usité dans le pays ; ils
trouveront également, à la côte, les étoffes nécessaires. Le piquet
blanc, la ilanelle et les tissus d’Europe usités en été sont beaucoup
trop lourds et trop chers. Des objets de toilette, une tondeuse,
sont aussi très utiles.
Point d'armes, sauf un revolver pour leur tranquillité ; s’ils ont
un fusil de chasse, ils sont entraînés à aller courir les marécages
et ils en reviennent malades. Qu’ils se fassent envoyer quelques
journaux et emportent quelques livres, qui seront un passe-temps
pendant leur long voyage et un vrai bonheur pour ceux auxquels
ils les prêteront en arrivant.
A ceux qui voudront faire le trajet par voilier, nous conseillons
de ne pas écouter les déclarations du capitaine sur l’abondance
de la nourriture ; s’ils ne veulent pas mourir de faim, ils embarqueront,
pour leur usage personnel, des vivres pour soixante jours
à l’aller, ou quatre-vingt-dix jours au retour. Ils devront s’abstenir,
en outre, de toute remarque sur la malpropreté et l’incommodité
de leur logement ; sur les navires italiens, les sujets du roi
Humbert le prendraient fort mal. Ils doivent se rappeler que les
voiliers ne prennent pas de passagers ordinairement, et qu’ils
sont regardés comme des gens de l’équipage ou des animaux à
transporter.
En arrivant sur la côte, s’ils débarquent ailleurs qu’à Lagos, ils
feront bien de laisser leur bagage à bord ; s’ils chavirent dans la
barre, chose toute naturelle, ils ne perdent rien ; le lendemain ou
après leur arrivée, ils enverront au navire des futailles où ces
bagages seront renfermés et n ’auront plus à craindre les risques
qu’on court dans ce passage difficile.
Pour conclure, nous conseillons à ceux qui auraient l’intention
d’aller s’établir et tenter la fortune dans ces pays, de ne pas partir
à l’aventure, mais de s’assurer au préalable d’une position quelconque
qui leur assure l’existence dès leur arrivée ; agir autrement
serait s’exposer à la misère et à la maladie. Pendant leur séjour
dans ces régions, nous leur recommandons la sobriété etla gaieté.-
S’ils s’inspirent des conseils que nous venons de leur donner, ils
rentreront un jour en France, contents d’eux-mêmes et de l’emploi
de leur temps.
CHAPITRE III
VOCABULAIRE NAGO.
Appelé également nago, la langue yorouba peut être considérée
comme la mère des idiomes de la Côte des Esclaves ; on la comprend
à peu près partout, et c’est celle qu’il faut apprendre pour ne
pas avoir à s’encombrer la mémoire de quatre ou cinq idiomes.
0n comprend le nago à Porto-Novo, au Yorouba, au Jébou,
partout au Dahomey, aux Popos, très couramment à la Côte d’Or,
et même à la Côte de Krou ; tandis que les langues de tous ces
pays ne se comprennent, à peu d’exceptions près, que dans le territoire
qu’ils embrassent. C’est pourquoi, au point de vue de l’utilité,
nous avons préféré donner quelques principes de nago que
de publier un vocabulaire de fon ou de gâing.
11 existe aujourd’hui, comme nous l’avons dit en parlant des
langues, deux genres de nago : la langue usuelle, que tout le
monde parle sans style ni règles bien établies, et la langue littéraire,
académique, qui est une création des missionnaires. La
grammaire et les dictionnaires qu’ils publient sont en langue littéraire
; elle peut avoir un avantage pour les enfants indigènes
(nous ne savons pas lequel, toutefois, si ce n’est de se rendre
incompréhensible) dont ils font l’éducation, lesquels parlent déjà
le nago ordinaire et n ’ont ainsi qu’à se perfectionner.
Mais l’Européen qui ne fait que passer quelques années dans le
pays n’a pas besoin de règles de syntaxe et de phraséologie ni
de pouvoir lire les journaux de Lagos dans cette langue. Il n ’en
aurait jamais besoin, même s’il reste dans le pays, car ce sont
les indigènes qui parleront nos langues avec le temps et non nous
qui aurons à perfectionner les leurs.
Le blanc apprend donc le nago aujourd’hui ; il l’oubliera demain.
Il lui faut, pour ses affaires, ses relations journalières avec les
indigènes, dire tant bien que mal ce qu’il désire et l’apprendre
rapidement ; il ne lui faut que des locutions usuelles, vulgaires,