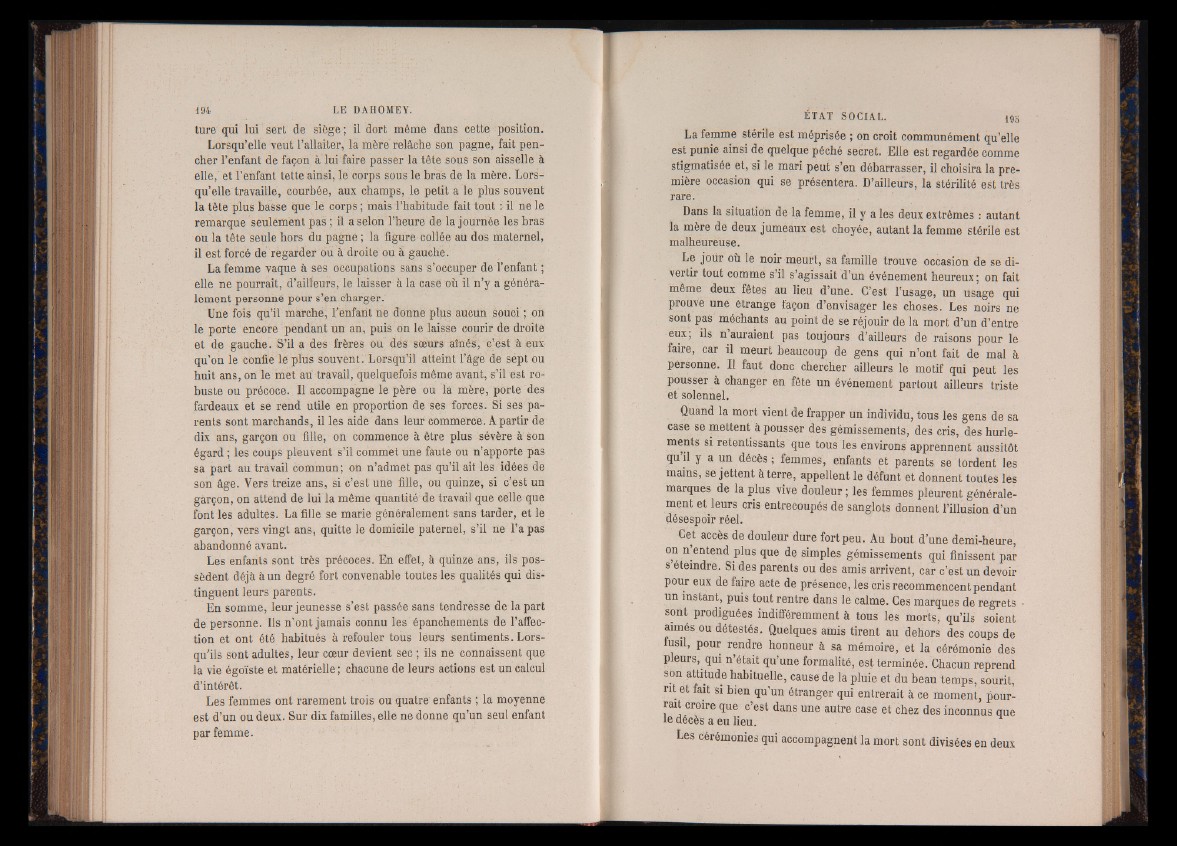
ture qui lui sert de siège ; il dort même dans cette position.
Lorsqu’elle veut l’allaiter, la mère relâche son pagne, fait pencher
l’enfant de façon à lui faire passer la tête sous son aisselle à
elle, et l’enfant tette ainsi, le corps sous le bras de la mère. Lorsqu’elle
travaille, courbée, aux champs, le petit a le plus souvent
la tête plus basse que le corps ; mais l’habitude fait tout : il ne le
remarque seulement pas ; il a selon l’heure de la journée les bras
ou la tête seule hors du pagne ; la figure collée au dos maternel,
il est forcé de regarder ou à droite ou à gauche.
La femme vaque à ses occupations sans s’occuper dé l’enfant J
elle ne pourrait, d’ailleurs, le laisser à la case où il n ’y a généralement
personne pour s’en charger.
Une fois qu’il marche, l’enfant ne donné plus aucun souci ; on
le porte encore pendant un an, puis on le laisse courir de droite
et de gauche. S’il a des frères ou des sceurs aînés, c’est à eux
qu’on le confie le plus souvent. Lorsqu’il atteint l’âge de sept ou
huit ans, on le met au travail, quelquefois même avant, s’il est robuste
ou précoce. Il accompagne le père ou la mère, porte des
fardeaux et se rend utile en proportion de ses forces. Si ses parents
sont marchands, il les aide dans leur commerce. A partir de
dix ans, garçon ou fille, on commence à être plus sévère à son
égard ; les coups pleuvent s’il commet une faute ou n’apporte pas
sa part au travail commun; on n’admet pas qu’il ait les idées de
son âge. Vers treize ans,, si c’est une fille, ou quinze, si c’est un
garçon, on attend de lui la même quantité de travail que celle que
font les adultes. La fille se marie généralement sans tarder, et le
garçon, vers vingt ans, quitte le domicile paternel, s’il ne l’a pas
abandonné avant.
Les enfants sont très précoces. En effet, à quinze ans, ils possèdent
déjà à un degré fort convenable toutes les qualités qui distinguent
leurs parents.
En somme, leur jeunesse s’est passée sans tendrésse de la part
de personne. Ils n ’ont jamais connu les épanchements de l’affection
et ont été habitués à refouler tous leurs sentiments. Lorsqu’ils
sont adultes, leur coeur devient sec ; ils ne connaissent que
la vie égoïste et matérielle ; chacune de leurs actions est un calcul
d’intérêt.
Les femmes ont rarement trois ou quatre enfants ; la moyenne
est d’un ou deux. Sur dix familles, elle ne donne qu’un seul enfant
par femme.
La femme stérile est méprisée ; on croit communément qu’elle
est punie ainsi de quelque péché secret. Elle est regardée comme
stigmatisée et, si le mari peut s’en débarrasser, il choisira la première
occasion qui se présentera. D’ailleurs, la stérilité est très
rare.
Dans la situation de la femme, il y a les deux extrêmes : autant
la mère de deux jumeaux est choyée, autant la femme stérile est
malheureuse.
Le jour où le noir meurt, sa famille trouve occasion de se divertir
tout comme s’il s’agissait d’un événement heureux ; on fait
même deux fêtes au lieu d’une. C’est l’usage, un usage qui
prouvé une étrange façon d’envisager les choses. Les noirs ne
sont pas méchants au point de se réjouir de la mort d’un d’entre
eux, ils n auraient pas toujours d’ailleurs de raisons pour le
faire, car il meurt beaucoup de gens qui n’ont fait de mal à
personne. Il faut donc chercher ailleurs le motif qui peut les
pousser à changer en fête un événement partout ailleurs triste
et solennel.
Quand la mort vient de frapper un individu, tous les gens de sa
case se mettent à pousser des gémissements, des cris, des hurlements
si retentissants que tous les environs apprennent aussitôt
qu il y a un décès ; femmes, enfants et parents se tordent les
mains, se jettent à terre, appellent le défunt et donnent toutes les
marques de la plus vive douleur ; les femmes pleurent généralement
et leurs cris entrecoupés de sanglots donnent l’illusion d’un
désespoir réel.
Cet accès de douleur dure fort peu. Au bout d’une demi-heure,
on n’entend plus que de simples gémissements qui finissent par
s éteindre. Si des parents ou des amis arrivent, car c’est un devoir
pour eux de faire acte de présence, les cris recommencent pendant
un instant, puis tout rentre dans le calme. Ces marques de regrets
sont prodiguées indifféremment à tous les morts, qu’ils soient
aimés ou détestés. Quelques amis tirent au dehors des coups de
usil, pour rendre honneur à sa mémoire, et la cérémonie des
pleurs, qui n’était qu’une formalité, est terminée. Chacun reprend
son attitude habituelle, cause de la pluie et du beau temps, sourit,
n t et fait si bien qu’un étranger qui entrerait à ce moment, pourrait
croire que c’est dans une autre case et chez des inconnus que
le décès a eu lieu.
Les cérémonies qui accompagnent la mort sont divisées en deux