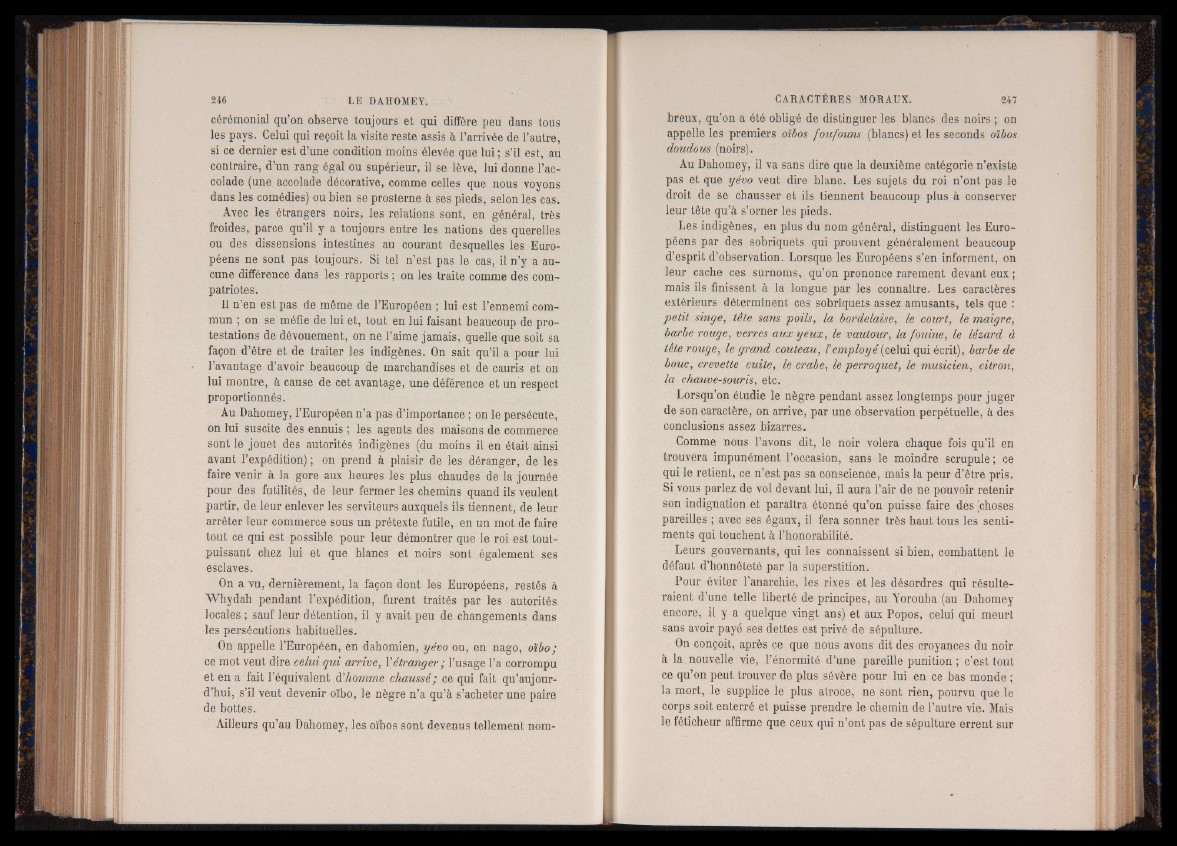
cérémonial qu’on observe toujours et qui diffère peu dans tous
les pays. Celui qui reçoit la visite reste assis à l’arrivée de l’autre,
si ce dernier est d’une condition moins élevée que lui; s’il est, au
contraire, d’un rang égal ou supérieur, il se lève, lui donne l’accolade
(une accolade décorative, comme celles que nous voyons
dans les comédies) ou bien se prosterne à ses pieds, selon les cas.
Avec les étrangers noirs, les relations sont, en général, très
froides, parce qu’il y a toujours entre les nations des querelles
ou des dissensions intestines au courant desquelles les Européens
ne sont pas toujours. Si tel n’est pas le cas, il n ’y a aucune
différence dans les rapports ; on les traite comme des compatriotes.
Il n’en est pas de même de l’Européen ; lui est l’ennemi commun
; on se méfie de lui et, tout en lui faisant beaucoup de protestations
de dévouement, on ne l’aime jamais, quelle que soit sa
façon d’être et de traiter les indigènes. On sait qu’il a pour lui
l’avantage d’avoir beaucoup de marchandises et de cauris et on
lui montre, à cause de cet avantage, une déférence et un respect
proportionnés.
Au Dahomey, l’Européen n’a pas d’importance ; on le persécute,
on lui suscite des ennuis ; les agents des maisons de commerce
sont le jouet des autorités indigènes (du moins il en était ainsi
avant l’expédition) ; on prend à plaisir de les déranger, de les
faire venir à la gore aux heures les plus chaudes de la journée
pour des futilités, de leur fermer les chemins quand ils veulent
partir, de leur enlever les serviteurs auxquels ils tiennent, de leur
arrêter leur commerce sous un prétexte futile, en un mot de faire
tout ce qui est possible pour leur démontrer que le roi est tout-
puissant chez lui et que blancs et noirs sont également ses
esclaves.
On a vu, dernièrement, la façon dont les Européens, restés à
Whydah pendant l’expédition, furent traités par les autorités
locales ; sauf leur détention, il y avait peu de changements dans
les persécutions habituelles.
On appelle l’Européen, en dahomien, yévo ou, en nago, oïbo ;
ce mot veut dire celui qui arrive, l’étranger ; l’usage l’a corrompu
et en a fait l’équivalent d'homme chaussé ; ce qui fait qu’aujourd’hui,
s’il veut devenir oïbo, le nègre n’a qu’à s’acheter une paire
de bottes.
Ailleurs qu’au Dahomey, les oïbos sont devenus tellement nombreux,
qu’on a été obligé de distinguer les blancs des noirs ; on
appelle les premiers oïbos foufouns (blancs) et les seconds oïbos
doudous (noirs).
Au Dahomey, il va sans dire que la deuxième catégorie n’existe
pas et que yévo veut dire blanc. Les sujets du roi n’ont pas le
droit de se chausser et ils tiennent beaucoup plus à conserver
leur tête qu’à s’orner les pieds.
Les indigènes, en plus du nom général, distinguent les Européens
par des sobriquets qui prouvent généralement beaucoup
d’esprit d’observation. Lorsque les Européens s’en informent, on
leur cache ces surnoms, qu’on prononce rarement devant eux ;
mais ils finissent à la longue par les connaître. Les caractères
extérieurs déterminent ces sobriquets assez amusants, tels que :
petit singe, tête sans poils, la bordelaise, le court, le maigre,
barbe rouge, verres aux yeux, le vautour, la fouine, le lézard à
tète rouge, le grand couteau, l'employé (celui qui écrit), barbe de
bouc, crevette cuite, le crabe, le perroquet, le musicien, citron,
la chauve-souris, etc.
Lorsqu’on étudie le nègre pendant assez longtemps pour juger
de son caractère, on arrive, par une observation perpétuelle, à des
conclusions assez bizarres.
Gomme nous l’avons dit, le noir volera chaque fois qu’il en
trouvera impunément l’occasion, sans le moindre scrupule; ce
qui le retient, ce n’est pas sa conscience, mais la peur d’être pris.
Si vous parlez de vol devant lui, il aura l’air de ne pouvoir retenir
son indignation et paraîtra étonné qu’on puisse faire des [choses
pareilles ; avec ses égaux, il fera sonner très haut tous les sentiments
qui touchent à l’honorabilité.
Leurs gouvernants, qui les connaissent si bien, combattent le
défaut d’honnêteté par la superstition.
Pour éviter l’anarchie, les rixes et les désordres qui résulteraient
d’une telle liberté de principes, au Yorouba (au Dahomey
encore, il y a quelque vingt ans) et aux Popos, celui qui meurt
sans avoir payé ses dettes est privé de sépulture.
On conçoit, après ce que nous avons dit des croyances du noir
à la nouvelle vie, l’énormité d’une pareille punition ; c’est tout
ce qu’on peut trouver de plus sévère pour lui en ce bas monde ;
la mort, le supplice le plus atroce, ne sont rien, pourvu que le
corps soit enterré et puisse prendre le chemin de l’autre vie. Mais
le féticheur affirme que ceux qui n’ont pas de sépulture errent sur