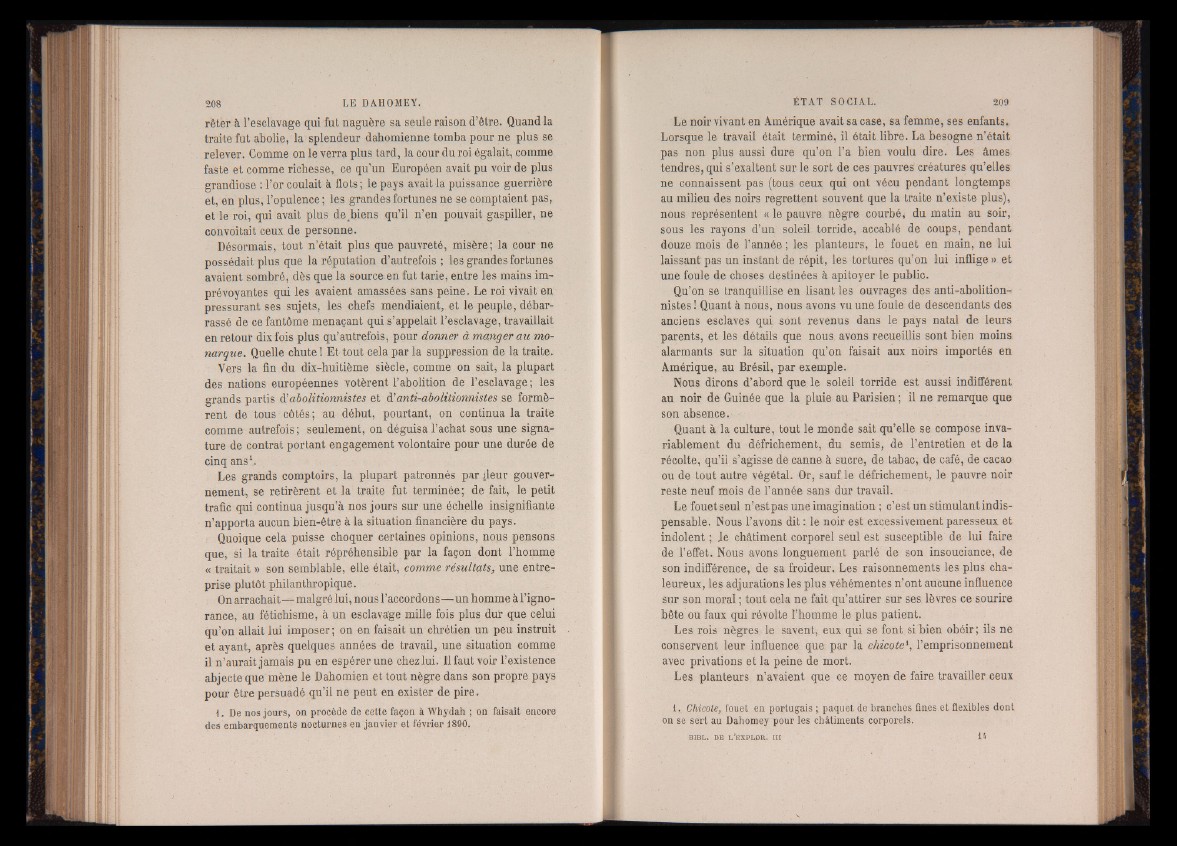
rêter à l’esclavage qui fut naguère sa seule raison d’être. Quand la
traite fut abolie, la splendeur dahomienne tomba pour ne plus se
relever. Comme on le verra plus tard, la cour du roi égalait, comme
faste et comme richesse, ce qu’un Européen avait pu voir de plus
grandiose : l’or coulait à flots; le pays avait la puissance guerrière
et, en plus, l’opulence; les grandes fortunes ne se comptaient pas,
et le roi, qui avait plus de .biens qu’il n’en pouvait gaspiller, ne
convoitait ceux de personne.
Désormais, tout n ’était plus que pauvreté, misère; la cour ne
possédait plus que la réputation d’autrefois ; les grandes fortunes
avaient sombré, dès que la source en fut tarie, entre les mains imprévoyantes
qui les avaient amassées sans peine. Le roi vivait en
pressurant ses sujets, les chefs mendiaient, et le peuple, débarrassé
de ce fantôme menaçant qui s’appelait l’esclavage, travaillait
en retour dix fois plus qu’autrefois, pour donner à manger au monarque.
Quelle chute ! Et tout cela par la suppression de la traite.
Vers la fin du dix-huitième siècle, comme on sait, la plupart
des nations européennes votèrent l’abolition de l’esclavage; les
grands partis d'abolitionnistes et à'anti-abolitionnistes se formèrent
de tous côtés ; au début, pourtant, on continua la traite
comme autrefois; seulement, on déguisa l’achat sous une signature
de contrat portant engagement volontaire pour une durée de
cinq ans1.
Les grands comptoirs, la plupart patronnés par ¡leur gouvernement,
se retirèrent et la traite fut terminée; de fait, le petit
trafic qui continua jusqu’à nos jours sur une échelle insignifiante
n’apporta aucun bien-être à la situation financière du pays.
Quoique cela puisse choquer certaines opinions, nous pensons
que, si la traite était répréhensible par la façon dont l’homme
« traitait » son semblable, elle était, comme résultats, une entreprise
plutôt philanthropique.
On arrachait—-malgré lui, nous l’accordons—un homme à l’ignorance,
au fétichisme, à un esclavage mille fois plus dur que celui
qu’on allait lui imposer ; on en faisait un chrétien un peu instruit
et ayant, après quelques années de travail, une situation comme
il n’aurait jamais pu en espérer une chez lui. il faut voir l’existence
abjecte que mène le Dahomien et tout nègre dans son propre pays
pour être persuadé qu’il ne peut en exister de pire.
1. De nos jours, on procède de cette façon à Whydah ; on faisait encore
des embarquements nocturnes en janvier et février 1890.
Le noir vivant en Amérique avait sa case, sa femme, ses enfants.
Lorsque le travail était terminé, il était libre. La besogne n’était
pas non plus aussi dure qu’on l’a bien voulu dire. Les âmes
tendres, qui s’exaltent sur le sort de ces pauvres créatures qu’elles
ne connaissent pas (tous ceux qui ont vécu pendant longtemps
au milieu des noirs regrettent souvent que la traite n’existe plus),
nous représentent « le pauvre nègre courbé* du matin au soir,
sous les rayons d’un soleil torride, accablé de coups, pendant
douze mois de l’année ; les planteurs, le fouet en main, ne lui
laissant pas un instant de répit, les tortures qu’on lui inflige » et
une foule de choses destinées à apitoyer le public.
Qu’on se tranquillise en lisant les ouvrages des anti-abolitionnistes
! Quant à nous, nous avons vu une foule de descendants des
anciens esclaves qui sont revenus dans le pays natal de leurs
parents, et les détails que nous avons recueillis sont bien moins
alarmants sur la situation qu’on faisait aux noirs importés en
Amérique, au Brésil, par exemple.
Nous dirons d’abord que le soleil torride est aussi indifférent
au noir de Guinée que la pluie au Parisien ; il ne remarque que
son absence.
Quant à la culture, tout le monde sait qu’elle se compose invariablement
du défrichement, du semis, de l’entretien et de la
récolte, qu’il s’agisse de canne, à sucre, de tabac, de café, de cacao
ou de tout autre végétal. Or, sauf le défrichement, le pauvre noir
reste neuf mois de l’année sans dur travail.
Le fouet seul n’estpas une imagination ; c’est un stimulant indispensable.
Nous l’avons dit : le noir est excessivement paresseux et
indolent ; le châtiment corporel seul est susceptible de lui faire
de l’effet. Nous avons longuement parlé de son insouciance, de
son indifférence, de sa froideur. Les raisonnements les plus chaleureux,
les adjurations les plus véhémentes n’ont aucune influence
sur son moral ; tout cela ne fait qu’attirer sur ses lèvres ce sourire
bête ou faux qui révolte l’homme le plus patient.
Les rois nègres le savent, eux qui se font si bien obéir; ils ne
conservent leur influence que par la chicote’, l’emprisonnement
avec privations et la peine de mort.
Les planteurs n’avaient que ce moyen de faire travailler ceux
1. Chicote, fouet en portugais ; paquet de branches fines et flexibles dont
on se se rt au Dahomey pour les châtiments corporels.