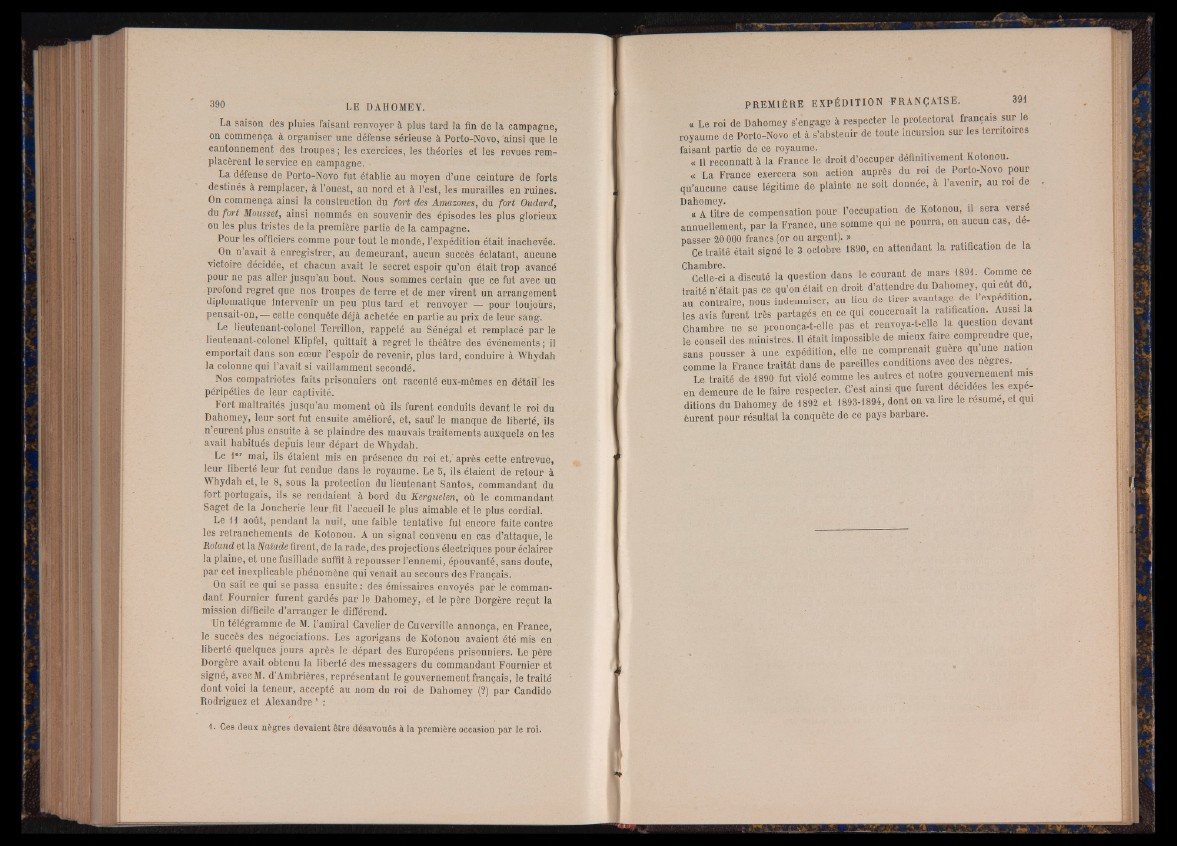
La saison des pluies faisant renvoyer à plus tard la fin de la campagne,
on commença à organiser une défense sérieuse à Porto-Novo, ainsi que le
cantonnement des troupes ; les exercices, les théories et les revues remplacèrent
le service en campagne.
La défense de Porto-Novo fut établie au moyen d’une ceinture de forts
destinés à remplacer, à l’ouest, au nord et à Test, les murailles en ruines.
On commença ainsi la construction du fort des Amazones, du fort Oudard,
du fort Mousset, ainsi nommés en souvenir des épisodes les plus glorieux
ou les plus tristes de la première partie de la campagne.
Pour les officiers comme pour tout le monde, l’expédition était inachevée.
On n’avait à enregistrer, au demeurant, aucun succès éclatant, aucune
victoire décidée, et chacun avait le secret espoir qu’on était trop avancé
pour ne pas aller jusqu’au bout. Nous sommes certain que ce fut avec un
profond regret que nos troupes de terre et de mer virent un arrangement
diplomatique intervenir un peu plus tard et renvoyer — pour toujours,
pensait-on,— cette conquête déjà achetée en partie au prix de leur sang.
Le lieutenant-colonel Terrillon, rappelé au Sénégal et remplacé par le
lieutenant-colonel Klipfel, quittait à regret le théâtre des événements; il
emportait dans son coeur l’espoir de revenir, plus tard, conduire à Whydah
la colonne qui l’avait si vaillamment secondé.
Nos compatriotes faits prisonniers ont raconté eux-mêmes en détail" les
péripéties de leur captivité.
Fort maltraités jusqu’au moment où ils furent conduits devant le roi du
Dahomey, leur sort fut ensuite amélioré, et, sauf le manque de liberté, ils
n’eurent plus ensuite à se plaindre des mauvais traitements auxquels on les
avait habitués dep’uis leur départ de Whydah.
Le f er mai, ils étaient mis en présence du roi et,'après cette entrevue,
leur liberté leur fut rendue dans le royaume. Le 5, ils étaient de retour à
Whydah et, le 8, sous la protection du lieutenant Santos, commandant du
fort portugais, ils se rendaient à bord du Kerguelen, où le commandant
Saget de la Joncherie leur.fit l’accueil le plus aimable et le plus cordial.
Le i l août, pendant la nuit, une faible tentative fut encore faite contre
le s retranchements de Kotonou. A un signal convenu en cas d’attaque, le
Roland et la Naïade firent, de la rade, des projections électriques pour éclairer
la p laine, et une fusillade suffit à repousser l ’ennemi, épouvanté, sans doute,
par cet inexplicable phénomène qui venait au secours des Français.
On sait ce qui se passa ensuite : des émissaires envoyés par le commandant
Fournier furent gardés par le Dahomey, et le père Dorgère reçut la
mission difficile d’arranger le différend.
Un télégramme de M. l’amiral Cavelier de Cuverville annonça, en France,
le succès des négociations. Les agorigans de Kotonou avaient été mis en
liberté quelques jours après le départ des Européens prisonniers. Le père
Dorgère avait obtenu la liberté des messagers du commandant Fournier et
signé, avecM. d’Ambrières, représentant le gouvernement français, le traité
dont voici la teneur, accepté au nom du roi de Dahomey (?) par Candido
Rodríguez et Alexandre ' :
1. Ces deux nègres devaient être désavoués à la première occasion par le roi.
« Le roi de Dahomey s’engage à respecter le protectorat français sur le
royaume de Porto-Novo et à s’abstenir de toute incursion sur les territoires
faisant partie de ce royaume.
« 11 reconnaît à la France le droit d’occuper définitivement Kotonou.
« La France exercera son action auprès du roi de Porto-Novo pour
qu’aucune cause légitime de plainte ne soit donnée, à 1 avenir, au roi e
Dahomey. ,
« A titre de compensation pour l’occupation de Kotonou, il sera verse
annuellement, par la France, une somme qui ne pourra, en aucun cas, dépasser
20 000 francs (or ou argent). » , ‘ j *3
Ce traité était signé le 3 octobre 1890, en attendant la ratification de la
Chambre
Celle-ci a discuté la question dans le courant de mars 1891. Comme ce
traité n’était pas ce qu’on était en droit d’attendre du Dahomey, qui eût du,
au . contraire, nous indemniser, au lieu de tirer avantage de 1 expédition,
les avis furent très partagés en ce qui concernait la ratification. Aussi la
Chambre ne se prononça-t-ellê pas et renvoya-t-elle la question devant
le conseil des ministres. Il était impossible de mieux faire comprendre que,
sans pousser à une expédition, elle ne comprenait guère qu’une nation
comme la France traitât dans de pareilles conditions avec des nègres. ^
Le traité de 1890 fut violé comme le s autres et notre gouvernement mis
en demeure de le faire respecter. C’est ainsi que furent décidées le s expéditions
du Dahomey de 1892 et 1893-1894, dont on va lire le résumé, et qui
êurent pour résultat la conquête de ce pays barbare.